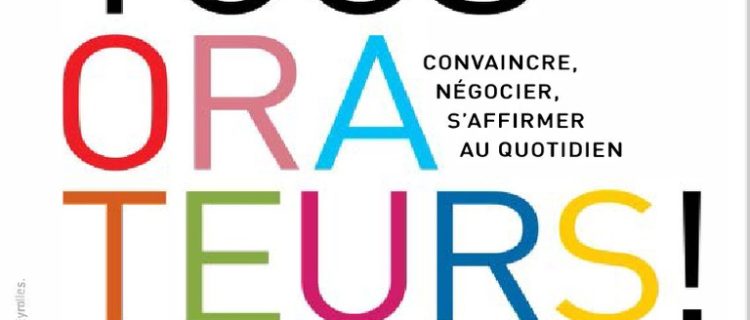Normalien, agrégé d’histoire, diplômé de Sciences Po, vous avez enseigné dans un établissement ZEP à la Courneuve, au pied de la cité des 4000, avant de devenir professeur d’art oratoire à Science Po Paris. Pouvez-vous apporter quelques précisions sur votre parcours personnel en lien avec les compétences orales et professionnelles ?
Après une dizaine d’années d’études supérieures, j’ai candidaté pour un poste à exigence spécifique lors de ma titularisation dans un collège à La Courneuve. Ce fut une redescente sur terre bienvenue. Enseigner à des adolescents de 10 à 17 ans vous conduit à quitter le monde nimbé des spéculations intellectuelles pour vous river à une seule question : comment faire passer ce que j’ai envie de transmettre ? Ce fut une mise en pratique personnelle de cet art de la parole qui est en premier lieu un art de l’écoute et de l’altérité. J’étais nourri par mes études bien sûr, mais aussi par la formation et la pratique du théâtre et particulièrement par une expérience de troupe de théâtre itinérant.
À Normale Sup’, au milieu des années 1990, j’avais mis en scène quelques pièces, Sartre, Gombrowicz… Nous étions une bande de copains. Et parmi ceux-là quelques-uns à vouloir une autre aventure. Non pas jouer devant les pairs, mais devant tous les publics, dans la tradition du théâtre populaire.
Une expérience de troupe, où vous débutez la journée par des parades sur les marchés – ou les parkings de supermarchés -, puis montez les décors de bois à la visseuse l’après-midi, puis installez les projecteurs pour jouer le soir, parfois dans le vent et sous la menace de l’orage. J’avais vingt-cinq ans, j’étais chef de la troupe : ce fut une école. Avec le recul, je crois que pendant ces heures innombrables consacrées à la mise en scène et à la direction d’acteurs, je me suis forgé comme pédagogue. Et sans doute suis-je allé vers le théâtre parce qu’au fond, ce qui me touchait, c’était cet accouchement de la personne pendant la répétition.
Comment en êtes-vous venu à ce théâtre de tréteaux ?
Avec un ami, au milieu des années 1990, nous nous étions rendus à la rencontre du Foostbarn Travelling Theatre, une troupe communautaire anglaise fondée à l’époque hippie qui jouait dans la banlieue de Dijon, sous chapiteau, l’Odyssée d’Homère, un spectacle dans la tradition de la Commedia Dell’ Arte, de Molière et Shakespeare. Après le spectacle, je demande aux comédiens où ils conseillent de se former. Ils répondent : « Il n’y a qu’un lieu, l’École Jacques Lecoq à Paris ». J’ignorais tout de cette institution davantage connue aux États-Unis, en Australie ou en Corée que dans son propre pays.
La rencontre avec Jacques Lecoq (1921-1999) a provoqué un séisme personnel. C’était un immense pédagogue de théâtre. J’étais élève dans son école deux ans avant sa mort, mais il transmettait toujours en personne. C’était une pédagogie conçue comme un voyage et dont la progression sur chaque journée, chaque semaine, l’une à la suite de l’autre, était pensée. J’avais un peu plus de vingt ans, le bon élève français, un élève si raide dans son corps. J’ai beaucoup souffert à l’École Lecoq au milieu des danseurs, des comédiens, des acrobates venus des cinq continents. J’y ai reçu une grande leçon.
La pédagogie de Lecoq est fondée sur l’engagement physique et l’observation du monde. Ariane Mnouchkine du Théâtre du Soleil dit qu’il a été son maître et je comprends pourquoi. Il fut l’inventeur génial du masque neutre, lui-même hérité de la tradition du masque noble du théâtre nô japonais.
C’est un outil pédagogique qui invite à un dépouillement personnel. Un masque en cuir que l’on se met sur le visage et qui permet de ressentir la sensation physique du calme et la relation à l’espace, élément clef dans le travail de l’acteur comme de l’orateur, mais aussi de l’enseignant et plus généralement de toute personne dont l’exercice de la parole est au cœur du métier. Bien sûr, une telle qualité fondamentale, l’état de réceptivité à ce qui nous environne, peut se travailler autrement que par le masque neutre, mais ce ne sera pas le même voyage.

Et l’art oratoire dans tout ça ?
Quand j’étais chez Lecoq, je sortais de Sciences Po et j’avais été déçu de ne pas y rencontrer un enseignement de l’art oratoire. L’oral qui faisait pourtant la réputation de l’École consistait en un exposé de 10 minutes produit par les étudiants, souvent assis, à lire leurs notes à toute vitesse, de crainte de ne pas avoir le temps de dire tout ce qu’ils avaient préparé. L’exposé était suivi à chaque fois d’une reprise de l’enseignant, qui s’attachait quasi exclusivement au contenu. Sauf exception, la « conférence de méthode » répétait inlassablement le même rituel monotone, deux exposés, deux reprises, que ce soit en économie, en histoire, en droit ou en relations internationales. On n’en pouvait plus (ça a beaucoup changé depuis). Quand je suis à l’École Lecoq, je découvre une nouvelle traduction de l’Institution oratoire de Quintilien, par Françoise Desbordes. Une traduction qui rend l’auteur antique lumineux pour le lecteur contemporain. Je tombe sur ce passage du XIe livre où Quintilien rappelle que les fondations de la maîtrise oratoire sont les mêmes que celles du jeu de l’acteur, qu’elles passent par l’entraînement physique, la respiration, les exercices vocaux et la gestuelle. Ce qu’on oubliait d’enseigner en France en dehors des meilleurs conservatoires de théâtre et de chant… ou de l’École Lecoq…
Est-ce cette lecture qui a guidé votre projet ?
C’est mon Eurêka. Peu après, je soumets à Richard Descoings (1958-2012) qui avait été mon enseignant à Sciences Po – en droit, en notes sur dossiers – et devenu entre-temps directeur de l’institution, un projet de séminaire pratique qui transmettrait aux étudiants les fondations de l’art oratoire. La même année, alors que j’enseigne au Collège Jean Vilar à La Courneuve, aux pieds de la Cité des 4000, nous lançons les Conventions Éducation Prioritaire qui visent à recruter rue Saint Guillaume des talents venus des territoires défavorisés que l’on n’arrivait pas à recruter jusque-là. Nous étions en l’an 2000. Depuis, près de 2300 élèves venus de plus de 100 lycées ont été sélectionnés par cette voie d’admission. Je ne compte plus aujourd’hui ces anciens étudiants devenus des interlocuteurs, à très haut niveau de responsabilité, qui sont enfants des sans-grades, chômeurs, ouvriers, éboueurs, agents d’entretien, mineurs mis à la retraite d’office à 40 ans car on fermait les dernières mines dans le Nord et en Lorraine. Je n’oublierai jamais qu’en 2001, les détracteurs de la réforme nous opposaient : « Mais un enfant d’ouvrier, ça ne peut pas s’intéresser à la politique ! ». Dans l’enseignement de l’art oratoire comme dans le recrutement, il s’agit de révéler des talents et de restaurer l’égalité des chances.
Dans le rapport (remis le 19 juin 2019) « Faire du Grand Oral un levier de l’égalité des chances », vous insistez sur l’importance de l’oral au cours des études, de l’école au lycée, avançant l’idée que le « Grand Oral » constitue l’aboutissement du parcours scolaire.
L’héritage que nous avons reçu, c’est un oral qui ne fait pas partie des priorités de l’École républicaine, toute focalisée sur le triptyque « Savoir lire, écrire, compter » et ce, depuis plus d’un siècle. Pourtant, parler en public est bien une compétence fondamentale pour réussir dans la vie. Et accessible à tous, pour peu que les techniques en soient enseignées. Un préjugé qui a la vie dure est qu’il s’agirait d’un talent de naissance. C’est ce que disent certains qui ne l’ont jamais enseigné !
Il faut tout réinventer, mais on ne part pas de rien. De la petite enfance à la terminale, il existe des initiatives sur l’oral, menées par des enseignants, parfois par des établissements entiers dans le cadre d’un projet pédagogique ambitieux, mais malheureusement de façon marginale. Lorsque j’effectue des sondages parmi les étudiants de Sciences Po, en leur demandant s’ils ont appris à parler en public à l’école, huit à neuf sur dix me répondent par la négative. Il y a néanmoins ces quelque 10 à 20 pour cent qui ont connu une expérience heureuse et fondatrice à l’école. Il faudrait vérifier si de tels chiffres sont corroborés à l’échelle nationale. Lorsque je collabore avec des rectorats, les équipes de l’inspection sont tout à fait capables d’identifier des pratiques pédagogiques orales, certes minoritaires, mais heureuses, qui ont cours dans certains établissements. Il y a intérêt à commencer par là, établir l’inventaire des bonnes pratiques, les analyser, les faire connaître, inciter à s’en inspirer. Et avoir à l’esprit que si l’on remonte plus loin dans le temps, nous avons connu une tradition pédagogique de l’oral, à l’époque médiévale bien sûr, avec la disputatio, mais de façon plus intéressante encore depuis le XVIIe siècle, avec des progressions pensées sur plusieurs années, particulièrement dans les écoles protestantes, jésuites ou oratoriennes dont il y a aussi des enseignements à tirer.
Certains opposants à la réforme du Grand Oral vous disent qu’un élève de terminale ne sera pas capable de parler debout et sans notes pendant cinq minutes. Je crois qu’ils ne posent pas la bonne question. La vraie question, mais aussi la plus dérangeante pour nous est de nous demander pourquoi des enfants qui, à l’école primaire, sont capables de faire des exposés debout, de dire devant toute la classe des mini-nouvelles dont ils sont les auteurs, de jouer des saynètes de théâtre, de déclamer des poésies avec plaisir, perdent cette faculté pendant les années collège. Quel est ce dispositif pédagogique qui ne nous permet pas d’étayer sur les acquis de l’enfance, d’aider l’adolescent à construire avec méthode ce qui a été découvert dans un esprit de jeu ? Alors oui, dès le collège et le lycée, mais aussi bien avant, dès l’école primaire et la maternelle.
Vous faites référence aux neurosciences, en lien avec le théâtre, notamment à propos des neurones miroirs « avec les neurones miroirs, les neurosciences découvrent ce que le théâtre sait depuis longtemps » (p. 12).
Pouvez-vous développer ce point ? Comment le distinguer d’une pratique ordinaire du mimétisme ?
La formule est de Peter Brook, une autre personnalité majeure du théâtre, qui lui-même a mis en scène L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, adapté du livre du neurologue Oliver Sacks. Le dialogue entre art et science, teinté d’humour, ne s’arrête pas là, puisque Giacomo Rizzolati qui, avec ses équipes, a mis en évidence les neurones miroirs en 1990, cite Peter Brook dès la première phrase de l’ouvrage qu’il a consacré à sa découverte. Je doute que les neurosciences renversent la table dans notre compréhension de la parole et de son partage. Elles nous permettent de comprendre plus précisément ce qui est en jeu. Ce que les hommes de l’art, comme Peter Brook, c’est un fait, pratiquent comme règle de l’art et parfois de façon plus exploratoire depuis des millénaires. L’apprentissage par le mimétisme que vous évoquez, présent partout dans le règne animal et chez le petit humain, s’explique justement en grande partie par la mise en évidence des neurones miroirs. Comment un geste que vous faites, même abstrait, déclenche une stimulation électrique dans mon cerveau comme si moi-même j’effectuais ce geste, peut-être pas de même intensité, peut-être pas en stimulant tous les mêmes neurones mais tout de même. À partir de là, c’est toute la généalogie du langage humain qui peut être revisitée et questionnée et les scientifiques ne se privent pas de le faire. Comment nos ancêtres préhistoriques, accédant à la position debout ont pu joindre le geste à la parole ? Est-ce que le geste a précédé, accompagné ou suivi la parole transitive puis abstraite ?

Un tel questionnement a-t-il des incidences sur votre pédagogie ?
Ce n’est en effet pas seulement un horizon spéculatif. Cette question intéresse aussi le pédagogue. Si mon geste aide l’énonciation et la formulation, ce que des phoniatres et des pédagogues ont compris bien avant que les neurosciences ne le confirment, on saisit bien qu’un enseignement de l’art oratoire s’adressant à des élèves assis ou les mains dans le dos, ou même les bras le long du corps serait stérilisant. Combien de fois des apprenants me disent « Je ne sais pas quoi faire de mes mains, de mes bras ! ». Or, des formateurs qui ont peu de conscience corporelle n’insisteront pas sur la gestuelle, voire, parfois, pour masquer leur ignorance, glisseront la question sous le tapis, diront : « Oh de toute façon, la gestuelle, cela ne s’apprend pas… » ou encore lâcheront : « Quand on est convaincu par ce que l’on dit, le geste vient tout naturellement… ». La vérité est que la gestuelle, comme la voix se travaillent. L’entraînement réveille les potentialités de chacun, libère des habitudes qui nous limitent, qui sont acquises pour la plupart – et non innées -. Comme pour les autres arts, il faut passer par des gammes, et c’est ce qui va nous libérer. Quand le pianiste se sentira-t-il enfin libre dans son interprétation de Chopin ? Dans un autre domaine, la conduite automobile, au prix de combien d’heures d’apprentissage avons-nous acquis une fluidité au volant ? (Si jamais nous l’avons acquise un jour…) Pour la prise de parole en public, la maîtrise s’acquiert beaucoup plus rapidement et aisément. Il s’agit en moyenne de 10 minutes par jour pendant deux ou trois semaines.
Il faut donc s’entraîner, multiplier des exercices, suivre une méthode…
Mon premier ouvrage, Tous orateurs, chez Eyrolles, co-écrit avec Hervé Biju-Duval, dit comment nous envisageons les choses, comment notre pratique de l’enseignement nous permet de dire qu’elles doivent s’envisager : toute personne, avec un minimum d’entraînement, peut parler en public. L’ouvrage est une méthode, présente des mises en situation, des témoignages exclusifs d’artistes comme Alain Souchon ou Jean-Michel Jarre, d’un journaliste, Ali Baddou, et des exercices d’entraînement.
Le dernier né, Je réussis mon Grand Oral du Bac1, s’adresse spécifiquement aux lycéens de terminale. Je l’ai écrit avec Paul Vialard, compagnon de route et pédagogue comme moi. Et une éditrice, Elisabeth Sanchez, aguerrie à l’écriture de manuels scolaires. Nous avons consacré neuf mois à le composer, à l’écrire et le réécrire – Vingt fois sur le métier… – à l’illustrer, tant l’enjeu de s’adresser au public des élèves, de leur donner les clefs pour parler en public requérait d’être méthodique et précis. L’ouvrage est conçu comme un vade-mecum pour le Grand O, je pense dense, technique et sérieux, tout en étant accessible à tous. Il détaille les enjeux de l’épreuve et de sa préparation, mais a aussi pour objectif de permettre à l’élève de construire étape par étape sa compétence de parler en public. Il présente ainsi une centaine d’entraînements progressifs. Si l’élève conserve ce livre dans sa bibliothèque au-delà de l’année de terminale, parce qu’il estime que cette méthode lui sera toujours utile, nous aurons gagné notre pari pédagogique.
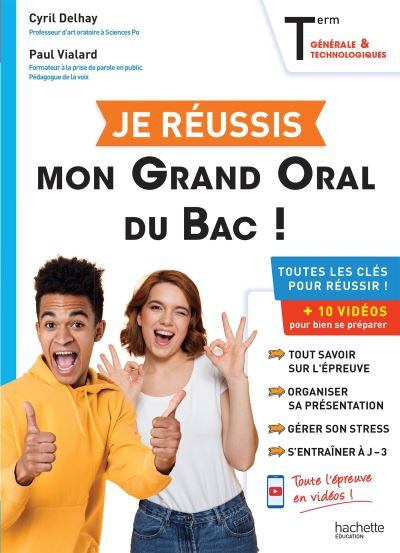
Enseigner l’oral cela ne demande-t-il pas du temps, un apprentissage continué ?
De combien d’heures d’enseignement jouit un élève, de la maternelle à la terminale ? Un paquet compris entre 12.000 et 15.000 heures. C’est juste colossal. Pour ce qui est de l’oral, quelques heures suffisent pour s’approprier les fondamentaux. Une demi-journée en demi-classe. Il y a très peu de prérequis. Certains linguistes et sociologues vous diront le contraire, opposant l’argument du biais social – qui existe – comme une fin de non-recevoir. Ils ne parlent en réalité pas de la même chose. Ils se focalisent sur la linguistique et la maîtrise lexicale, au lieu de considérer l’enseignement de l’oral et ses fondations. On ne peut pas leur en vouloir dans la mesure où cet enseignement de l’oral, ils ne l’ont pas eux-mêmes rencontré. Je crois qu’ils écrivent cela en toute bonne foi, mais dans une connexion très fragmentaire avec le réel. Si vous relisez attentivement Marcel Mauss et Pierre Bourdieu, vous constaterez que les fondateurs ont bien évoqué l’oral comme une technique du corps. Cela pourrait mettre la puce à l’oreille. L’oral est une praxis.
C’est à dire…
C’est une pratique sur soi en relation avec les autres et un processus. La plupart des enseignants de l’oral s’adressent à des publics de tout âge, de toute condition sociale, avec les mêmes résultats, des progrès très rapides de l’apprenant, une maîtrise des fondamentaux en quelques heures. Je travaille régulièrement avec des personnes en situation de handicap. Un collègue et ami vient d’animer un séminaire pour des personnes nées avec une trisomie 21. J’ai encore à l’esprit l’exemple de cette clinique psychiatrique où chaque année, patients et personnels soignants préparent et jouent ensemble une pièce de théâtre : chacun va le chemin, personnel et collectif, semé d’embûches bien sûr, mais qui emmène plus loin. L’oral est le plus inclusif des modes de transmission et d’interaction que je connaisse.
Quel rapport voyez-vous aux apprentissages de l’écrit ?
L’écrit et l’oral sont les deux jambes d’une éducation équilibrée. Il est funeste qu’en France, on ait cru pouvoir éduquer les élèves en leur demandant de courir à cloche-pied, en concentrant l’essentiel des apprentissages sur l’écrit. Je vous ai parlé tout à l’heure de ces écoles primaires où les enfants déclament et interprètent de la poésie. Mais imaginons que la récitation d’une poésie ne soit associée qu’à un exercice de mémorisation. Je récite par cœur et, de fait, je m’arrête au milieu du gué sur le chemin de l’oral. Car le plus intéressant ne vient-il pas après, lorsque l’enfant pourra mettre en jeu sa sensibilité pour interpréter le poème ou la fable ? Au moment où il pourra réellement nourrir son goût de la langue et les interactions avec l’auditoire.
Votre projet, votre démarche sont politiques en même temps qu’éducatifs ?
Il y a dix ans, j’ai publié une tribune dans Le Monde intitulée « Savoir lire, écrire, compter et… parler en public » (parue le 20 octobre 2011). J’enseigne l’art de la parole depuis vingt ans. À la fin de l’année 2020, j’aurais accompagné près de 8000 personnes dans l’acquisition de cette maîtrise fondamentale. Cela peut paraître beaucoup, mais sur vingt ans, ce n’est pas tant que cela. Et si l’on pense aux 67 millions de Français… Oui, c’est un combat.
Il s’agit bien d’un projet politique, une affaire de la cité : donner la capacité de parler en public à tous. Voilà bien une réforme de société, et je ne crains pas de le dire, aussi radicale et progressiste que celle des congés payés sous le Front Populaire, de l’IVG ou de l’abolition de la peine de mort. Une réforme qui concerne aujourd’hui 12 millions d’élèves. Mais je souhaite relativiser le « vous » que vous m’adressez. S’il renvoie à un individu solitaire que je serais, je le récuse. C’est par un prisme trompeur que l’on croit aux réussites individuelles et que l’on oppose la personne au collectif. L’enseignement de l’oral en France ne peut réussir que dans une dynamique collective. J’insiste sur ce point, non par humilité ou par fausse modestie, mais parce que c’est la réalité et parce que le politique naît de ce collectif.
Enseigner ou pratiquer l’oral c’est construire du collectif avant tout ?
Je crois que si, en France, on était davantage attentifs aux conditions de réussite des collectifs, et ce, dès l’école, on ferait des pas de géant. Dans notre histoire récente, on l’a constaté de façon magistrale dans notre façon de répondre à la crise sanitaire qui n’a commencé à être satisfaisante qu’à partir du moment où l’on a restauré le collectif. Les grandes réussites, qu’elles soient économiques, sociales ou artistiques ne sont que collectives. Que serait devenu Picasso sans sa rencontre avec Georges Braque et tant d’autres ? Je vous ai parlé tout à l’heure du creuset dans lequel s’est construit Jacques Lecoq. Revenons à l’enseignement de l’oral qui est une aventure collective. Je ne suis moi-même qu’une personne parmi d’autres pour la porter. Ce n’est pas moi qui ai pris l’initiative de la mission ni qui ai pris la décision du Grand Oral.
Comment s’est concrétisé ce collectif à Sciences Po ?
C’est un compagnonnage sur 20 ans. Une équipe portée au fil du temps par une trentaine de personnes, des universitaires, des comédiens, des chanteurs lyriques, des chorégraphes, qui a mis au pot commun pour spécifier les séquences pédagogiques les plus utiles pour enseigner l’art de la parole à des publics divers. Des universitaires canadiens et suisses, spécialistes en sciences de l’éducation, nous ont également donné de très précieux conseils. Sciences Po est lui-même le creuset qui a permis ces rencontres et l’exploration de cette pédagogie. L’actuel directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, ne m’en voulez pas de lui rendre hommage, ce n’est que justice, s’est intéressé de près à ce que nous proposions, nous a fait confiance et a tout fait pour accompagner cette innovation. Il a ainsi créé un Centre d’Écriture et de Rhétorique à Sciences Po au sein duquel nous avons pu nous déployer. Si on ne fait pas confiance à une innovation, si on ne l’accompagne pas dans la durée, elle meurt ! Au-delà de Sciences Po, le rapport de préconisations sur le Grand Oral est encore le fruit d’une intelligence collective qui s’est cristallisée au printemps 2019, où les équipes du ministère et de l’inspection générale ont joué un rôle déterminant.
Convaincre, séduire, captiver un auditoire : quel sens donner à ces verbes ? Qu’en est-il de la dimension « sincère » du message et dans un contexte scolaire du « penser par soi-même », de porter sa propre parole, son ethos, fruit d’une maturation et d’une instruction comme vous le soulignez vous-même ?
Cette question est tout à fait fondamentale. Comment favoriser la parole propre de l’élève à la faveur du Grand Oral qui est aussi un oral de maturité pour reprendre la formule de Pierre Mathiot. Certains, reproduisant ce qu’ils ont eux-mêmes connus, rêvaient d’en faire un petit oral d’agrégation. Inutile de dire que si l’on transforme le Grand Oral en interrogatoire de connaissances et que l’on fait des jurys des juges de touche, on n’aura rien accompli et on ira droit dans le mur. Le plus intéressant pour le jury est de se positionner comme accompagnateur, plus du côté de la maïeutique socratique que du quizz. Le jeune adulte en face de moi, comment puis-je l’aider à aller plus loin dans sa réflexion sur sa question et sur son projet ? Ce regard exigeant mais bienveillant est indispensable pour susciter un échange de qualité. Mais il ne suffit pas.
Il y a aussi ce qui se joue du côté de l’élève…
Exactement. Et bien en amont, dès le choix des questions par l’élève. Là se jouera déjà 50 % du succès pour chacun. Une idée géniale (et je peux d’autant mieux le dire qu’elle n’est pas de moi) est que le lycéen doive articuler le choix de ses questions à une réflexion sur son parcours et ses souhaits d’orientation. Si le lycéen part de lui-même, de sa curiosité, de la façon dont il se projette pour définir sa question, avant de chercher le lien avec le programme de spécialité, nous sommes dans la bonne dynamique.
Cela n’est-il pas garanti ? La démarche projet s’inscrit dans cette perspective…
L’expérience nous a appris le contraire. Si l’élève est incité à choisir parmi une liste de 30 sujets établis à l’avance par l’enseignant, comme cela s’est vu lorsque la pratique des TPE était dévoyée, ou pis encore, parmi des sujets glanés ou achetés sur internet, on a peu de chance de susciter son adhésion au projet éducatif du Grand Oral. Permettez-moi de prendre un exemple personnel. À l’automne dernier, j’ai effectué à la demande d’un chef d’établissement, un pilote avec une trentaine d’élèves de première. À 8 h, la plupart étaient dans le brouillard pour le choix de leur sujet et pour tout dire, très peu motivés. L’un d’eux était même assis de travers m’opposant presque son dos, signe qui ne trompe pas un enseignant en début de séance.
……
J’ai d’abord voulu sauver ma séance. Nous étions début novembre. Je ne connaissais rien du texte officiel qui est sorti en février. Je leur ai dit : « Partez de vous, pas du programme de spécialité, après on verra ». Puis nous avons partagé les fondamentaux (la posture, le regard, la respiration) de façon à ce qu’ils aient les repères pour parler debout devant les autres, objectif pédagogique de la session, à la fin de la matinée. À la pause de 10 h, le même qui me tournait le dos vient me trouver. Il me dit :
« Je fais du basket, en fait, je suis même basketteur de haut niveau. Est-ce que vous pensez que je peux faire quelque chose sur « le corps du basketteur » ?
– C’est-à-dire ? je lui demande.
– Eh bien, quelle est la part de l’inné ? la part due à l’entraînement ? Existe-t-il des normes concernant ce corps du basketteur ? »
J’ai évidemment trouvé la proposition excellente. Comme ce lycéen envisageait une spécialité en SVT et en Physique, les passerelles avec le programme étaient massives : le génome, l’analyse du mouvement, etc. Ce jour-là, à l’issue de la session, les 30 élèves de première étaient capables de parler pendant 1 à 3 minutes du sujet qu’ils avaient choisi, debout devant les autres. Et cela avant les dizaines d’heures de travail que requerra la préparation du Grand Oral. Je crois que dans l’ensemble, les élèves et les enseignants peuvent être confiants dans ce choix personnel de départ. Cela peut faire peur bien sûr. Comme enseignant, on se dit qu’on ne maîtrisera pas tous les sujets, etc. En vérité, on va gagner un temps considérable, tout simplement parce que l’élève sera motivé et que l’on aura simplement à l’accompagner.
Ne craignez-vous pas de voir fleurir des sujets fantaisistes et/ou de peu d’intérêt ?
Il y a bien sûr une contrepartie au choix du sujet par l’élève et que les enseignants de spécialité auront bien sûr à valider. Outre le lien avec le programme qui va inciter l’élève à s’en enquérir de façon active, il y a l’étape fondamentale de la documentation. De la qualité de celle-ci dépend la qualité du travail qui suivra et qui pourra mûrir sur de longs mois. Recueil de données, sitographie, bibliographie. Plus que jamais les CDI seront le poumon du lycée. Il est donc tout naturel que les textes officiels aient prévus que les professeurs documentalistes qui sont responsables de la formation des élèves à l’information-documentation, à l‘éducation aux médias et à l’information puissent faire partie des jurys.
La distanciation physique en situation de pandémie ne fait-elle pas écran à l’interaction ? Ne nous amène-t-elle pas à revoir l’approche ?
Vous m’auriez posé la question en février, je vous aurais répondu qu’il était impensable d’enseigner la prise de parole en public à distance. Et puis… le confinement est venu… Comme les autres collègues, j’ai été mis au défi de m’adapter. Au total, j’ai donné une cinquantaine d’heures d’enseignement à distance en art oratoire, de fin mars à fin avril, à des étudiants qui participaient simultanément au même cours, qu’ils soient en France, au Liban, aux États-Unis ou en Asie. Et j’ai constaté que cela fonctionnait très bien. Tout simplement parce qu’il s’agit d’une pédagogie active et que les outils numériques mis à disposition permettent les interactions. Alors, oui, il faut d’emblée envisager des formations à distance, non seulement en prenant en compte le risque d’un nouveau confinement, mais tout simplement parce que désormais, avec ou sans pandémie, les élèves auront à être éloquents en présentiel comme dans la réalité virtuelle. Animer un webinaire, se présenter par une vidéo, participer à un entretien à distance ne s’improvise pas. Comme pour le reste, il y a des techniques à connaître et des apprentissages à construire.
La rentrée, c’est la reprise, après plusieurs mois d’interruption ; la priorité peut-elle être sur l’oral alors que la question de la remédiation est aussi posée ?
Il y a bien sûr la question de la distanciation physique et des préconisations sanitaires à respecter qui vont sans doute continuer à varier dans le temps et selon les territoires. Mais la crise sanitaire ne signifie pas une injonction soudaine à se taire. Je crois au contraire qu’après ces longs mois d’interruption, pour certains élèves dont la scolarité en pointillés a pu commencer dès décembre 2019, l’oral est stratégique. L’enjeu est bien de retrouver une dynamique de classe, la confiance et la bienveillance qui permettront de travailler. L’erreur serait de se précipiter sur les programmes comme s’il ne s’était rien passé. Ce qui s’est produit est majeur et a concerné, dans le monde entier, toutes les générations. Il y a un intérêt à partir de là. Cet événement, comment les élèves l’ont-ils vécu ? Qu’en pensent-ils ? Qu’ont-ils à en dire ? La parole et la qualité d’écoute qui l’accompagnera, on le sent bien, vont être décisives. Si vous profitez de ce moment, pour partager en une demi-journée, les techniques fondamentales pour l’oral (posture, respiration, regard, présence vocale, relation à l’auditoire), vous donnez aux élèves une compétence nouvelle. Ils en constateront l’effet sur eux quasi immédiatement, ils vous en seront reconnaissants. Nous nous donnons les moyens, en une demi-journée, de remettre tout le monde le pied à l’étrier.