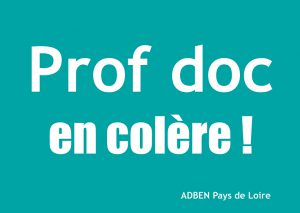Lors de la recension relative au phénomène bureaucratique de Michel Crozier5, je rappelais que l’Éducation nationale est une administration d’État, tout à la fois décentralisée avec l’intervention des collectivités locales, mais aussi déconcentrée avec le rôle important de transmission et de direction locale des Recteurs et des Directeurs Départementaux de l’Éducation nationale sur le plan de la hiérarchie administrative et des Inspecteurs de l’Éducation nationale, des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux et des Inspecteurs Généraux de l’Éducation nationale en ce qui concerne la hiérarchie pédagogique. Ceci explique le lien avec le livre Histoire de l’administration de 1750 à nos jours6, paru durant une année capitale et agitée, 1968 à une époque où l’État et la centralisation des services de l’État étaient violemment contestés au sein même de ses structures. Michel Crozier expliquait comment la bureaucratie7 perdurait alors que le Club Jean Moulin8, 9, 10, 11 à travers des ouvrages de référence, posait la question des rapports inégaux entre l’État et ses citoyens12 ainsi qu’entre un Paris tout puissant et des provinces13 sans réels pouvoirs de décision.
En 580 pages d’une écriture très dense, Pierre Legendre balaie plus de deux siècles d’histoire de la France et de son administration à travers les guerres civiles et étrangères, les révolutions, la monarchie, les deux empires, le régime de Vichy et les cinq républiques qui se sont succédées dans notre pays. Le livre est divisé en trois parties qui s’articulent en titres ou chapitres.
L’introduction interroge tout à la fois l’histoire du droit et la science administrative. Affecté par leurs divergences passées, Pierre Legendre souhaite les rapprocher, puis les conjuguer ensemble de façon à établir une histoire de l’administration française sur le long terme. Dès lors, l’auteur cite dix-huit fois dans cet ouvrage Alexis de Tocqueville, haut fonctionnaire et observateur attentif de l’État et de son administration au XIXe siècle14, qui a démontré la continuité de l’administration française de l’ancien régime monarchique jusqu’à nos jours, Républiques, Empires et monarchie constitutionnelle. Pierre Legendre, souhaitant échapper tant aux limites de l’histoire du droit qu’à celles de la science administrative, établit dans son introduction un protocole historique et théorique intriquant de nombreuses disciplines universitaires.
Genèse
Cette première partie traite de la spécificité du mode national d’organisation à travers le temps et l’espace.
L’œuvre du temps
Le premier chapitre part du constat que le processus d’évolution de l’administration française sur le long terme reste celui d’un accroissement continu. Selon notre auteur qui reprend la thèse d’Alexis de Tocqueville, il n’y a point de rupture entre l’administration de l’ancien régime et celles qui lui succèdent depuis 1789. Deux questions essentielles apparaissent alors : Quel doit être le rôle de l’État ? Et sur quelle forme d’administration peut-il s’appuyer ?
L’auteur retrace la trajectoire historique de l’administration de 1750 à 1950. Il se refuse à entériner le mythe d’une scission nette apparue durant la Révolution française. Au contraire, il reprend l’histoire de France pour montrer les liens entre le passé national et l’évolution administrative en intégrant les facteurs économiques, sociaux et politiques. La France ayant accumulé un grand retard technologique et économique durant la Révolution industrielle a eu besoin d’une administration
de plus en plus puissante pour rattraper ce retard face à une Grande-Bretagne, puis à une Allemagne bien plus avancées dans ces deux domaines. L’État, en France, a utilisé deux moyens pour parvenir à ses fins : une économie performante et une technologie de pointe. Il a assuré la coexistence de différents types d’entreprises au sein de l’économie nationale protégeant le marché intérieur par un vigoureux protectionnisme via une police douanière puissante, un interventionnisme constant et le développement d’un secteur public bien souvent prépondérant.
Ce même secteur public a aidé le pays à combler son retard technologique. L’administration représente la permanence alors que le monde politique est plutôt en position instable. L’administration normalise le changement, car les Français croient à la puissance transformatrice des lois. Cette réflexion sonne particulièrement juste en ce qui concerne l’Éducation nationale qui ne cesse d’inspirer nos ministres, ces derniers voulant laisser une trace dans le marbre de la loi. D’ailleurs, le Conseil Constitutionnel et le Sénat s’interrogeaient récemment sur cette inflation législative qui rend la loi complexe et instable15. L’État est producteur d’une sociabilité traduisant tout à la fois les concepts d’égalitarisme et de liberté. Mais cet État s’appuie sur une administration centralisée puissante capable de réduire la concurrence des pouvoirs. Les chutes des divers régimes depuis deux siècles et demi s’expliquent par cette demande d’un État puissant et le refus des Français d’un pouvoir personnel. Pourtant la centralisation n’est pas l’apanage de Louis XIV ou de Napoléon, mais la résultante de la longue histoire du pouvoir central parisien et de son administration depuis le Moyen-Âge. Cet état de fait crée des blocages, car l’innovation au sein du système administratif reste perçue comme « un mal à éliminer », alors que cette même administration souhaite faire évoluer le pays. Le Plan devint l’outil privilégié permettant aux politiques et à l’administration d’impulser la modernisation. Cette évolution s’est effectuée après des nombreuses confrontations idéologiques entre libéraux et centralisateurs, entre libéraux et marxistes. Avant le second conflit mondial, la montée du corporatisme de droite porté par Maurras et celle d’une solution par le socialisme marxiste se neutralisèrent au sein du système administratif. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale a favorisé l’émergence de conceptions technocratiques qui considèrent le passé et les traditions comme des éléments néfastes freinant toute évolution nécessaire16.
La maîtrise de l’espace national
Cette maîtrise est une donnée fondamentale autour de laquelle les hommes politiques et les administrations ont tenté avec la Révolution française de répondre scientifiquement. C’est ainsi que sont nés les départements et les communes. Aujourd’hui encore, en dépit de la volonté de décentraliser et de réduire les dépenses, le pouvoir recule devant la suppression du département tant ce dernier a acquis une forte légitimité auprès des Français comme le reconnaissait, en 2013, Marylise Lebranchu, Ministre de la réforme d’État, et de la décentralisation17.
Morphologie : Les tâches de l’Administration
La deuxième partie permet à Pierre Legendre de distinguer deux grandes périodes, l’État paternel et l’État-Providence avec le premier conflit mondial comme césure. Cinq points consacrés au rôle de l’État émergent.
La guerre et la paix
La défense nationale et la diplomatie occupent la première place des tâches de l’administration française. Il faut dire que notre pays a été engagé et reste engagé dans de nombreux conflits. L’administration maintient la tranquillité publique et « l’ordre social » qui s’entend comme un équilibre. Il sera ici question de la police et de la Justice en tant qu’organisations. Enfin, l’évolution du social passe de la bienfaisance à la création de la Sécurité sociale.
La religion
Bien évidemment, cette section est importante car elle évoque les concordats de 1516 et de 1801 qui consacrent une religion d’État, le catholicisme. Durant le XIXe siècle, les républicains préparèrent la séparation de l’Église et de l’État. Les lois dites de séparation votées entre 1905 et 1907 imposèrent l’avènement d’un État laïc se fondant sur une idée essentielle « la religion est une affaire privée ».
La distribution des lumières
Cette troisième section nous intéresse tout particulièrement, puisqu’il y est question de l’Instruction publique. L’État est investi d’un magistère et d’une mission, morale. Selon Renan « L’État met la main sur l’âme ». En fait depuis Napoléon, l’État remplace l’Église et agit en chef d’école autoritaire. La France est le seul pays développé dont l’État possède le monopole de l’enseignement, imposant ses méthodes à l’enseignement public et à l’enseignement privé sous contrat, soit l’immense majorité des établissements scolaires. Selon l’auteur, cette structure monopolistique rend illusoire les essais de libéralisation interne car la logique centralisatrice génère l’uniformité. Pierre Legendre considère les enseignants tel un clergé laïc reprenant de la sorte la formule de Péguy : « les hussards noirs de la République18 ». Le système d’enseignement se veut égalitaire, mais comme le remarque l’auteur, le savoir technique est méprisé et tenu à la marge du système. Pierre Legendre remarque que la concurrence scolaire entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat (catholique) a souvent paralysé l’évolution du système scolaire et que la loi Debré de 1959, si elle autorise la prise en charge financière des enseignants de l’école catholique par l’État, permet à ce dernier un contrôle accru de cet enseignement par ses services. L’enseignement est organisé pour transmettre les valeurs reconnues de la société française. Un point doit être mis en exergue, selon l’auteur, jusqu’en 1968, l’enseignement supérieur, lors des concours de cooptation et l’enseignement secondaire par la culture demandée lors du Capes et de l’agrégation auraient été réservés aux jeunes issus de classes aisées. Pierre Bourdieu, vingt et un ans plus tard qualifie les enseignants de « petits blancs » de la culture19 : confrontation d’idées et de constats divergents, mais très intéressants.
L’État-Providence
L’État-providence montre pourquoi, depuis 1919, l’État a évolué et comment la mythologie contemporaine l’a investi d’une capacité illimitée à répondre aux désirs individuels, à distribuer à chacun selon ses besoins et à apporter le bonheur pour tous.
Mass-médias
Enfin, Pierre Legendre aborde le problème de l’introduction des mass-médias dans la société française et parle de technique d’acculturation à propos de la révolution audio-visuelle.
L’unité du système
La troisième et dernière partie, très courte, en forme de conclusion, permet à P. Legendre d’expliquer comment l’administration française est la fille d’une histoire compliquée, mais aussi l’héritière culturelle de la Révolution française. L’administration est soumise à la loi et l’applique dans un pays où les individus ont mis leur confiance dans les lois. Cependant, l’inflation législative paralyse le système et pose des problèmes d’interprétation qui engendrent la défiance. Finalement l’idéal de 1789 et les droits de l’homme et du citoyen résistent aux assauts du temps, des guerres et des idéologies. Toutefois, l’administration française est une organisation bureaucratique influencée par l’apport fondamental de la monarchie : l’absolutisme d’une Administration monarchique.
Je termine cette recension par un retour au Club des citoyens qui prévoyait, dès 1964, une France des 12 régions. Un demi-siècle plus tard, cette prédiction se réalise. Cependant, Pierre Legendre qui appelait une réforme de l’État et de son administration, parle aujourd’hui de « Fantômes de l’État en France »20 car l’État introduit le management qui tend à l’amoindrissement, voire à la suppression du pouvoir étatique. Effectivement, l’idéologie managériale et son vocabulaire s’étendent remarquablement au sein de l’Éducation nationale, ne serait-ce que sur le plan de la gestion des établissements scolaires et de leur personnel21.