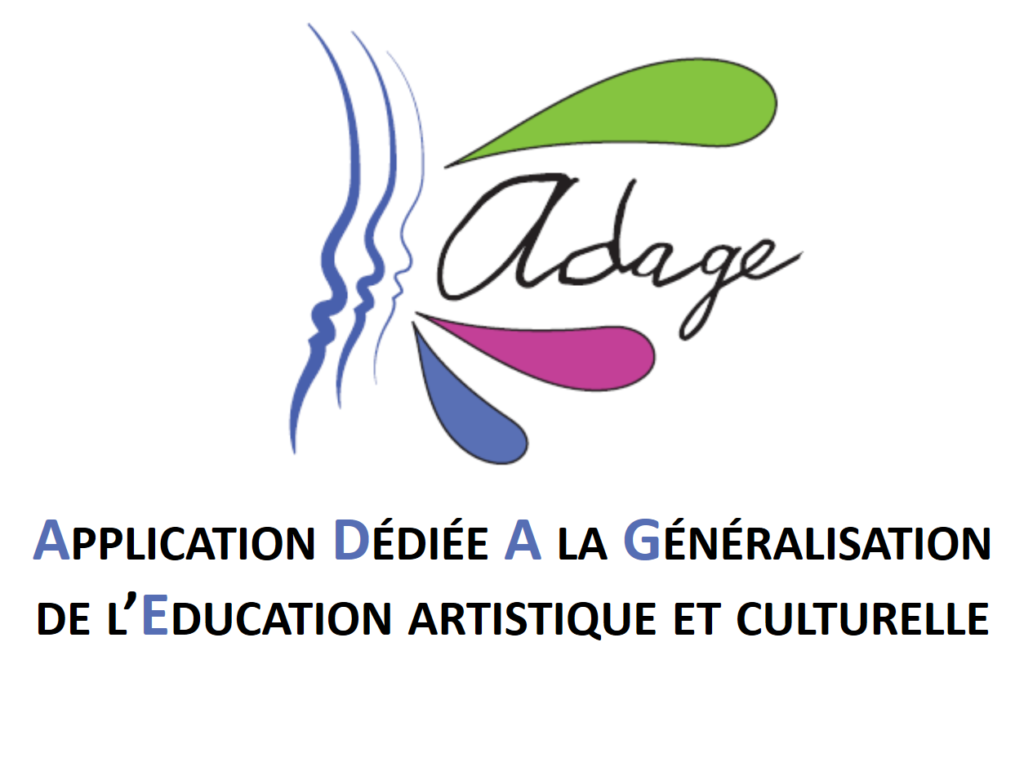Adage est une plateforme numérique dédiée à l’Éducation artistique et culturelle (ÉAC) qui se constitue progressivement en une porte d’entrée pour tout enseignant du premier et du second degrés désireux de mener des projets artistiques et culturels, de les recenser et de bénéficier de financements au moyen de campagnes d’appels à projets ou d’offres pass Culture collectives1. Après le déploiement de Pix, Parcoursup, Pronote et des ENT, Adage ne vient que confirmer le phénomène de plateformisation de l’éducation et l’injonction faite aux enseignants de « se mettre » au numérique. Comprendre le fonctionnement de ces plateformes et maîtriser leurs contenus avant de bénéficier de leurs potentiels exigent des efforts, des compétences et du temps. Dédiée à la culture, Adage est accessible via Eduline par tous les enseignants. Pour en savoir plus sur cette plateforme et ses implications sur le terrain de l’établissement scolaire, nous nous sommes entretenue avec la référente culture coordonnatrice du dispositif dans son académie. Silvana Bonura nous livre ici sa vision d’Adage et des enjeux que cette plateforme soulève pour les enseignants.
Depuis 2019, tu es référente culture de bassin. L’arrivée des plateformes numériques dans le champ éducatif facilite et complexifie à la fois la tâche des enseignants d’autant plus qu’elles se constituent en une porte d’entrée incontournable. Cette injonction à passer au numérique se traduit par un enchevêtrement de dispositifs qui, selon moi, crée une sorte de brouillage sur le terrain de l’établissement scolaire. Avant de te demander en quoi consiste ta fonction de référente culture de bassin, pourrais-tu préciser l’origine de cette « nouvelle » plateforme d’accès à la culture nommée Adage ?
Réponse : La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 rend obligatoire le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’école au lycée (PÉAC) dont l’objectif est de « […] favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture2 ». Cette loi inscrit quatre parcours éducatifs obligatoires : le Parcours Avenir, le Parcours Citoyen, le Parcours Santé et le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle3. Depuis 2019, Adage est l’objet d’une expérimentation dans notre académie par quelques établissements scolaires dont le mien, jusqu’à sa généralisation en 2021. À l’époque en 2019, il n’y avait sur Adage que la partie recensement des enseignements, des projets et actions en ÉAC. Ensuite, en 2020, l’onglet « monter son projet » est apparu pour les campagnes d’appel à financement et des projets bien précis (Jeunes en librairie, Printemps des poètes, Invitation au voyage, Atelier de pratique artistique et culturelle, etc.). Depuis janvier 2022, des offres pass Culture collectives ou établissements proposées par les structures culturelles pour les collèges et lycées sont disponibles sur Adage. En deux ans, plusieurs fonctionnalités ont donc été ajoutées sur Adage.
La notion de « parcours » n’est pas anodine. Elle suppose une trajectoire unique, pour l’élève. Une responsabilité plus grande pèse sur les enseignants qui se doivent désormais d’amener l’élève du début à la fin du « parcours ». Quelle est l’origine de cette politique culturelle en faveur du pass Culture ? Cette question mérite d’être posée puisque cette politique induit l’arrivée de dispositifs numériques sur le terrain de l’établissement scolaire.
R : Fournir un crédit culture pour tous les jeunes de 18 ans est une décision politique qui figurait déjà dans le programme de campagne du président Macron en 2017. L’idée était de permettre aux jeunes d’accéder gratuitement à la culture. Depuis mai 2021, le pass Culture individuel concerne tous les jeunes de 18 ans, et depuis janvier 2022, tous les jeunes scolarisés en collèges ou en lycées entre 15 et 17 ans. Quant au pass Culture collectif ou établissement, il concerne les élèves de la 4e à la terminale depuis janvier 2022. Ces établissements scolaires reçoivent un crédit virtuel en fonction du nombre d’élèves. C’est une politique conjointe Ministères de la culture/Éducation nationale. Il y a une volonté forte de l’État de faciliter l’accès à la culture par la « généralisation4 » de l’ÉAC. Le pass Culture s’inscrit dans le cadre du 100 % PÉAC. Il y a derrière ce dispositif un souci d’équité et d’égalité d’accès à la culture pour tous les élèves. Adage répond à la volonté d’uniformiser et de rendre visible les actions culturelles à l’échelle d’un établissement et d’un district, puis du département et d’une académie. Le recensement des actions culturelles sur la plateforme permet cette visibilité.
En quoi cette plateforme change-t-elle la donne pour les professeurs documentalistes selon toi ?
R : Au niveau des établissements scolaires, ce qui change c’est d’avoir un crédit assez conséquent par établissement pour financer des projets, des ateliers et des sorties artistiques et culturelles. Nous passons en direct avec les structures culturelles, ce qui signifie qu’il n’y a plus de bons de commande et de factures à demander. Le chef d’établissement valide ensuite tous les projets pass Culture sur Adage. Ce qui change pour nous, et ce qui est fastidieux aussi, c’est de comprendre la plateforme en entrant dans le bon onglet : choisir « offre pass Culture », trouver une offre qui convienne à son projet ou en créer une en partenariat avec une structure culturelle, par exemple. L’arrivée d’Adage n’est pas sans poser de questions au sein des établissements scolaires. Qui est rédacteur des offres pass Culture ? Qui se charge de préserver ces offres sur Adage ? Qui se charge de recenser les actions pour en tirer un bilan ? Le référent culture ou le professeur de la classe ? Ou tout autre personnel à l’initiative de l’action culturelle ? Si c’est le référent culture qui se charge de recenser toutes les actions sur Adage, il faut expliquer cette « nouvelle » tâche aux chefs d’établissements ainsi que la charge de travail supplémentaire qu’elle induit afin d’obtenir au moins une IMP « référent culture » complète. Et s’il y a deux référents, comme c’est le cas dans mon établissement, alors deux IMP complètes5. La tâche de référent culture est précisée dans une lettre de mission. À partir du moment où l’on accepte la mission, il faut discuter aussi la question de la rémunération. Adage permet un recensement synthétique des actions culturelles de nos établissements. En tant que référente culture, j’effectuais déjà ce travail avant Adage, sur un tableur, pour faire le bilan culturel à présenter en fin d’année au Conseil d’administration (CA). Adage me permet maintenant d’avoir un recensement uniforme et des statistiques par niveau et par partenaire culturel. Adage offre enfin la possibilité d’éditer des attestations individuelles de PÉAC pour chaque élève et de valoriser les parcours (onglet « Suivi des élèves » dans Adage). L’objectif du PÉAC reste l’équité pour tous les élèves.
Si l’objectif du PÉAC reste l’équité pour tous, ne s’agit-il pas d’un idéal plutôt que d’un véritable objectif atteignable ? Tous les élèves d’un établissement scolaire ne sont pas logés à la même enseigne puisque les apprentis et les étudiants, dans les lycées, ainsi que les élèves de 6e et de 5e, dans les collèges, ne bénéficient pas de l’offre pass Culture. En outre, est-ce que les membres de la direction d’un établissement scolaire valident les offres culturelles en tenant compte de ce principe d’équité ?
R : Adage, c’est justement un outil qui aide à la visibilité des activités des classes de la 4e à la terminale et permet de tendre vers l’équité puisque tous les élèves ont une somme allouée de manière équitable. Mon rôle est d’accompagner les référents culture et les collègues, y compris les chefs d’établissement qui me demanderaient des conseils concrets d’utilisation d’Adage.
Justement, tu es référente culture coordonnatrice de bassin pour la culture. En quoi consiste ta mission ?
R : Au départ cette fonction de coordonnatrice n’était pas uniquement pour Adage, mais pour chercher de nouveaux partenaires, de nouvelles structures culturelles, faire remonter les besoins culturels et réfléchir à la mise en place d’une politique culturelle en partenariat avec la DAAC6. Depuis deux ans, date de son arrivée, Adage a pris beaucoup de place. J’ai été nommée par la DAAC en 2019. Je suis le relai des référents culture en établissements scolaires. Ma mission complète celle des formateurs de la DAAC : réfléchir aux offres culturelles d’un territoire, anticiper les besoins de formations culturelles, connaître de nouveaux domaines ou de nouveaux lieux de culture, réfléchir aux appels à projets et aux financements de la DAAC. Je suis chargée de répondre aux mails, aux appels téléphoniques, aux interrogations des collègues face à Adage et au pass Culture. J’essaye de les former au mieux à ces dispositifs. Pour assumer cette fonction, il faut être référent culture de son propre établissement scolaire. Je suis rémunérée une IMP pleine par an environ.
Comment les enseignants recoivent-ils ces nouvelles directives sur le terrain, ce « passage obligé » par Adage ? Quels échos en as-tu en tant que référente culture coordonnatrice de bassin ?
R : Cela varie. De l’indifférence ou du rejet quant au recensement des actions sur Adage. J’entends les collègues dire : « encore un nouvel outil, on nous demande trop de compte, outils de flicage, je n’ai pas le temps de recenser, pas payé pour…». Adage pose également la question des compétences numériques car la plateforme est complexe. Il faut un temps pour la comprendre. Ce qui remonte du terrain, ce sont les problèmes techniques pour valider des offres pass culture, comprendre les différents onglets d’Adage ou le référencement d’une structure culturelle partenaire avec laquelle les professeurs documentalistes ont l’habitude de travailler par exemple. Certaines structures partenaires sont refusées dans Adage. Certains enseignants ont la volonté de comprendre cette plateforme et voir comment on peut en tirer profit pour la mission de référent culture : pour faire des bilans, des statistiques, pour acquérir une compétence supplémentaire, observer concrètement les actions culturelles dans l’établissement grâce à un outil visible par tous les personnels. C’est aussi ce que permet Adage. Si on ne s’y intéresse pas, on sera vite dépassés par ces plateformes. Si l’on ne sait pas qu’il y a de l’argent pour la culture, ni comment aller sur Adage et l’utiliser, comment pourra t-on monter des projets culturels ou des sorties à l’avenir ?
À qui donne-t-on les droits d’accès sur Adage ?
R : Il y a un accès administrateur pour les chefs d’établissement et un accès rédacteur. Tout le monde peut être rédacteur qu’il soit référent culture ou pas. Cela se décide dans chaque établissement. Enfin, il y a un accès lecteur pour tous les autres.
Qu’est-ce qu’Adage et pass Culture changent pour les professeurs documentalistes, selon toi ? Quelles sont les évolutions que tu ressens ?
R : Le risque est que la gestion du pass Culture et le recensement des actions reposent uniquement sur les professeurs documentalistes référents culture pour des raisons entendues chez certains collègues et personnels de direction : les professeurs documentalistes ont l’habitude et le temps de rédiger des bilans, de répondre à des appels à projets, de créer des partenariats culturels, de planifier et réserver des sorties, de faire de la gestion culturelle en quelque sorte ! Face au risque pour le professeur documentaliste référent culture de devenir « gestionnaire et prestataire de sorties et actions culturelles » de l’établissement, il y a quand même des avantages. Adage peut-être un levier pour les professeurs documentalistes désireux de s’investir dans le domaine culturel avec de vrais outils à disposition pour être reconnus dans ce domaine en tant qu’experts et interlocuteurs privilégiés. Des collègues aiment travailler dans ce domaine et font des formations pass Culture aux élèves et aux collègues enseignants. Ils développent une politique culturelle de l’établissement concrète, présentée aux conseils pédagogiques et/ou au CA.
Si la plateforme Adage promeut des valeurs de visibilité, de partage, de mutualisation et d’équité dans le cadre de la mise en place d’une éducation artistique et culturelle pour tous les élèves, elle impose également l’évaluation et le recensement des projets et permet de « voir ce qui se passe » dans les établissements scolaires. Les travaux scientifiques menés par des chercheurs, notamment en Sciences de l’information et de la communication7, ont montré l’absence de neutralité qui préside à la conception des plateformes numériques ainsi que les messages idéologiques qui émanent de leur design, des contenus et des idéaux qu’elles incarnent ancrés dans l’imaginaire de l’institution scolaire. Qu’il s’agisse de l’ÉAC ou de l’ÉMI, la logique de plateformisation accompagne l’injonction institutionnelle à mettre le numérique au cœur des usages et des pratiques professionnels et pédagogiques des enseignants. Une logique qui présente cependant le risque de détourner les enseignants de ces plateformes en raison des exigences que leur maîtrise impose (temps, compétences, efforts…) avec pour conséquence de renforcer les inégalités socio-culturelles plutôt que de les réduire. Chronophage, la maîtrise des plateformes numériques reconfigure les pratiques professionnelles des enseignants : combien de temps passé à comprendre les rouages et les logiques des plateformes au détriment des médiations humaines et pédagogiques à l’égard des élèves ?