L’expression peut sembler étrange, mais paraît intéressante dans la mesure où elle permet de relier fortement des pratiques de recherche d’informations. Elle rappelle aussi que, bien souvent, il faut justement réaliser des enquêtes bibliographiques ou webographiques afin de pouvoir produire une synthèse de qualité. Comment trouver les bonnes références et les bons documents dans ce cadre ? L’expression de détective bibliographique est présente dans un ouvrage de Carlos Ruiz Zafón (2018). Mais on peut y trouver d’autres références dans d’autres œuvres de la littérature. En premier lieu, on pourrait songer aux écrits de Borges, qui sont pleins de références directes ou indirectes. On peut songer au travail de Charles Fort (Le Deuff, 2016) qui passa son temps à compiler des fiches sur des événements extraordinaires. Au final, nombre de documentalistes, de bibliothécaires ou de « fichistes » peuvent se reconnaître dans cette description. Mais plus encore, c’est dans Le Pendule de Foucault qu’on rencontre ce qui apparaît comme un détective d’un genre nouveau en la personne du narrateur :
« Je me décidai à m’inventer un travail. Je m’étais aperçu que je savais beaucoup de choses, toutes sans lien entre elles, mais que j’étais en mesure de les relier en quelques heures, au prix de deux ou trois visites dans une bibliothèque. J’étais parti quand il fallait avoir une théorie, et je souffrais de ne pas en avoir une. À présent, il suffisait de posséder des notions, tous en étaient friands, et tant mieux si elles étaient inactuelles. À l’université aussi, où j’avais remis les pieds pour voir si je pouvais me placer quelque part. Les amphis étaient calmes, les étudiants glissaient dans les couloirs comme des fantômes, se prêtant à tour de rôle des bibliographies bâclées. Moi je savais faire une bonne bibliographie. » (Eco, 1992)
Le personnage d’Umberto Eco va produire des fiches pour tenter de démêler un complot mondial qu’il est en fait en train de construire avec ses amis qui travaillent pour une maison d’édition. Ceci étant, il réalise plutôt une quête qu’une enquête. Or, le détective bibliographique se doit plutôt de produire l’inverse.
Première compétence : savoir faire une bonne bibliographie !
Cela peut sembler banal, surtout depuis qu’on est tenté de tout automatiser avec Zotero. Et pourtant, cette compétence documentaire et universitaire reste indispensable. Pire, les solutions techniques tendent à faire décroître les capacités à savoir réaliser une bibliographique pertinente, organisée et normée. On ne compte plus les bibliographies d’étudiants réalisées à la va-vite avec Zotero, et bourrées d’erreurs, de manques, tout simplement pour ne pas avoir retravaillé correctement les références. Le bon bibliographe sait utiliser les logiciels de traitement de références, le mauvais n’en retire qu’une substance informe qui ne distingue guère les différents types de documents. La réalisation d’une bonne bibliographie est une étape essentielle dans l’évaluation de l’information. Elle repose sur la capacité à faire des choix et à sélectionner, et donc à écarter des ressources jugées non opportunes. Il ne s’agit pas d’y faire figurer toutes les ressources qu’on aurait consultées, mais seulement celles qui vont être utilisées et qui ont été jugées dignes d’intérêt. Or parfois, le mauvais bibliographe préfère cumuler pour masquer un travail de recherche et de lecture insuffisant. Alors qu’il pense avoir réussi sa dissimulation en donnant une bibliographie pléthorique, il ne fait que démontrer son incapacité à faire les bons choix. Pire, il multiplie les risques en laissant des références erronées ou de mauvaise qualité qu’un bon lecteur va repérer rapidement, ce qui va jeter le trouble et le doute sur le reste du travail. Le détective bibliographique est d’ailleurs autant celui qui constitue les bibliographies que celui qui les examine.
Deuxième compétence : vérifier la qualité des références et leur exactitude
Parmi les éléments précis à examiner, notamment pour permettre leur vérification, figurent les fameuses références et citations. Or, il n’est pas rare de trouver des erreurs, ou plutôt des oublis. Il ne s’agit pas de débattre des normes bibliographiques et du choix du style qui a été appliqué, mais plutôt de vérifier s’il n’y a des erreurs flagrantes. On passera ici sur les habituelles coquilles ou éventuelles erreurs involontaires. Mais on fera attention aux fameuses citations de seconde main qui deviennent très vite problématiques : en effet, une citation de seconde main se repère parfois de manière aisée quand elle est utilisée par des étudiants peu scrupuleux de remonter à la source originale, et qui recopient la citation alors qu’elle est employée par un autre auteur plus récent, ou plus accessible. Le problème vient alors du fait que la citation est devenue trop connue, voire qu’elle est originellement mal citée ou mal référencée dans l’ouvrage consulté qui la cite. Sur ce point, cela traduit d’emblée un manque de sérieux patent. Mais les étudiants ne sont pas les seuls à commettre ce genre de fautes… qui d’ailleurs ne l’a pas déjà pratiquée ? La meilleure solution est donc de vérifier la source originale, et ce pour plusieurs raisons :
• La première raison est pour en constater la véracité. Une coquille, une virgule mal placée peut changer le sens d’une citation au point que l’auteur qui a fait le choix d’effectuer une citation peut l’avoir fait à mauvais escient. On peut donc être dans le cas d’une trahison. Elle est d’autant plus possible lorsque la citation est une traduction. De la traduction à la trahison, la frontière est mince. Il en va souvent de même pour la citation qui doit toujours laisser place à une interprétation de celui qui l’utilise, mais aussi de celui qui la reçoit.
• La deuxième raison est qu’une citation perd souvent le contexte dans lequel elle se situe. C’est donc une extraction risquée qui peut être source d’erreurs d’interprétations, d’exagérations, voire de mensonges purs et simples. Le minimum est donc de pouvoir prendre connaissance du reste du document pour être certain de bien mesurer le sens qu’a voulu réellement donner l’auteur. Dans ce cadre, on fera bien attention à distinguer la pensée d’un auteur des propos qu’il rapporte, ou des mots qu’il fait dire à un personnage.
• La troisième raison est que la bibliographie est une enquête qui place le lecteur-chercheur en détective bibliographique, lequel va remonter de lien en lien, et mieux comprendre ce qu’il est en train de réaliser. C’est la preuve qu’un document ne peut se comprendre de manière isolée, et qu’il faut lui adjoindre un ensemble de documents secondaires. Celui qui fait le choix de remonter à la source originale va pouvoir remarquer que le document cité se réfère à d’autres documents, écrits dans un contexte bien particulier, et ainsi de suite. La logique documentaire est toujours hypertextuelle et cumulative. La meilleure des synthèses s’appuie toujours sur une sélection ordonnée de documents.
• La quatrième raison provient du fait que le système de référence d’un document peut contenir des références implicites voire involontaires. Dès lors, un mot ou un concept peut avoir un sens différent selon le contexte historique. Or, sur ce point, cette capacité à comprendre les références cachées, indirectes, évidentes pour l’époque mais complexes quelques années plus tard, nécessite des compétences difficiles à pouvoir évaluer, et encore plus difficiles à transmettre en quelques heures.
Le détective bibliographe est ici clairement un philologue qui aime le texte et les documents, et notamment leur structure, leur balisage, mais aussi les liens non balisés et moins évidents. C’est donc un œil avisé qui s’avère nécessaire pour être un bon détective bibliographe.
Troisième compétence : la capacité à analyser et à mesurer
Débusquer les liens cachés, les références explicites, mais surtout implicites, voilà un vrai travail de détective. Or, cela nécessite de la pratique, du temps, des essais-erreurs, des stratégies pour comparer, vérifier. Si, certes, on peut désormais disposer d’outils de recherche plus puissants et d’un accès direct à des documents numérisés, il faut se montrer capable d’actionner tout cet arsenal en fonction d’indices. Et cela ne peut se faire que par une logique que certains pourraient qualifier de flair. Il faut donc pour cela savoir douter à bon escient. Et il est parfois difficile d’expliquer comment le doute vient à l’esprit, si ce n’est pas par une pratique d’analyse documentaire régulière. Il faut donc sans cesse évaluer. Évaluer la qualité générale du discours, mais aussi la qualité des références, leur équilibre, le fait de mentionner plutôt telle ou telle source. Évaluer encore, la manière dont on a choisi d’organiser la bibliographie, et notamment si elle est catégorisée du fait d’un grand nombre de références. Certaines sont-elles mises en avant, voire commentées comme c’est le cas parfois dans des thèses ?
Quel est l’ordre du discours au final ? Comment sont organisés les arguments, les exemples et les sources mentionnées pour produire un discours nouveau ou renouvelé, qui peut se montrer le plus convaincant possible dans sa démonstration ? Quelle démarche esthétique dans le choix de la typographie et des illustrations ? Le détective bibliographique possède des qualités qu’on aime trouver chez les iconographes. C’est encore une fois Umberto Eco qui le décrit le mieux :
« Je partais des manuels, j’en fichais la bibliographie, et de là je remontais aux originaux plus ou moins anciens, où je pouvais trouver des illustrations décentes. Il n’y a rien de pire que d’illustrer un chapitre sur les voyages spatiaux avec une photo de la dernière sonde américaine. Monsieur Garamond m’avait appris qu’au minimum il faut un ange de Gustave Doré. Je fis une moisson de reproductions curieuses, mais elles n’étaient pas suffisantes. Quand on prépare un livre illustré, pour choisir une bonne image il faut en écarter au moins dix autres. » (Eco, 1992)
Le détective bibliographe possède des qualités propres à un travail de recherche scientifique. Les méthodes connues de Sherlock Holmes reposent sur la capacité à repérer les indices pour en produire un tout cohérent permettant d’obtenir une hypothèse de qualité qui se veut la plus proche possible de la vérité. Mais comme il y a plusieurs détectives, il y a finalement plusieurs méthodes de procédure scientifiques. Le détective bibliographique n’existe donc pas selon un seul modèle, unique.
Les profils de détective bibliographique
Gilles Deleuze considère qu’il existe deux grandes écoles de détective dans le roman policier :
« Or il y avait deux écoles du vrai : l’école française (Descartes), où la vérité est comme l’affaire d’une intuition intellectuelle de base, dont il faut déduire le reste avec rigueur — l’école anglaise (Hobbes), d’après laquelle le vrai est toujours induit d’autre chose, interprété à partir des indices sensibles. Bref : déduction et induction. Le roman policier, dans un mouvement qui lui était propre, reproduisait cette dualité, et l’illustrait de chefs-d’œuvre. L’école anglaise : Conan Doyle, avec Sherlock Holmes, prodigieux interprète de signes, génie inductif. L’école française : Gaboriau, avec Tabaret et Lecoq, puis Gaston Leroux, avec Rouletabille (Rouletabille invoque toujours « le bon bout de la raison »…) »(Deleuze, 2014)
On trouvera donc différentes méthodes et différentes manières d’annoncer sa démonstration avec les lectures indicielles d’un document et de sa bibliographie. Il n’est pas rare effectivement que la démonstration conduise à considérer que le travail est au mieux une vaste paraphrase ou un plagiat manifeste. Les outils de comparaison et de détection du plagiat viennent alors renforcer les premiers résultats d’analyse. Il faut toutefois ici rappeler qu’ils s’appuient initialement sur des résultats disponibles sur le web, et qu’il faut parfois leur ajouter des bases documentaires spécialisées pour être certain qu’il y a eu plagiat. À cet égard, il est probable que de nombreux documents dans les décennies qui ont précédé le web sont issus de plagiats, mais qu’il est difficile de le mesurer du fait d’une difficulté de comparaison. L’accessibilité complexe de la littérature grise a fait le bonheur des plagiaires. Le détective bibliographique est parfois un évaluateur d’articles scientifiques, un reviewer. Ce travail consiste alors à vérifier si l’état de l’art sur une question est connu de l’auteur et s’il n’a pas omis une piste de travail déjà bien avancée. Dans d’autres cas, il s’agit de conseils complémentaires pour aider l’auteur à mieux finaliser son travail. Si on revient sur la question essentielle de l’accessibilité, il s’agit à la fois de pouvoir repérer les références clefs et, surtout, de pouvoir y accéder. En effet, il n’est pas rare, y compris actuellement, de devoir rechercher encore un peu longuement certaines références non disponibles en ligne, que ce soit via un abonnement, un paywall ou via les sites alternatifs et pirates de type sci.hub. Dans ce cas, il faut revenir aux bonnes vieilles pratiques qui consistent à localiser la revue qui contient l’article souhaité dans une bibliothèque, et de faire appel au prêt entre bibliothèques si nécessaire. Dans ce cadre, il faut des détectives bibliographiques qui ne renoncent jamais, des Columbo des bibliographies, infatigables et obstinés, pour obtenir la bonne référence dont il faut absolument disposer. Dans ce cadre d’ailleurs, on va distinguer celui qui va considérer la quête comme la démarche essentielle de celui qui va privilégier le document obtenu au final et qui va faire l’objet d’une forme de culte. Dans le dernier cas, le détective en devient un nostalgique qui ne parvient plus à réaliser d’autres recherches d’un même niveau. Mais on ne peut jamais totalement négliger le fait que le détective bibliographique cherche au travers des documents des réponses à sa propre existence, voire à sa propre filiation. Tel Joseph Rouletabille (Leroux, 1910–1920) qui perçoit dans ses enquêtes le parfum de la dame en noir, le détective bibliographique cherche parfois à comprendre qui il est et d’où il vient.
Un outillage nécessaire
Quels que soient le profil et les méthodes du détective, il va utiliser différents types d’outils. Même si, très souvent, il mettra en avant son esprit, sa capacité d’analyse et de déduction, il va néanmoins s’appuyer sur des outils. On va retrouver au minimum le dualisme papier/crayon avec des préférences pour des carnets d’écriture type Bullet Journal agréable au toucher et pratique à conserver. Chacun y développera ses méthodes d’organisation et d’écriture. Évidemment, avec les outils logiciels, les perspectives s’accroissent. Impossible de ne pas utiliser un logiciel bibliographique pour classer et organiser les innombrables découvertes, lectures réalisées, lectures à faire et dossiers collaboratifs. La possibilité de récupérer des données de façon automatisée sur les entrepôts de données choisis à bon escient permet un gain opportun, mais il ne doit pas faire oublier la nécessité de corriger les scories qui résultent de leur moissonnage. Le détective bibliographique soigne aussi ses possibilités de transformation afin de pouvoir produire des documents qui seront transmissibles à d’autres et d’en disposer. Un détective bibliographique doit donc toujours songer à l’utilité potentielle de la référence mobilisée. Pour cela, il lui faut maîtriser l’export en bibtex ou bien jongler entre ces logiciels d’écriture et les possibilités d’export en une diversité de formats. Les plus soigneux quitteront les traitements de texte classiques pour privilégier de nouveaux logiciels d’écriture basés sur du markdown et gérant automatiquement leurs références par des clés de citations. En effet, si la bibliographie mérite un travail sérieux en matière de sélection, elle réclame aussi des compétences pour répondre aux exigences des revues scientifiques et des colloques qui demandent des formats spécifiques. Mais finalement, la touche du détective bibliographique le plus avancé est sa marque esthétique, celle qui lui permet de fournir une bibliographie pertinente et bien organisée et qui soit belle à regarder et à consulter. Le détective devient alors également un artiste, un esthète de la connaissance.
À titre d’exemple, cet article a été écrit intégralement avec un logiciel d’écriture prometteur, Zettlr, open source et gratuit, qui permet de gérer au mieux sa bibliographie notamment avec des exports depuis Zotero. On peut ensuite générer des exports de l’ensemble sous format pdf ou sous format traitement de texte.

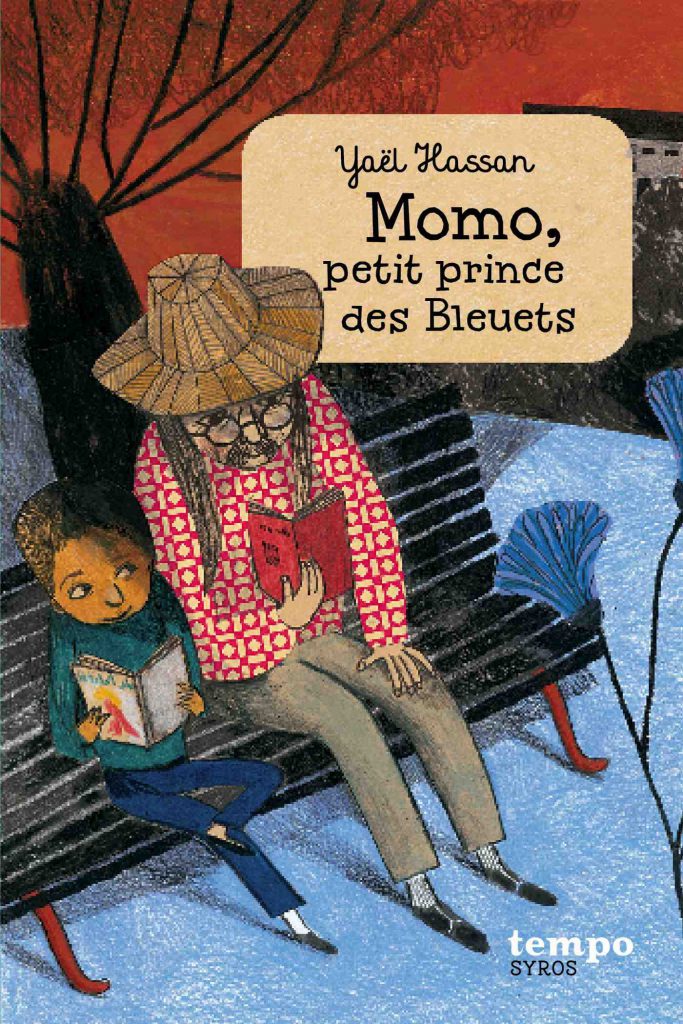 Des relations très fortes
Des relations très fortes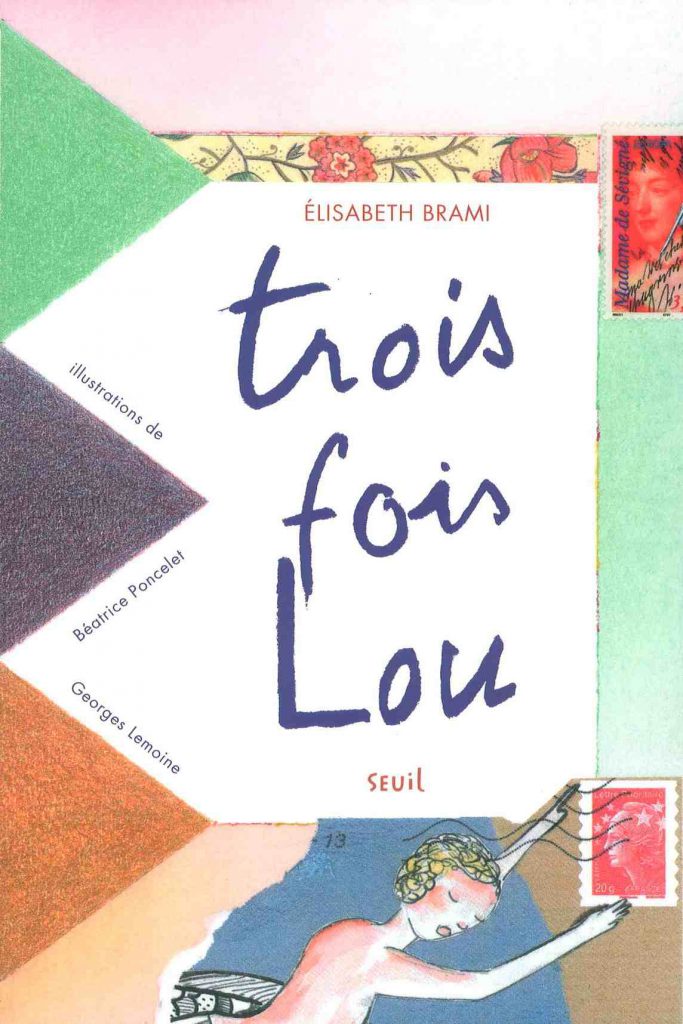 magnifique portrait d’une jeune fille et de sa grand-mère, qui décident de s’écrire régulièrement, afin de créer un lien particulier entre elles. Peu à peu, elles vont se découvrir l’une l’autre. Une découverte que va vivre également Salamanca dans le roman Voyage à rebours5 de Sharon Creech. Une jeune fille de treize ans part avec ses grands-parents pour un long voyage à travers les états américains afin de retrouver sa mère pour son anniversaire. Un voyage géographique, mais également spirituel, car Salamanca va se découvrir au fil du voyage qui lui réserve de nombreuses surprises. Un magnifique road-movie, aux personnages très attachants. C’est également une belle correspondance que va commencer Annabelle avec sa grand-mère dans le roman Mémé, t’as du courrier6 de Jo Hœstlandt. La jeune fille et sa grand-mère décident qu’elles ne communiquent pas assez , elles prennent alors la décision d’entamer une correspondance, qui permettra à chacune de mieux connaître l’autre. Un roman attachant, qui plaira aux plus jeunes de nos lecteurs.
magnifique portrait d’une jeune fille et de sa grand-mère, qui décident de s’écrire régulièrement, afin de créer un lien particulier entre elles. Peu à peu, elles vont se découvrir l’une l’autre. Une découverte que va vivre également Salamanca dans le roman Voyage à rebours5 de Sharon Creech. Une jeune fille de treize ans part avec ses grands-parents pour un long voyage à travers les états américains afin de retrouver sa mère pour son anniversaire. Un voyage géographique, mais également spirituel, car Salamanca va se découvrir au fil du voyage qui lui réserve de nombreuses surprises. Un magnifique road-movie, aux personnages très attachants. C’est également une belle correspondance que va commencer Annabelle avec sa grand-mère dans le roman Mémé, t’as du courrier6 de Jo Hœstlandt. La jeune fille et sa grand-mère décident qu’elles ne communiquent pas assez , elles prennent alors la décision d’entamer une correspondance, qui permettra à chacune de mieux connaître l’autre. Un roman attachant, qui plaira aux plus jeunes de nos lecteurs.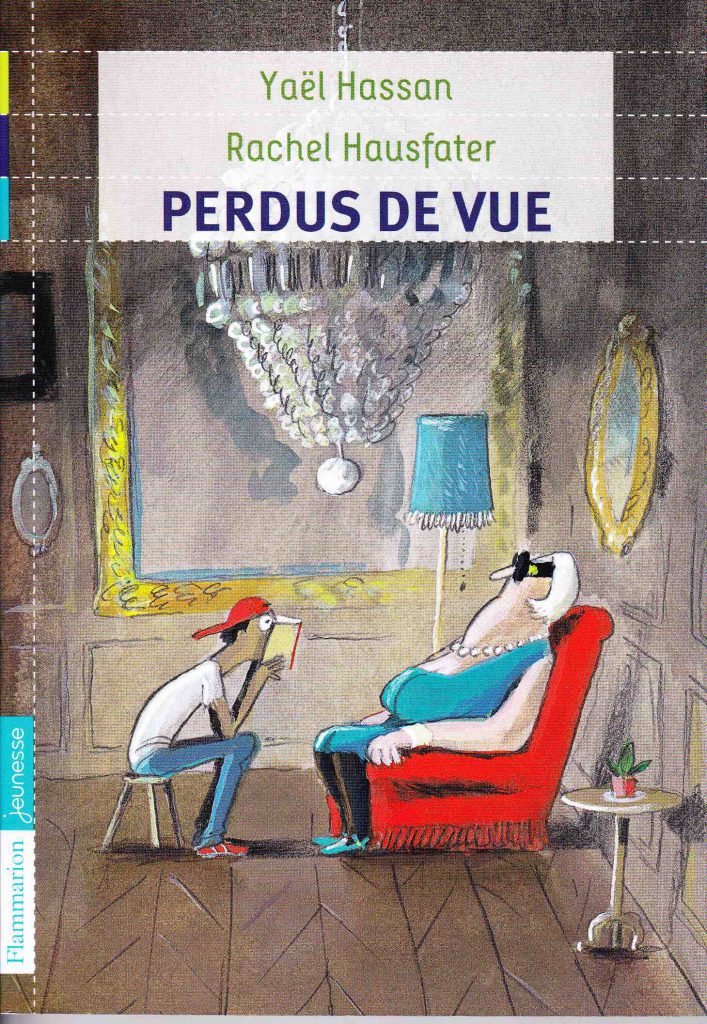 paisible en Californie. Mais lorsque ses grands-parents débarquent chez elle, son monde s’écroule. Originaires d’Inde, ils décident que la jeune fille doit désormais respecter les traditions de son pays d’origine. Sunita doit s’habiller avec le vêtement traditionnel et plus question pour elle de voir son petit ami… Un roman abordant les conflits de génération avec tact et finesse.
paisible en Californie. Mais lorsque ses grands-parents débarquent chez elle, son monde s’écroule. Originaires d’Inde, ils décident que la jeune fille doit désormais respecter les traditions de son pays d’origine. Sunita doit s’habiller avec le vêtement traditionnel et plus question pour elle de voir son petit ami… Un roman abordant les conflits de génération avec tact et finesse. 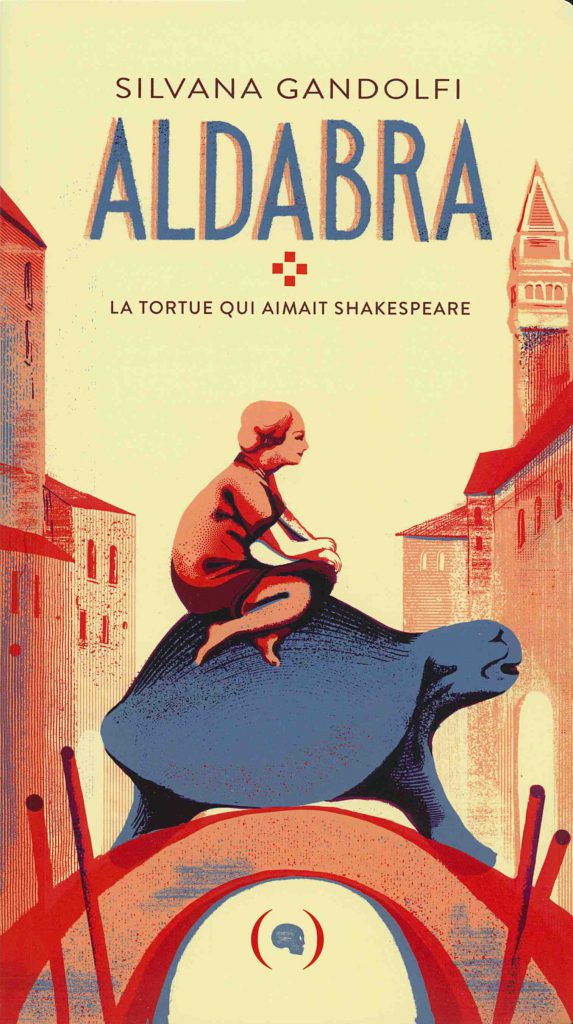 À l’approche de la mort…
À l’approche de la mort…
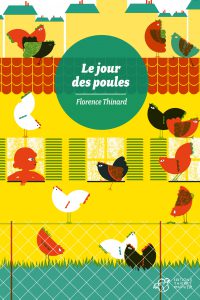 Face à un livre, nos jeunes lecteurs adorent les émotions fortes. Ils aiment frissonner, pleurer… ou éclater de rire. Parmi les livres fréquemment cités, Si par hasard c’était l’amour1, de Stéphane Daniel, est plébiscité. Les aventures de ce jeune garçon, parti pour passer des vacances glamour dans le sud de la France, et qu’une panne de voiture immobilise plusieurs jours dans un petit village
Face à un livre, nos jeunes lecteurs adorent les émotions fortes. Ils aiment frissonner, pleurer… ou éclater de rire. Parmi les livres fréquemment cités, Si par hasard c’était l’amour1, de Stéphane Daniel, est plébiscité. Les aventures de ce jeune garçon, parti pour passer des vacances glamour dans le sud de la France, et qu’une panne de voiture immobilise plusieurs jours dans un petit village 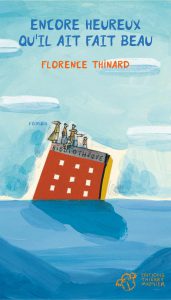 perdu de l’Est de la France, ont le pouvoir de faire éclater de rire nos lecteurs. Situations cocasses, humour décalé et franchement bien vu, tout est réuni dans ce roman pour une franche rigolade.
perdu de l’Est de la France, ont le pouvoir de faire éclater de rire nos lecteurs. Situations cocasses, humour décalé et franchement bien vu, tout est réuni dans ce roman pour une franche rigolade.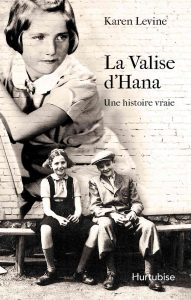 L’une de leurs périodes fétiches est le XVIIe siècle, les romans d’Annie Jay, d’Annie Pietri ou d’Anne-Marie Desplat-Duc font référence dans le domaine. L’un des coups de cœur de cette année est le roman de Tracy Chevalier, La Jeune Fille à la perle11. Embauchée comme servante dans la maison du peintre Vermeer, à Delft, la jeune Griet découvre peu à peu l’atelier du peintre. Cette situation va faire scandale… Un très beau roman, à l’héroïne attachante.
L’une de leurs périodes fétiches est le XVIIe siècle, les romans d’Annie Jay, d’Annie Pietri ou d’Anne-Marie Desplat-Duc font référence dans le domaine. L’un des coups de cœur de cette année est le roman de Tracy Chevalier, La Jeune Fille à la perle11. Embauchée comme servante dans la maison du peintre Vermeer, à Delft, la jeune Griet découvre peu à peu l’atelier du peintre. Cette situation va faire scandale… Un très beau roman, à l’héroïne attachante.