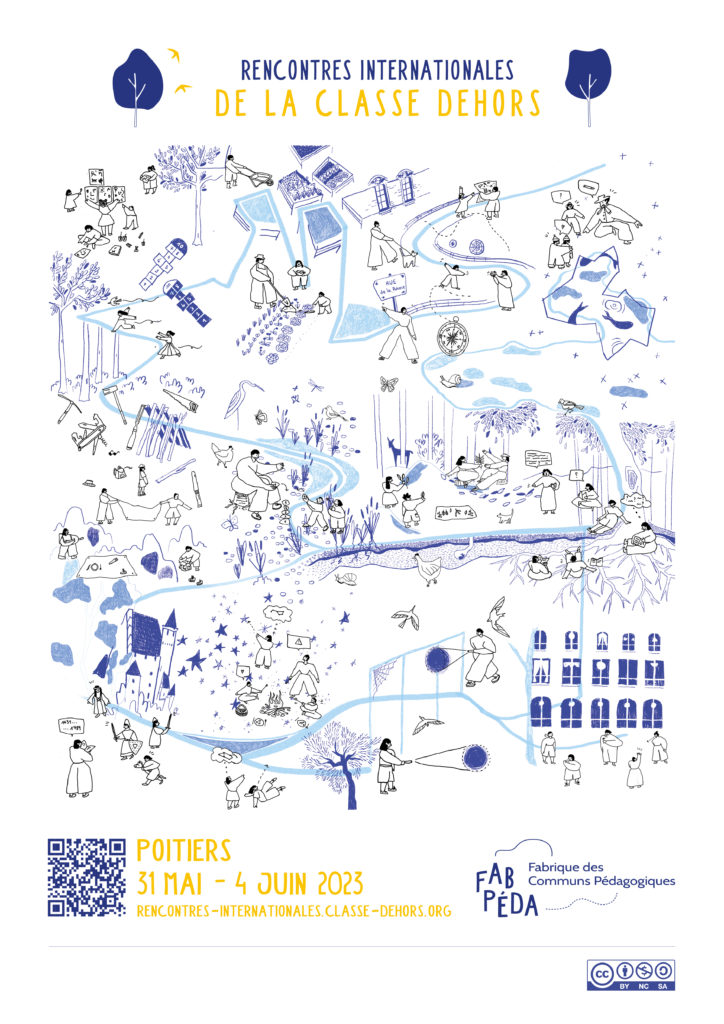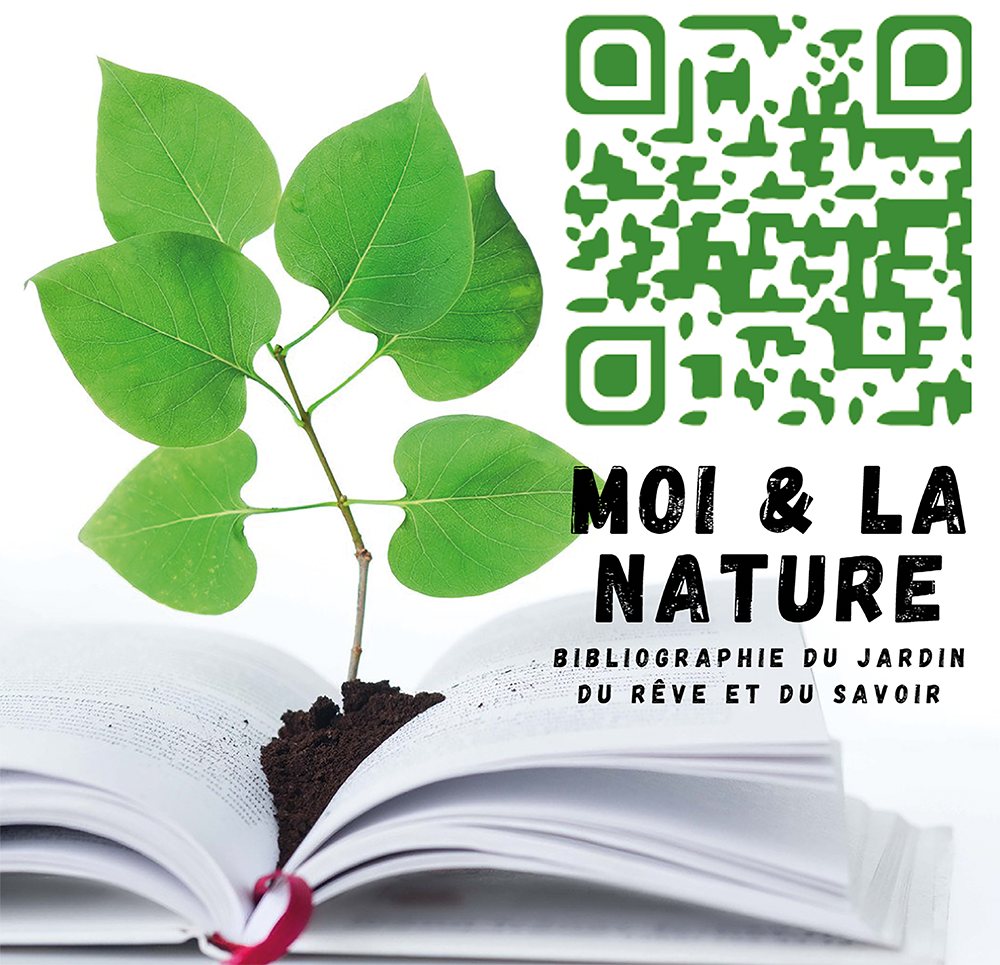Introduction : un CDI en Anthropocène
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut » : cette formule de Cicéron (Ier siècle avant notre ère) peut servir de point de départ à notre réflexion sur l’articulation entre missions des professeurs documentalistes et enseignement en extérieur. Dans la lignée des propositions formulées dans un précédent article consacré au « CDI vert » (Pillot, 20211), nous proposons ici de réfléchir à l’opportunité de l’enseignement en extérieur pour repenser certains de nos usages professionnels, afin de montrer que nos missions ne se cantonnent pas exclusivement au lieu avec lequel nous, professeurs documentalistes, sommes si souvent associés.
Dans une perspective plus large, nous sommes convaincue que le sujet de la classe dehors est un outil éducatif de premier ordre à l’heure de l’Anthropocène. Ce néologisme, littéralement l’âge des humains, est désormais utilisé par de nombreux scientifiques pour désigner l’époque géologique nouvelle dans laquelle l’humanité est entrée depuis que les activités humaines ont un impact global significatif – et, pour une part, irréversible – sur le système géologique planétaire. Il s’agit d’une thématique dont s’empare peu à peu l’éducation nationale, rejoignant en cela de nombreux chercheurs, dont parmi les plus accessibles Nathanaël Wallenhorst (Hétier & Wallenhorst, 2022), et acteurs de l’éducation populaire, comme l’a montré une formation de la Ligue de l’enseignement sur le sujet au mois de décembre 2022. Le bulletin de veille Apprendre en anthropocène, éduquer à la biodiversité d’Anne-Françoise Gibert (IFÉ, 2022) va dans le même sens, développant une partie de son argumentaire autour de l’enseignement en plein air. On peut dès à présent noter qu’une part écrasante du sujet et de son traitement scientifique comme médiatique concerne les élèves du primaire. Les bienfaits du plein air sur les apprentissages des plus jeunes élèves font désormais l’objet d’un consensus scientifique bien établi. Les éléments de controverse qui subsistent sont marginalement d’ordre politique – en témoigne le dernier numéro de la revue Carnets rouges – plus généralement pratiques, liés alors aux difficultés de mise en place et, transversalement cette fois, relatifs à l’âge des élèves concernés (Mottint, 2023). Ils impliquent de préciser d’emblée le contexte des développements qui suivent. Ils se basent sur des expériences vécues ou observées dans des établissements ruraux, de centre-ville ou en zone « politique de la ville » qu’ils visent à mettre en perspective dans l’optique de ne pas restreindre la pratique du dehors à un type de public ou d’EPLE, à des conditions particulièrement favorables ou, au contraire, difficiles. De même, ils proviennent pour l’essentiel de temps pédagogiques menés en co-animation ou co-intervention, une donnée qui, sans être essentielle, facilite grandement l’exercice de la sortie régulière. Pour terminer sur ce cadrage de départ, la question du dehors est moins souvent posée pour les adolescents et donc pour les publics scolaires des collèges et lycées. Sur le terrain, la situation évolue cependant, et de plus en plus d’enseignants du secondaire s’engagent dans l’enseignement en extérieur.
Les professeurs documentalistes peinent parfois à trouver leur place dans ces expérimentations. Convaincue que cette situation résulte de la méconnaissance de notre métier par le reste de la communauté éducative et de celle des possibilités de la classe dehors par une partie de notre profession, nous proposons de mener une première exploration du sujet avec cette contribution. Il ne peut être question ici de lister toutes les pistes relatives à l’information-documentation, au fonds ou à l’ouverture culturelle offerte par le plein air tant elles sont nombreuses et spécifiques à chaque situation. Nous nous contenterons de proposer quelques exemples tirés de notre propre expérience, de relayer des façons de mettre en œuvre des propositions de plein air, dans les cursus d’information-documentation et avec nos collègues, et enfin de conclure sur l’intérêt de repousser les freins qui peuvent exister quant à cette pratique, en montrant sa capacité d’empouvoirement et de réappropriation de certains aspects du métier. Nous le ferons en tentant de répondre à la question suivante : en quoi la pratique de la classe dehors peut-elle devenir un pivot dans les missions du professeur documentaliste auprès des élèves et contribuer à leur réussite, ainsi qu’à la reconnaissance des spécificités de notre profession ?
Une jeunesse confinée : la nécessité du dehors
L’extinction de l’expérience de nature : un constat alarmant
Depuis le premier confinement et la décision du gouvernement français d’interdire la fréquentation des espaces verts publics aux citadins pendant plusieurs semaines, la question de l’accès à la « nature »2 (Descola, 2005) a pris une place croissante dans les différentes sphères du débat public. Et ce, à juste titre, puisque les mérites de la fréquentation des arbres, de la marche pieds nus sur l’herbe, des fameux « bols d’air pur » ont été éprouvés, malheureusement par le manque, par des millions de nos concitoyens. Les élèves et les jeunes en général ont été frappés de plein fouet par cette longue « privation de nature ». Et pour cause, elle s’inscrit dans un processus plus long et insidieux que le journaliste nord-américain Richard Louv a désigné sous le vocable nature deficit disorder. L’extinction de l’expérience de nature qu’il évoque dans son ouvrage Last Child in the Woods en 2005 à propos de ses jeunes concitoyens s’applique aussi aux jeunes Français. On ne compte plus, depuis la sortie de son livre, les études qui établissent que le temps passé en extérieur est devenu portion congrue par rapport à celui dédié aux activités indoor et qui sont rappelées dans le livre de Mathieu Chéreau et Moïna Fauchier-Delavigne, L’enfant dans la nature (2019). Tant et si bien que nombre d’adultes aujourd’hui, qui ont grandi en étant privés de nature dans les années 80-90, ne sont plus en mesure de transmettre leur expérience. Cette situation touche de fait le monde de l’enseignement. Suivant la répartition des EPLE et les puissantes dynamiques de périurbanisation, les lieux de résidence des différents acteurs de la communauté scolaire sont pour la plupart de plus en plus éloignés des espaces dits « naturels », tels que les bois et les cours d’eau. Et que penser de ces dizaines de milliers d’élèves du secondaire qui, en ville ou à la campagne, passent de leur lieu de résidence au collège ou au lycée par le biais de transports en commun ou de cars scolaires et entrent en classe dès leur sortie du bus ? Si en plus leur récréation se passe en intérieur, on perçoit bien le peu d’interactions avec le dehors auxquelles peuvent être confrontés les adolescents. Et parmi eux, ceux qui – délaissant une cour peu accueillante ou trop violente – comptent parmi les plus fervents acteurs des CDI ! Loin d’être anecdotique et de la caricature de l’adolescent qui préfère sa chambre au jardin, la perte de l’expérience de nature est un réel problème de société. En effet, cette coupure avec l’extérieur induit un désintéressement progressif quant à la situation critique de notre environnement et aux façons de le protéger. Réintroduire cette expérience est, sans l’y limiter, l’un des objectifs majeurs de la classe dehors.
Le « tout numérique » : un modèle de société qui questionne, jusque dans les enseignements
Face au constat de l’extinction de l’expérience de nature, le sentiment d’inquiétude qui touche les professionnels de l’éducation est légitime. Perte de concentration, hyperactivité, immunité altérée, les symptômes sont nombreux. Ils sont majorés par l’activité qui occupe les plages temporelles auparavant dédiées au dehors : la surexposition aux écrans. Comme l’a récemment rappelé le Conseil national du numérique (CNNUM) dans son rapport Votre attention s’il vous plaît, dans un contexte d’économie de l’attention les mécanismes de l’addiction au numérique sont de plus en plus puissants. Les adolescents sont l’une des cibles préférées des sites marchands et des algorithmes. Les épisodes de confinement successifs ont également confirmé, s’il en était besoin, l’attachement profond que leur portent les élèves, du gaming aux réseaux sociaux. En bref, l’addiction aux écrans des jeunes et des adolescents, entretenue notamment par les GAFAM est devenue un problème de santé publique. À la lecture de ce constat, la protection des élèves apparaît comme une urgence. Les pouvoirs publics s’en sont effectivement saisis comme dans la récente campagne « 0-3 ans, 0 écran » et les différentes sensibilisations dans le cadre des programmes de lutte contre les violences en ligne pour les plus grands. Dans les faits, on constate que la prévention du temps d’exposition pendant l’enfance baisse face à celle qui concerne les contenus parcourus et échangés à l’adolescence. De fait, alors que l’institution scolaire est très impliquée dans la lutte contre le harcèlement en ligne et la protection des données personnelles chez les élèves de collège et de lycée, la question de la présence des écrans dans leur journée est moins prise en charge. L’usage du smartphone est certes interdit en collège depuis la loi du 3 août 2018 mais, pour certains élèves, la journée reste occupée par de nombreuses heures passées devant les écrans d’ordinateurs et les projections au tableau.
Il n’est pas ici question de revenir sur la controverse autour de la numérisation des enseignements actuellement en cours3. On peut simplement constater que de ce fait, la durée d’exposition augmente en permanence. Or, les professeurs documentalistes sont en première ligne de la formation aux usages numériques. Il s’agit de l’un des grands attendus de notre profession et le CDI est souvent identifié comme le lieu de connexion majeur de l’établissement par les élèves. S’il faut bien sûr réaffirmer la nécessité d’offrir une formation aux enjeux du web et aux pratiques numériques en général dans le cadre des progressions en information-documentation, force est de constater que l’usage des écrans hors séances pédagogiques est souvent un point de conflictualité dans les usages et le respect des occupations de chacun. Parmi les pistes de régulation, celle de la déconnexion, totale à certaines heures ou partielle dans certaines zones, émerge de plus en plus souvent dans les échanges professionnels. Le professeur documentaliste apparaît, à raison, à l’avant-garde de cette problématique et nous verrons plus loin comment le recours aux espaces extérieurs peut l’aider dans cette voie.

indispensable à la compréhension de l’économie de l’attention
Bâti scolaire et passoires thermiques : une opportunité pour le dehors ?
Au moment où nous dressons le constat de l’importance de repenser le dehors dans nos missions et pratiques éducatives, la question du lieu est bien sûr centrale. Le bâti scolaire français fait l’objet d’une très grande diversité. Réaffectation de certains lieux en EPLE, époques de construction, variations démographiques, matériaux disponibles et évolution politique des collectivités sont autant de facteurs jouant dans la variété des solutions adoptées. Les CDI ne sont pas en reste et à cette histoire de l’architecture scolaire s’ajoute celles liées aux évolutions du métier. Les plus anciens ont été conçus pour un public enseignant, d’autres agrandis ou au contraire amputés à l’occasion de chantiers de rénovation, tous ou presque conçus conformément à la vision que leur concepteur a de notre métier (proche de la vie scolaire ou plutôt de la salle des professeurs, par exemple). Là aussi, la situation évolue et des architectes s’emparent différemment de la question, comme l’ont montré l’exposition itinérante Travaux d’école (Chiron et al., 2020) et plusieurs projets de concertation récents. Une enquête du Ministère intitulée « Bâtir l’école ensemble » et dont les premières analyses sont disponibles sur le site gouvernemental « Bâti scolaire » a réaffirmé en 2022 l’intérêt des différents acteurs sur ces questions. Il est de plus motivé très concrètement par la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes (tempêtes, canicules, vagues de froid) et la hausse du prix de l’énergie auxquels écoles, collèges et lycées font parfois difficilement face. Comme pour le parc immobilier en général, la rénovation énergétique du bâti scolaire est donc un enjeu majeur des années à venir.
Dans l’attente de travaux de rénovation, les collègues de disciplines sont de plus en plus nombreux à avoir recours au dehors. Le secondaire reste certes en marge, comparativement à la maternelle et à l’élémentaire où les demi-journées en extérieur sont légion dans de plus en plus de classes, mais un mouvement de fond est perceptible au collège et au lycée. Dans les deux cadres, les périodes de déconfinement, où les salles étaient trop difficiles à aérer et les masques rangés en extérieur, ont contribué à accélérer le mouvement. Au terme de trois années pédagogiquement éprouvantes, le constat des conséquences de l’épidémie sur les jeunes est donc sans appel. Moins de nature et plus d’écrans rendent urgent d’améliorer leurs conditions d’étude rendues difficiles par la multiplication des canicules. Et bien sûr, à la fois, les conditions de travail pour leur enseignant ! Il est donc grand temps de prendre la mesure des bienfaits du dehors pour les élèves et des possibilités simples et rapides de mettre en place un enseignement de ce type, pour l’ensemble de la communauté éducative.
Le constat est bien là et concerne l’ensemble de la communauté éducative, qui trouverait grand bénéfice à sortir de son espace de pratique habituel. Engageante pour tous, l’entreprise peut sembler encore plus complexe à mener de la part d’une profession pour laquelle le lieu et la fonction sont aussi imbriqués que pour la nôtre. La confusion entre le professeur documentaliste et la mission de gestion des ressources mène à le considérer comme seul responsable de la démarche de mise en place d’une politique documentaire, alors que la communauté éducative tout entière devrait en théorie s’y engager. De fait, de nombreux établissements ne disposent pas d’une politique documentaire clairement identifiée. En résulte une situation peu satisfaisante pour le professeur documentaliste qui se voit confondu avec un lieu qu’il n’a pas toujours les moyens de gérer comme il le souhaiterait.
S’il n’est évidemment pas question de délaisser le volet pédagogique pour trouver davantage d’heures à consacrer à la gestion du fonds, l’accumulation des missions est de plus en plus mal vécue par de nombreux collègues. On comprend que dans ce contexte, l’assimilation au seul « lieu CDI » et au fonds puisse être source d’incompréhension et de difficultés de communication au sein des équipes. Or, nous pensons justement qu’en nous permettant une réappropriation du lien à notre lieu d’exercice, les principes de la classe dehors sont l’une des pistes vers une nouvelle valorisation de notre travail et de notre image professionnelle, utile à nos revendications.
Notons qu’un certain flottement sémantique existe dans la circulaire quant à la définition de notre périmètre physique d’activités de gestion. Le CDI est qualifié tantôt d’« espace », tantôt de « lieu » sans que la différenciation soit explicite. Si l’on s’en tient à la définition des géographes du site Géoconfluences : « Un lieu est une portion d’espace sujette à des appropriations singulières et à des mises en discours spécifiques. »4 C’est ce qui semble effectivement bien être le cas des CDI : des zones de l’espace scolaire appropriées de façon variable par les usagers, selon l’heure de la journée, la période ou les projets et à propos desquelles significations et charges symboliques peuvent être aussi fortes que diverses. Toujours dans le même article, il est précisé qu’« au sens strict, un lieu n’a pas d’étendue ou une étendue limitée : on le parcourt à pied et on peut l’embrasser du regard. Mais alors que le paysage mobilise principalement le regard, on fréquente, on parcourt un lieu, on y agit ». De ce fait, la restriction de nos missions pédagogiques et de gestion aux quatre murs de la salle du CDI ne va pas de soi. Elles peuvent être transposées à d’autres lieux dans ou hors de l’EPLE tant que les activités – au sens d’« actions » – menées le sont dans les mêmes objectifs de formation info-documentaire et d’ouverture culturelle que celles traditionnellement proposées dans le CDI.
En bref, il s’agit en transposant nos usages, nos façons de travailler hors les murs, de manifester notre spécificité pédagogique. Celle d’être en mesure de penser l’enseignement en relation avec l’environnement qui l’accueille, qu’il s’agisse d’étagères plus ou moins bien garnies de livres, d’une salle informatique, d’un parc ou d’une cour de récréation. Et de pouvoir le faire, soit depuis le CDI où la plupart des ressources sont concentrées, soit dans la périphérie de ce centre, en exerçant notre capacité à en identifier de nouvelles, dans une topographie élargie. En refusant de nous laisser cantonner à un seul lieu de l’EPLE, nous réaffirmons notre démarche pédagogique et notre aptitude à proposer un enseignement différent de celui de nos collègues par le fond de notre démarche et pas seulement par sa forme. Au biais qui nous conduit trop souvent à être considérés comme des techniciens de la salle du centre de documentation avec lequel nous sommes confondus, nous proposons d’opposer la vision d’un professeur documentaliste expert dans l’utilisation de l’espace scolaire. Et au cliché d’un gestionnaire de fonds débordé et peu à l’écoute de ses élèves (le fameux « chuuuut »), une relation fondée sur l’idée de proposer à l’usager une expérience pédagogique, sensible et engageante pour les apprentissages comme plusieurs contributions du dossier « Questionner les manières d’habiter les espaces documentaires d’accès aux savoirs : une approche sensible » le soulignent (Revue Cossi, 2019). À ce titre, l’enseignement en extérieur peut constituer un excellent moyen de réaffirmer que l’espace scolaire a un rôle fondamental et donner un nouveau sens au recours à différents lieux de l’EPLE, y compris au CDI.
Du diagnostic à la pratique : identifier ses besoins et se former
Faire le point sur ses besoins : le temps du questionnement
Le plein air est un facteur de bien-être physique et mental pour les élèves et, si l’on en croit leurs retours, pour les collègues qui ont pris cette habitude de travail. Comme pour toute évolution dans une pratique professionnelle, la volonté de mettre en place une part de nos missions en extérieur implique de procéder au diagnostic de la situation actuelle et des attentes de la communauté pédagogique et éducative pour l’avenir. Sur quels axes de nos missions souhaitons-nous travailler ? À destination de quel public ? Selon quel cadrage pédagogique avec les collègues ? Autant de questions qui pourraient décourager plus d’un collègue mais dont nous sommes familiers dans le cadre des projets documentaires initiés. Forts de notre expérience, nous pouvons nous consacrer aux spécificités de notre travail de professeur documentaliste. Comment transposer en extérieur une progression où le numérique est généralement très présent ? De quelle façon proposer aux élèves une expérience du fonds aussi fluide qu’entre les quatre murs de notre lieu de travail ? Peut-on faire une part de gestion documentaire au dehors ou comment déplacer des panneaux d’exposition sans risquer de les voir endommagés par la pluie ? Les questions se suivent et ne trouvent pas nécessairement de réponse, voire essuient des refus dus à la méconnaissance de ce dispositif pédagogique de la part de la hiérarchie.
Cela étant, l’approche par besoin de remédiation peut être préférable en ce qu’elle permet d’avancer pas à pas. La transposition des méthodologies de travail en extérieur est coûteuse en énergie ? Dont acte, exigeons d’elle qu’elle nous aide à résoudre certaines situations peu satisfaisantes que nous rencontrons au quotidien. À propos de la consultation du fonds par les élèves pour commencer, des étagères « romans » peu consultées hormis pour la table des nouveautés peuvent trouver un second souffle dans un autre lieu, par roulement. Une série jamais utilisée s’emporter dans les sacs à dos pour un déplacement à proximité du collège ou dans la cour pour un temps de lecture partagée. Un ouvrage documentaire difficile à lire mais très utile pour l’une de nos progressions faire l’objet d’un arpentage, ce mode de lecture collaboratif développé dans l’éducation populaire. Les possibilités sont tout aussi variées concernant l’ouverture culturelle. Les expositions qui nécessitent tant de communication et de manutention ne trouvent pas leur public ? Une partie d’entre elles peut être plastifiée pour être exposée dehors et créer un cheminement vers le CDI. Posée en termes de résolution des préoccupations du quotidien, la place du dehors apparaît comme un outil très transversal et susceptible de servir nos différentes missions.
Une pédagogie hors les murs : quels savoirs pour quel public et quel profil d’enseignant ?
Au diagnostic de l’adéquation entre les activités menées au CDI et nos missions s’ajoute celui des savoirs et des publics concernés. La première image qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque la classe dehors est souvent relative à des élèves assis dans l’herbe et s’affairant à observer les insectes qui s’y meuvent. La réalité est plus diversifiée et ne se limite pas aux savoirs relatifs aux sciences naturelles. Si ces derniers sont très importants à acquérir, d’autres éléments peuvent contribuer à la reconnexion des élèves à la nature. Être attentif à la sensation du vent, aux bruits, même très urbains, qui les entourent, ou à la position dans laquelle le corps se trouve lors d’un exercice oral debout est très engageant pour un élève et peut se réaliser dans tous les cadres disciplinaires, information-documentation compris. Dans ce dernier cas, songeons également aux documents que nous choisissons lors de ces moments en plein air. Qu’il s’agisse de documentaires ou de romans, ils peuvent être écrits au moyen d’un vocabulaire rendant compte d’une relation différente au vivant et contribuer activement à la reconnexion des élèves à leur environnement.
Revenons au public concerné pour souligner que l’on effleure ici l’un des problèmes récurrents de la profession, celui du nombre d’usagers touchés par nos actions. Qu’il s’agisse du public des expositions, de la consultation du fonds ou du nombre de classes qui ont accès aux séances, l’impression de ne s’adresser qu’à une petite partie des élèves et, mécaniquement, d’en exclure une large part est récurrente dans les échanges professionnels. Le fait de transposer une partie des activités en plein air peut-il avoir un rôle à jouer sur ces aspects ? Notons pour commencer que les élèves réagissent souvent différemment en intérieur et en extérieur. Dans ce cadre peu habituel, ils développent un autre regard et parfois un nouvel intérêt pour les activités qui leur sont proposées. Plus encore, des élèves en difficulté sur le plan des apprentissages scolaires peuvent trouver à l’extérieur une autre façon de s’impliquer dans leur travail. D’autant plus lorsque l’évaluation s’y fait par compétences, puisque des aptitudes différentes de celles cultivées en intérieur sont sollicitées en plein air, telles que l’observation, l’écoute ou la mobilisation physique. Quelques années d’expérience nous ont convaincue que ce qui s’apprend dehors est assimilé, mémorisé puis réinvesti différemment, y compris par la suite en intérieur. Et que le plein air offre des possibilités de différenciation pédagogique beaucoup plus larges, y compris pour les élèves les plus scolaires qui, déstabilisés par ce nouveau cadre, peuvent éprouver des difficultés à s’y adapter. Ainsi, grâce à l’enseignement en plein air, la question du nombre d’élèves touchés se pose différemment. Il n’est plus question de compter en nombre de classes impactées, d’un point de vue quantitatif. Grâce à la pratique du plein air, c’est la perception de chaque élève dans une classe qui est modifiée, de façon qualitative. En cela, elle offre un lien privilégié avec les élèves et les collègues qui peuvent être amenés à co-animer ces séances. Une configuration qui nous est familière dans le cadre habituel du CDI et qui peut aisément être réinvestie en extérieur.
Avec cette question de la co-animation se pose celle des collègues avec lesquels les professeurs documentalistes peuvent être amenés à travailler sur ces séances en plein air. Précisons d’emblée que la menée de cours en extérieur est particulièrement adaptée à la présence de plusieurs enseignants, pour favoriser la différenciation que nous venons d’aborder. C’est d’ailleurs le cadre dans lequel nous avons travaillé la plupart du temps pour ces raisons. Reste à identifier les collègues candidats à une sortie régulière parmi les membres de l’équipe éducative. Deux profils se distinguent à ce sujet. Le premier concerne les enseignants dont le contenu disciplinaire est déjà lié au dehors. En SVT, le jardinage pédagogique ou l’observation de certains milieux justifient des sorties régulières, comme en histoire-géographie où la réalisation de cartes ou d’enquêtes peuvent constituer des cadres intéressants à investir pour la profession. On peut, dans le premier cas, proposer des progressions autour du document de collecte ou de la classification et dans le second un développement sur les outils libres de cartographie ou les différents codages de l’information et le passage de l’oral à l’écrit, parmi de très nombreux exemples. Les enseignants d’EPS sont quant à eux les véritables professionnels du dehors au sein des établissements. Un travail avec eux offre des perspectives de co-animation originales entre information-documentation et pratique sportive des élèves, pourquoi pas portées dans le cadre de l’enseignement de spécialité au lycée, en alternant séances au CDI et dans la cour.
En parallèle de ces collègues concernés jusque dans leurs programmes ou leur méthode d’enseignement, il existe une catégorie, bien plus vaste, qui regroupe tous ceux pour qui le dehors offre des possibilités inattendues. En mathématiques, avec des prises de mesure ou des exercices sur la géométrie dans l’espace, en français pour offrir un temps de lecture privilégié aux élèves, en philosophie pour débattre debout et prendre conscience des mouvements du corps, en langues vivantes pour acquérir le vocabulaire de la description, les cas de figure sont innombrables et méritent tous d’être explorés. Retenons pour lors que toutes les disciplines sont concernées et peuvent tirer bénéfice de quelques séances, voire séquences en extérieur. Cela induit que la préservation du vivant via la transmission de l’expérience de nature ne concerne pas que les collègues de SVT ou les plus aguerris en géographie physique. L’ensemble des enseignants peuvent y contribuer en proposant à leurs élèves de sortir à une fréquence régulière. Il en est de même pour les professeurs documentalistes. Ils sont nombreux à avoir reçu une formation en sciences humaines et sociales, et il leur est possible de la réinvestir en extérieur tout autant que les collègues de SVT, d’EPS ou d’histoire-géographie. Par ailleurs, leurs capacités à gérer un lieu est précieuse dès lors qu’il s’agit justement d’en changer. En effet, les professeurs documentalistes sont coutumiers des interactions avec leur environnement immédiat lors des échanges avec les élèves. Il en est de même pour les changements de posture physique des usagers lors d’une même heure de cours, ce qui n’est pas toujours le cas des collègues de discipline. Aussi, l’approche par compétences pratiquée depuis longtemps dans les progressions d’information-documentation s’avère particulièrement payante en plein air et permet de valoriser les apprentissages qui s’y épanouissent particulièrement telles que l’écoute, l’attention ou la coopération. Enfin, le rôle de support du professeur documentaliste pour certains de nos collègues reste valable dehors. De la même façon qu’il aurait à mener la barque lors des moments de recherche documentaire, il peut prendre en charge de nombreuses catégories d’informations récoltées et analysées dehors. Plus encore, en rendant plus difficile l’usage des écrans, le fait d’enseigner en extérieur affranchit le professeur documentaliste de son rôle de spécialiste du numérique donné par certains collègues et qui a le défaut de régulièrement le limiter à guider les élèves sur ordinateur ou à les dépanner, hors de tout contenu info-documentaire.
La formation : par qui et sur quels aspects ?
Lors des premières sorties, il est donc possible d’avoir à interagir avec un collègue lui aussi novice quant au dispositif pédagogique du plein air. Pour que les choses se passent au mieux et qu’un projet de classe dehors s’installe dans la durée, nous ne pouvons que conseiller de se former à l’exercice auprès des spécialistes de la question. De très nombreuses associations ont pour objet d’accompagner à la sortie nature et peuvent être un grand soutien lorsque les séances ont un objectif naturaliste. Des réseaux comme le FRENE ou les GRAINE régionaux permettent de retrouver facilement les associations situées à proximité. Les programmes de sciences participatives tels que « Vigie nature école » portés par le Muséum national d’Histoire naturelle ou les observations de microplastiques de la Fondation Tara océan sont intéressants pour la récurrence des sorties, la place donnée à l’information et la qualité scientifique.
Concernant la pratique orale en extérieur et la lecture, les DAAC peuvent également être des relais efficaces et mettre en lien avec des associations de spectacle vivant qui peuvent aider à la prise de parole en extérieur. L’Institut coopératif de l’école moderne (ICEM) relaie pour sa part les initiatives liées à la pédagogie Freinet tout en proposant des formations à celle-ci. Dans la même ligne, la Fabrique des Communs Pédagogiques (FabPéda) a, depuis le premier déconfinement, un rôle fédérateur des initiatives autour de la classe dehors.
Enfin, et même si cette liste n’est pas exhaustive, les questions transversales de pratique en extérieur ont donné lieu à plusieurs dossiers réalisés par le réseau Canopé ainsi qu’à des formations Magistère, de la maternelle au lycée (Pillot & Chanard, 20225). Sans dénier l’apport de ces formations en ligne, y compris pour les collègues éloignés des centres de formation, il faut souligner que rien ne remplace la rencontre en présentiel avec des acteurs de l’éducation en extérieur. À ce titre, plusieurs académies réfléchissent à proposer des sessions « classes dehors » dans leur PAF, pour le moment destinées aux collègues du premier degré.
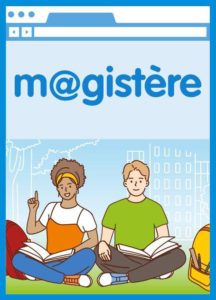
Conclusion : le CDI hors les murs, dépasser les freins et limites
Parvenue au terme de cette contribution, nous n’avons que brièvement abordé les problèmes concrets qui se posent à la profession en termes de sortie. Comment s’absenter du lieu auquel le professeur documentaliste est si souvent associé sans que cela soit considéré comme une défaillance ? Ou déplacer régulièrement des livres dans la cour du collège ou du lycée sans mettre en jeu sa santé au travail ? Peut-on sortir lorsqu’il pleut et comment gérer un groupe déjà compliqué en intérieur ? Ces questions sont légitimes mais ne peuvent appeler de réponse globale tant les situations sont spécifiques à chaque configuration d’établissement. On peut toutefois apporter au débat la notion de santé au travail. Nous nous sommes efforcée de présenter le dehors comme une corde de plus à l’arc qui permet au professeur documentaliste de se conformer à la circulaire de mission. Cela ne doit pas constituer une contrainte supplémentaire. Un froid hivernal est souvent plus supportable qu’une canicule et une pluie légère qu’un épisode de vent fort si tant est que tous les participants soient bien équipés, ce qui est loin d’être toujours le cas. Il vaut mieux alors, parfois, décaler une sortie prévue. De même, il convient d’être très attentif, par temps froid, aux élèves en situation de précarité énergétique à leur domicile et pour lesquels les salles de cours, même peu confortables, constituent peut-être la seule occasion d’être au chaud dans la journée. Dans un registre plus léger mais important quant aux conditions de travail, vous constatez que les élèves apprécient la sieste contée ou le fait de lire à l’ombre, dans la cour de récréation pendant leurs heures de permanence ? Ils peuvent donc participer à l’installation et au rangement en fin de séance sans que la manutention ne repose que sur le professeur documentaliste, l’acquisition d’un petit chariot pouvant aider dans bien des situations. La gestion d’un groupe pose souci ? L’emmener aux abords immédiats de l’établissement peut permettre de changer radicalement le cadre habituellement générateur de conflits.
La question du lieu de sortie est souvent décisive. Les configurations de cour de récréation sont très inégales et, hormis quelques rares exemples très récents, elles n’ont pas été pensées pour la pédagogie de plein air. Plusieurs solutions s’offrent aux collègues qui souhaiteraient extérioriser des séances. La première est de trouver un espace, non loin de l’établissement, et qui serait plus accueillant que ce que propose le collège ou le lycée. Les différents supports dispensés par Canopé ou la Fabpéda sont une aide pour éclaircir ce point, notamment du point de vue des autorisations. Un passage sur le site web de l’Office français pour la Biodiversité (OFB) donnera toutes les informations quant au montage de projet d’une aire marine ou terrestre éducative (AME et ATE), en partenariat avec une association. Il est également possible de demander à avoir accès à des zones de l’établissement interdites aux élèves lorsqu’ils ne sont pas sous la surveillance d’un adulte, car beaucoup d’EPLE en disposent. Par ailleurs, nous avons vu que le contenu des séances en extérieur ne requérait pas forcément la présence de faune ou de flore. Un environnement minéral peut tout aussi bien se prêter aux séances en plein air, dès lors qu’un peu d’ombre est disponible en cas de fort ensoleillement ainsi qu’une protection contre le vent et la pluie. Que les sorties se passent sur une terrasse, une pelouse ou dans la cour, un soin particulier doit dans tous les cas être porté au confort des élèves et de leurs enseignants. En pleine croissance, les adolescents ont besoin d’être bien installés, de préférence avec une possibilité de poser leur dos contre un dossier ou une surface rigide (mur, muret, chaises apportées pour l’occasion, tronc d’arbre, clôture, etc.), au moins lors des premières séances. Autoriser le mouvement, entre différents petits groupes par exemple, contribue également au confort de tous.
La quête du lieu propice peut aussi se traduire par un projet collectif de l’établissement, via le réaménagement de la cour. Sur la partie architecturale d’un tel dispositif, l’un des rôles du professeur documentaliste peut être de porter à la connaissance des différents acteurs la documentation disponible. Nous renvoyons ici transversalement aux ressources mises en ligne par les mairies, les CAUE, la page « Bâti scolaire » du Ministère et Canopé. Plus spécifiquement, le site de l’Enssib propose lui aussi des pistes intéressantes quant à l’achat de mobilier pour les bibliothèques souhaitant « sortir » leur salle de lecture, qui mériteraient d’être transposées au cas des CDI. Mais surtout, s’agissant de projets de longue haleine et aussi transversaux, leur inscription dans la partie « ouverture culturelle » de l’établissement est tout à fait possible. En collaboration avec les acteurs du collège ou du lycée intéressés, il est très stimulant d’accompagner les élèves souvent demandeurs sur le montage de ces projets. C’est par exemple ce qui a été proposé aux éco-délégués du lycée Renaudeau (Cholet 49). Réunir de l’information sur le sujet et les attentes de leurs camarades, communiquer autour du projet ont été autant de compétences travaillées avec l’équipe du CDI et des collègues de discipline en EMC notamment. Ces séances ont heureusement abouti, grâce au soutien de la Région Pays-de-la-Loire et de la direction de l’établissement, à la déminéralisation d’une partie de la cour en 2022, un projet pionnier dans le paysage des lycées français. En plus de la satisfaction de voir leur demande prise en compte par la collectivité, les éco-délégués ont eu celle de planter, avec de nombreux camarades, une mini-forêt à cet emplacement, grâce à une campagne de mécénat menée par une association locale (MiniBigForest). La pédagogie très différenciée menée en extérieur par le CDI à destination d’un petit groupe, comme nous le mentionnions plus haut, a ainsi eu des répercussions sur un ensemble beaucoup plus vaste d’élèves.
Ce type de projets, comme tous ceux qui concernent l’extérieur, contribue de façon évidente à développer l’autonomie des élèves. Plus encore, il leur permet de réaliser toute la portée de leurs actions et le fait de percevoir leur faculté à changer le cours des choses. Qu’il s’agisse d’empouvoirement, d’agentivité ou de capacitation, avec les spécificités de chacun de ces concepts (Maury & Hedjerassi, 2020), il est reconnu que la mise en action contribue très largement à faire baisser les émotions négatives telle que l’éco-anxiété, ce trouble ressenti par de plus en plus d’adolescents à l’égard de la crise de la biodiversité et du changement climatique. En tant que professeurs documentalistes, jour après jour, il est possible d’aider à créer ce sentiment de reprise en main de leur vie chez les élèves, dans la cour ou dans un jardin de la même manière qu’au CDI et de contribuer à proposer une éducation à l’Anthropocène de qualité. Après les épreuves que furent les confinements et leur suite pour nombre d’entre nous, faisons le pari de les accompagner sur le chemin de la construction d’un futur souhaitable grâce au dehors. Et puisqu’à plusieurs, on est plus fort, profitons de l’organisation des Rencontres Internationales de la Classe Dehors organisées à Poitiers du 31 mai au 4 juin pour nous rencontrer et oser cette pratique pédagogique enthousiasmante par bien des points.