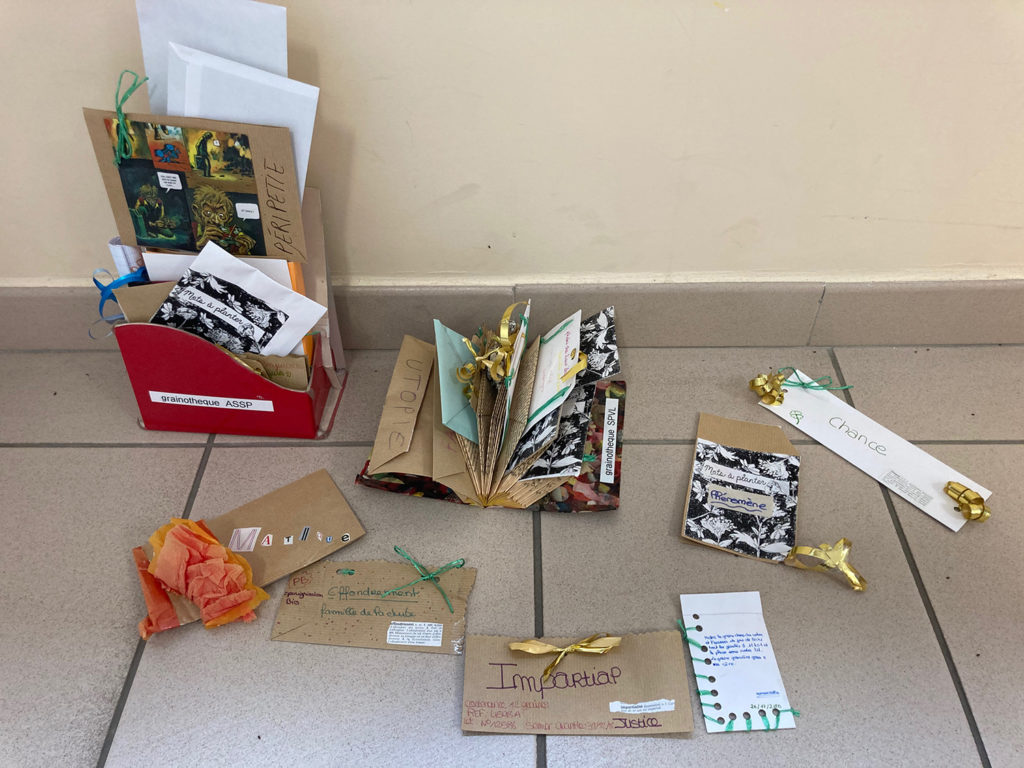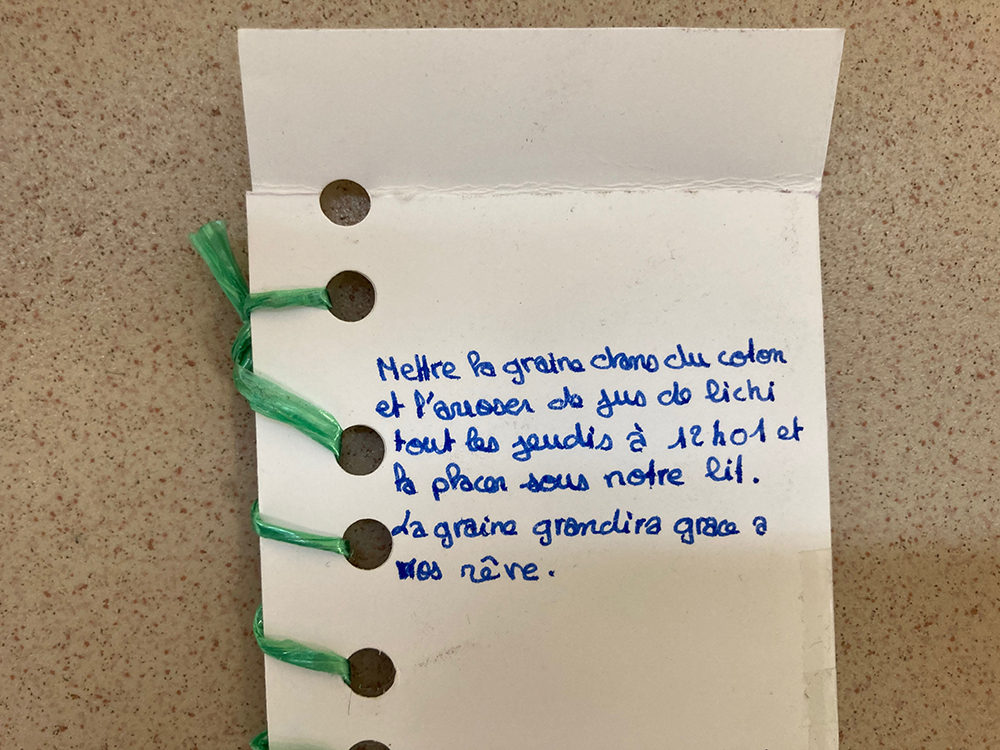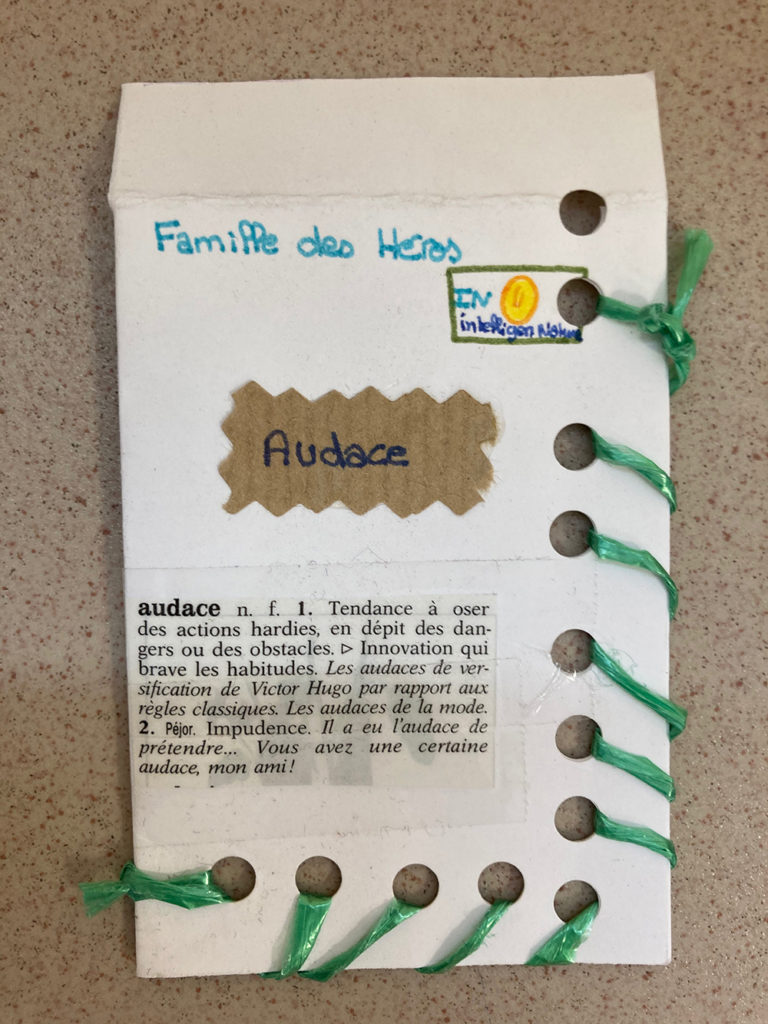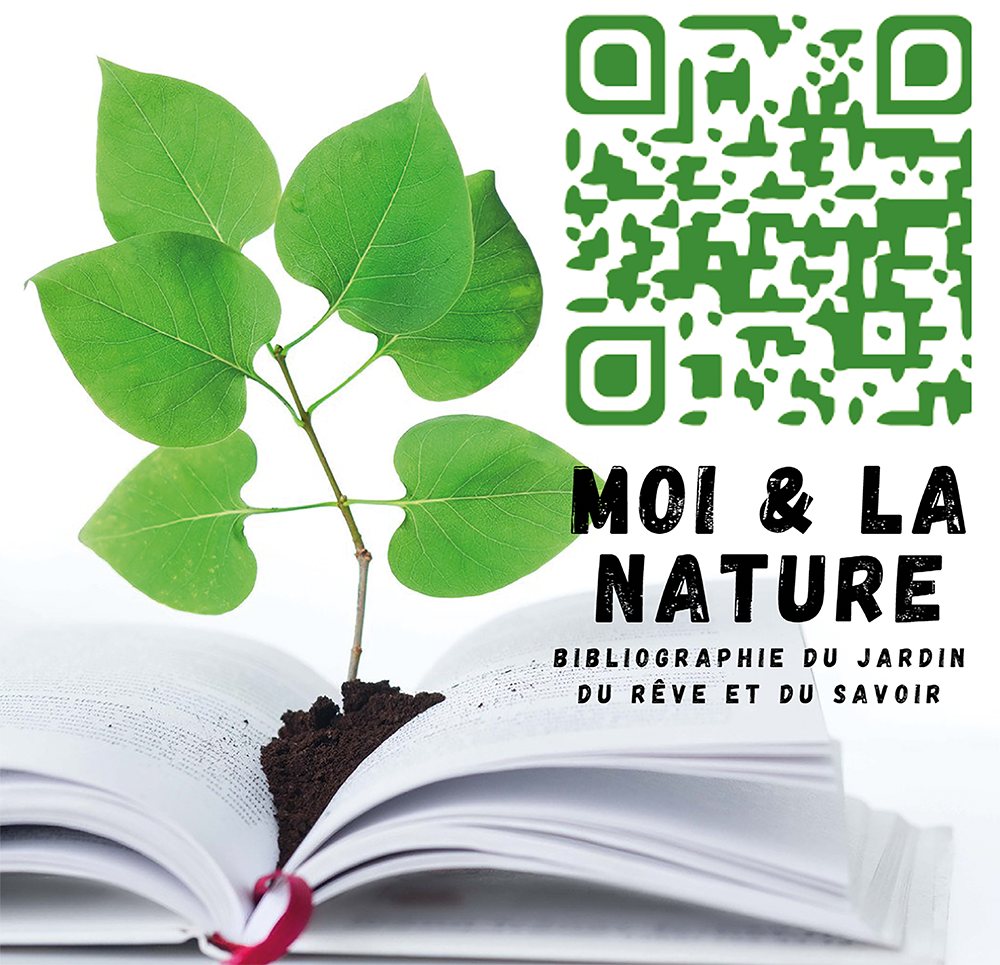L’urgence écologique telle que perçue par les jeunes, illustrée avec éclat par le succès du mouvement initié par Greta Thunberg en 2018, reste plus que jamais d’actualité en période de pandémie, et concerne très directement le professeur documentaliste. Le contexte institutionnel est celui d’un « renforcement de l’éducation au développement durable » (circulaire du 24 septembre 2020 du Ministère de l’Education nationale), dans le cadre de l’agenda 2030 mis en place par l’ONU. La question des rapports entre environnement et plus largement développement durable et bibliothèques préoccupe depuis longtemps les professionnels de la documentation aussi bien en France qu’au niveau international des institutions, des ONG et des états. Le mouvement des « bibliothèques vertes » est apparu dès les années 1970 pour la valorisation de la responsabilité des bibliothèques en matière d’éducation à l’environnement et dans les années 1990 pour la réflexion sur l’impact environnemental des bibliothèques. Monika Antonelli (2008) rappelle que l’expression « bibliothèque verte » (green library) renvoie au soutien militant à l’environnementalisme tandis que celle de « bibliothèque durable (ou soutenable) » (sustainable library) renvoie à l’exigence de ne pas dégrader l’environnement naturel. Cette définition est restrictive, la soutenabilité faisant souvent référence à d’autres dimensions que l’environnement naturel, et notamment aux questions de justice sociale, d’accès à l’éducation et de littératie informationnelle partagée. Concernant les CDI, qui correspondent, si l’on veut comparer les situations internationales, aux bibliothèques scolaires, le souci de travailler leur « soutenabilité » environnementale s’est accéléré au milieu des années 2000, avec la multiplication de publications, déclarations et conférences internationales consacrées au thème (UNESCO, IFLA, IASL, ECIL…). La question du CDI vert doit donc être considérée dans un contexte global, tant du point de vue des politiques publiques que de celui des cultures et des apprentissages en jeu. Elle dépasse très largement les « petits gestes » et une approche purement comportementale (le tri du papier, le nettoyage, le compostage, l’attention à la consommation d’électricité, la nomination d’éco-délégués) dont l’importance n’est pas négligeable. Mais ces gestes, pour sortir du risque de « green washing » d’un côté, du sentiment très partagé d’une catastrophe imminente et inévitable de l’autre, méritent d’être situés dans la promotion d’un véritable changement dans les modes de penser le monde dans ses équilibres et sa globalité par l’éducation, dans un « être au monde informationnel »1 complexe et la création des conditions de possibilité d’« agir localement pour penser globalement » (J. Ellul). Il s’agit de ne pas se satisfaire de gestes symboliques et de déclarations de principes sans conséquences, mais d’inscrire le CDI réel dans une dimension écosystémique, d’en faire un outil de médiation environnementale, d’engagement réel et collectif et de cognition située.
La dimension écosystémique : un CDI « soutenable »
Le premier constat est celui de l’appartenance de tout dispositif à un écosystème global qui l’inclut dans un environnement naturel, social, économique, politique, industriel, individuel. Cette prise de conscience des interactions entre systèmes et de leur complexité commence par la réflexion sur l’empreinte matérielle de l’espace du CDI considérée dans la dimension temporelle des activités qui s’y déroulent, des parcours qui s’y suivent, des devenirs qui s’y inscrivent. Mais s’il est possible d’intervenir sur l’empreinte environnementale quand on construit une nouvelle bibliothèque par exemple, ou quand on la rénove, à la condition que les professionnels participent à l’élaboration du cahier des charges des projets, c’est plus compliqué quand on travaille dans un CDI dont l’agencement est figé. Celui-ci n’est qu’un espace scolaire parmi d’autres, même s’il est central en principe, dans un établissement existant, dont les qualités environnementales dépendent de choix politiques et économiques qui relèvent notamment de la collectivité territoriale qui en a financé la construction. Les professeurs documentalistes sont rarement associés aux choix architecturaux. Ils doivent souvent « faire avec » un espace construit qui répond plus ou moins efficacement aux exigences environnementales (traduites par la norme ISO 140001 ou le label HQE par exemple), tant du point de vue des matériaux et de leur mise en œuvre, rarement inspirés de l’écoconstruction, que de celui de la qualité sensible des espaces et de l’intégration dans le territoire. Mais ce « faire avec » vaut la peine d’un travail sur l’aménagement intérieur et l’agencement des espaces, les choix du mobilier et des matériaux2 (respectant les normes pour la qualité de l’air, prenant en compte le cycle de vie des matériaux), l’attention à la qualité de l’« ambiance » au CDI (la lumière, l’acoustique, l’ergonomie, la température, l’accessibilité aux personnes handicapées, les circulations, le confort…), la maîtrise de la consommation, de la qualité environnementale et du recyclage du matériel, des consommables, des produits d’entretien, etc.
La dimension écosystémique comprend également la diversité fonctionnelle des espaces mettant en relation le CDI avec son environnement quand il participe à la création et à l’entretien d’un jardin partagé ou d’une grainothèque, qui n’est pas seulement une collection de graines mais le point de départ d’une réflexion sur l’appropriation privée des semences, ou quand un FabLab ou autre makerspace permet de valoriser le « faire », le partage de connaissances et de compétences, la coopération, la documentarisation de projets et la sensibilisation aux communs3. Il ne s’agit pas là de valoriser des gadgets par l’acquisition de matériels spectaculaires comme les imprimantes 3D, de créer des îlots technologiques ou des produits de communication d’un établissement, mais de mener un véritable travail sur la place de l’information et de la communication dans la prise de conscience et la mise en œuvre de projets collectifs qui engagent la collaboration, le souci de l’autre, la diversité des modes d’apprentissage et des compétences notamment psycho-sociales. Il s’agit de mettre en espace et dans le temps des cadres de perception du rapport nature/culture comme le proposent les anthropologues Philippe Descola et Tim Ingold (2014), pour prendre conscience de ses propres schèmes et les modifier éventuellement, pour les faire exister dans le monde réel et la vraie vie et pas seulement dans des discours moralisateurs sans lien avec les pratiques réelles et quotidiennes. On n’est pas loin ici du projet de Célestin Freinet pour qui l’enseignement passait nécessairement par l’expérience de la nature et la fabrique de l’information.
La dimension documentaire : un CDI médiateur
La conscience de la complexité des écosystèmes nécessite un travail de médiation qui revient en partie au professeur documentaliste. Une médiation documentaire d’abord. On pourrait même considérer le projet documentaire tel qu’il a été défini par les pères fondateurs de la documentation, Paul Otlet en tête, comme intrinsèquement lié à une préoccupation de durabilité. La documentation est un moyen d’habiter son territoire, de l’occuper à l’aide d’outils intellectuels qui permettent de le penser dans la globalité et dans la sphère publique. Dans cette perspective, la documentation qui peut servir de support à l’éducation à l’environnement et/ou au développement durable traite de questions complexes qui traversent les territoires balisés de la connaissance partagés en zones disciplinaires. Elle dessine un territoire cognitif pluriel, réticulaire et complexe. La complexité vient du fait que dans l’éducation à l’environnement et au développement durable, on vise des objectifs cognitifs (construire des connaissances complexes sur l’écologie, l’environnement, les équilibres globaux), transversaux (des connaissances qui traversent plusieurs domaines scientifiques et plusieurs disciplines scolaires), axiologiques (ancrer des valeurs « environnementales » par la prise de conscience des enjeux) et pragmatiques (pour inciter à l’action tout au long de la vie et dans tous les domaines) ; la connaissance est intrinsèquement liée à un projet social et politique, à la représentation de l’avenir, à un projet global. La documentation est donc nécessairement prescriptive et pas seulement descriptive, elle identifie des enjeux et fonctionne sur des systèmes de valeurs, comme le montre Susan Kovacs (2012).
La complexité tient aux contenus scientifiques d’abord. Pour bien la comprendre, il suffit de considérer les systèmes de classification des connaissances. Les classifications documentaires reflètent les représentations sociales de la réalité, des savoirs et de leurs relations et les paradigmes dominants à un moment donné. Or le concept de développement durable résiste souvent à la logique du classement quand il n’intègre pas le principe des facettes, par ailleurs peu utilisable quand il s’agit d’attribuer des cotes aux documents pour les ranger. Le professionnel de la documentation choisit ainsi souvent de valoriser un élément dans son indexation (l’écologie par exemple, avec les sciences) pour permettre aux élèves et aux enseignants de trouver les documents, en abandonnant d’autres éléments (les dimensions sociales par exemple).
La complexité tient ensuite à la diversité des discours en circulation sur l’environnement et le développement durable sur les réseaux socio-numériques notamment, qui renvoient aux champs scientifiques, médiatiques, ainsi qu’aux communautés qui associent savoirs et pratiques (les Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle par exemple), et à bien d’autres qui ne révèlent aucune légitimité scientifique ni pratique mais des tentatives d’instrumentalisation plus ou moins lisibles ; on peut citer l’anthroposophie et les multiples théories « New Age », les millénarismes ou le négationnisme du réchauffement climatique. La constitution de corpus documentaires pour l’éducation à l’environnement conduit ainsi à mêler des niveaux de discours en tenant compte des contextes de production et d’usage qui vont de la généralité à la spécialisation (initiés, experts, scientifiques) à partir des critères des fonctions, du contenu, de la discipline, de l’autorité et de l’espace. La sélection ou le guidage sont nécessaires dans une documentation dont l’autorité et la légitimité ne sont pas aisément identifiables par les élèves, et parfois difficilement par les éducateurs qui ne sont pas eux-mêmes des experts. L’environnement constitue un territoire informationnel et discursif très étendu sur lequel se nouent des alliances complexes et éclatent des conflits, parce qu’il constitue une « question vive ». Pour de nombreux acteurs, l’information diffusée est une ressource stratégique qu’ils exploitent. Même dans le cas de l’information scientifique, produite et diffusée par des chercheurs, et qui peut être considérée comme fiable a priori, la commande et le financement restent déterminants dans les directions prises par la recherche et sa communication4. Il est essentiel de savoir qu’une ressource documentaire sur l’énergie est financée par le Commissariat à l’énergie atomique ou le réseau associatif Sortir du nucléaire, qu’un débat sur le glyphosate ou les algues vertes est proposé par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ou la Confédération paysanne. Les industries financent une partie de la recherche et tentent d’influencer les politiques par l’intermédiaire des lobbies et des discours médiatiques en circulation. Autour des questions environnementales en particulier, toute information doit être précisément située pour en saisir la complexité et les enjeux. La médiation reste donc indispensable pour le développement d’une culture scientifique et critique qui peut passer par des actes de vulgarisation, tout au moins de simplification, et par la mise en relation d’acteurs divers, scientifiques, professionnels, médiateurs. C’est précisément la difficulté du repérage dans ces territoires informationnels complexes qui rend indispensable l’acte éducatif par, avec et sur le document.
«
L’environnement constitue un territoire informationnel et discursif très étendu sur lequel se nouent des alliances complexes et éclatent des conflits, parce qu’il constitue une « question vive.
»
La dimension culturelle : un CDI apprenant et engageant
La culture de l’information est au cœur de la réflexion sur le « CDI vert », car au-delà de l’espace et du système d’organisation des connaissances, c’est la visée éducative qui importe de façon centrale, et le travail autonome d’élèves qui pourront, dans leur vie, se sentir capables de s’informer, d’apprendre et d’agir, de participer aux décisions qui concernent la collectivité, de critiquer les informations. Le développement de ce pouvoir d’apprendre passe par l’esprit d’enquête préconisé par John Dewey dans l’éducation, un esprit qui façonne, selon lui, la démocratie en imposant à chacun le devoir de s’informer, de critiquer et d’agir. On peut parler d’esprit critique associé à l’engagement, dans le souci de saisir la complexité des phénomènes sans craindre la nécessité de réponses politiques aux questions environnementales. L’engagement relève d’une dynamique qui repose sur le sentiment de pouvoir agir, d’avoir les capacités (le sentiment d’efficacité personnelle mis en relief par Alberto Bandura), la motivation et la légitimité pour le faire. Le soutenir est un objectif important, dans un contexte où le catastrophisme, le défaitisme et le renoncement peuvent avoir des conséquences sur la perception des questions environnementales et les représentations de leur avenir par les élèves, tiraillés entre un élan vers la mobilisation et le sentiment qu’il est trop tard ou que l’école n’est pas le lieu d’une action possible.
Les paradigmes de l’éducation à l’environnement ont évolué. Philippe Meirieu (2001), dans un article de réflexion sur l’éducation à l’environnement, en propose quatre : le paradigme encyclopédique (la nécessité de construire un objet de savoir nouveau), béhavioriste (la nécessité de faire acquérir aux élèves des comportements adéquats), systémique (la nécessité de penser le monde comme une totalité), critique (la nécessité de former des citoyens résistants). On peut ainsi distinguer une éducation sur l’environnement, centrée sur les savoirs, une éducation pour l’environnement, centrée sur le changement social et politique dans une perspective critique, et l’éducation par et dans l’environnement, centrée sur le rapport pragmatique des individus à leur environnement. L’éducation à l’environnement vise la construction d’une culture liée à l’action future de l’élève, l’action sur le monde et pas seulement sa compréhension, même si la démarche scientifique reste centrale. Elle met en jeu une multitude d’acteurs, au premier rang desquels se trouvent les enseignants et les intervenants extérieurs, l’écosystème informationnel et culturel de l’établissement. Pourtant, comme le souligne Anne Versailles (2002), la fragmentation du temps scolaire, le découpage disciplinaire et la formation des enseignants sont souvent des obstacles majeurs à la mise en place de projets d’éducation à l’environnement qui associent les enseignants et des intervenants extérieurs, qui dépassent l’opposition entre une perspective cognitive et une perspective béhavioriste et entre les disciplines. Les professeurs documentalistes jouent souvent un rôle intermédiaire d’animateurs de projets et de médiateurs en lien avec les enseignants de disciplines. André Giordan (2008), qui propose une approche systémique des concepts constitutifs de l’éducation à l’environnement, met la maîtrise de l’information au centre des démarches à mettre en œuvre. Pour les acteurs de l’éducation à l’environnement, l’enjeu informationnel et documentaire est donc essentiel. La culture de l’information suppose une approche spécifique de la documentation qui prend en compte la transversalité des concepts et la multiplicité des échelles de compréhension et d’action, d’une part, la nécessité d’une mise en projet d’autre part, dont l’objectif reste l’autonomie des élèves dans la mise en œuvre d’un agir citoyen responsable à partir de pratiques informationnelles existantes plus que l’accumulation de connaissances académiques. Elle permet de construire le lien entre le territoire local (qui suppose de sortir de l’établissement scolaire) et une réflexion globale, entre la complexité et le compréhensible, entre la sphère privée des connaissances individuelles et des pratiques d’information et la sphère publique du débat.
Un exemple intéressant dans cet apprentissage de la reliance et de la complexité est celui des cartographies de controverses, au sens proposé par Bruno Latour et Michel Callon. La controverse est « une situation où les incertitudes usuelles du social, de la politique, de la morale se trouvent compliquées par l’instabilité des connaissances scientifiques ou techniques et l’absence de « faits indiscutables ». Si ces controverses ne sont pas limitées au cercle étroit des spécialistes et qu’elles doivent trouver des échos dans l’espace public, elles supposent pourtant toujours des débats autour des connaissances d’ordre scientifique5. Travailler sur la controverse permet de rendre compréhensible et acceptable la complexité du réel, la diversité des points de vue possibles sur une question, même scientifique ou technique, la construction de la pensée en action, l’importance de connaître la source des informations et de les évaluer, la différence entre connaissance et opinion, la signification d’un positionnement et d’un argument dans une controverse, les fondements mêmes de la communication. La démarche d’investigation caractéristique de l’éducation aux médias et à l’information est particulièrement sollicitée dans ce type de proposition pédagogique, qui permet d’enquêter sur des questions réelles et réellement débattues, de déconstruire les débats et les arguments, d’en saisir les enjeux, les intérêts et les systèmes de valeurs sous-jacents, les jeux de langage et de rhétorique engagés dans les discours. De la même façon, la cartographie à partir de données ouvertes6 s’appuie sur une démarche de communs, le développement d’une culture de la donnée, qui inclut une dimension technique, et permet de travailler sur la création de connaissances situées sur le territoire.
Enfin, l’éducation à l’environnement vise la construction d’une raison pratique susceptible d’inclure le citoyen dans la sphère publique. Elle est liée à un usage anthropocentrique des sciences comme matière première d’une opinion raisonnée pour la participation au débat public. Cette dimension pragmatique et politique pose problème parce qu’elle questionne le rapport entre les questions scientifiques et les questions sociales et le statut épistémologique des savoirs. Même si elle dérange les territoires cognitifs par la complexité et la multi-dimensionnalité, les enseignants partagent l’idée qu’il faut tirer parti de l’appartenance au territoire local pour faire prendre conscience aux élèves des conséquences globales des actions individuelles, et considèrent comme des situations jugées formatrices, outre les études de cas, l’observation ou le cours magistral, la recherche d’information et la mise en débat. Cette dernière pose toujours le problème de l’expertise dans l’approche de l’environnement. Dans une proposition intéressante, Joëlle Zask suggère de refuser l’expertise et de la remplacer par la création d’un espace partagé entre les scientifiques et les citoyens, un espace de proximité instituant un environnement commun. De la même façon, Anne Versailles propose de renoncer à la culture de l’archivage basée sur l’accumulation linéaire de connaissances organisées pour évoluer vers une culture de « construction émergente » plus dynamique, axée sur les réseaux et la co-construction d’une intelligence collective. Ces propositions supposent que la démarche expérimentale privilégiée dans les projets d’éducation à l’environnement ne soit pas exclusive d’une démarche documentaire qui permette d’ouvrir le champ à la réflexion. C’est ce qui ressort de certains projets menés dans les lycées notamment, à travers des travaux basés sur des recherches documentaires et/ou la rencontre avec des chercheurs autour de questions complexes. La mise en débat et la valorisation de la complexité sont sources d’incertitude, voire d’anxiété, mais aussi de curiosité dans la création de conflits cognitifs qu’il revient aux enseignants d’accompagner. Et l’éducation à l’information vise notamment l’acceptation de l’incertitude caractéristique des connaissances sur l’environnement et le développement durable comme de la démarche scientifique.
Qu’il s’agisse de repenser les espaces-temps des apprentissages, les systèmes d’organisation des connaissances ou les modalités des apprentissages, le professeur documentaliste dans le CDI est appelé à jouer un rôle central dans la prise en compte des dimensions environnementales de l’éducation et dans l’impulsion de projets d’éducation critique au développement durable articulés aux cultures de l’information.
«
Qu’il s’agisse de repenser les espace-temps des apprentissages, les systèmes d’organisation des connaissances ou les modalités des apprentissages, le professeur documentaliste dans le CDI est appelé à jouer un rôle central dans la prise en compte des dimensions environnementales de l’éducation.
»