Hormis les enseignants exerçant dans les filières tertiaires des lycées d’enseignement techniques et des lycées professionnels, peu d’entre nous connaissent les éditions EMS pour « éditions management & société ». Ce petit éditeur provincial (plus exactement normand) publie, depuis 1997, des ouvrages universitaires ou professionnels liés à la filière managériale. Cependant, son offre se diversifie et les livres, publiés en version imprimée et en version numérique, sont diffusés en France et à l’étranger francophone par les éditions Eyrolles sauf en Belgique où ems passe par la société Patrimoine3. Auprès de mes lecteurs, Pascal Lardellier n’est pas un inconnu. Tout d’abord parce que nous formons tous deux, depuis plus de huit ans une équipe de travail. Rapprochés par nos thèmes de recherche ainsi que par la concomitance de nos publications respectives ou communes relatives aux usages et mésusages du numérique par les adolescents et préadolescents, il ne faut donc pas que nos lecteurs respectifs soient surpris par des approches semblables, des réflexions partagées et des analyses très proches. Pascal Lardellier avait marqué la première remise en cause du mythe des « enfants de l’ère numérique » développée par Marc Prensky et ses « disciples » français, tel Michel Serres avec son ouvrage Petite poucette4. Ce mythe, devenu dogme, présente les jeunes nés avec les ordinateurs connectés, les consoles de jeux vidéo et les ordiphones5, comme porteurs d’une nouvelle culture numérisée peu accessible aux adultes.
D’ailleurs Marc Prensky désigne le digital native comme le tuteur des adultes, comme celui qui apprend à ses parents et à ses enseignants, ces derniers devenant les immigrants de l’ère numérique6. En 2006, paraissait l’ouvrage de Pascal Lardellier Le Pouce et la souris, enquête sur la culture numérique des ados7, bousculant le dogme de la primauté d’une jeunesse numérisée imposé par les plus hautes autorités du ministère de l’Éducation nationale, des universitaires et nombre d’élus. C’était un coup de tonnerre ébranlant les certitudes proclamées, bousculant les a priori les mieux établis et brisant une
forme d’omerta interdisant toutes les remarques, même les mieux fondées, relatives aux mésusages du numérique par une jeunesse de plus en plus connectée et de moins en moins attentive aux exigences de l’institution scolaire. Ce livre a fait date, permettant à d’autres chercheurs, comme Catherine Blaya8, Michelle Bergada9 ou moi-même10, 11 de s’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte.
Aujourd’hui, Génération 3.0, en 160 pages regroupées en une introduction, quatre chapitres, et une conclusion, balaie ces dix dernières années, de 2006 à 2016 auscultant notre société à travers sa jeunesse constamment branchée.
La fable des jeunes, des TIC, des puces, du chat et des souris
En un constat qui refroidit les ardeurs des « technolâtres », Pascal Lardellier montre des Jeunes, qui loin de vouloir « changer le monde » comme la génération des « ex-soixante-huitards » voulaient « changer la vie », ne songe qu’à s’amuser via les activités ludiques si généreusement offertes sur le Net. À vrai dire l’auteur s’intéresse à la face cachée d’Internet, celle où les jeunes naviguent seuls sur leurs machines dans un monde virtuel proposant tant de possibilités et recelant tant de dangers.
Les jeunes, Internet et la société (de demain)
La première partie commence par un constat maintes fois repris par les partisans comme par les opposants à une société complètement connectée : la jeunesse née avec le téléphone portable et Internet surfe quotidiennement des heures durant. Que faut-il en déduire ? Quels sont les liens entre la vie connectée et la vie réelle, entre les amis de Facebook et ceux de chair, entre l’appel du Net et la solitude ? Pascal Lardellier invoque Dominique Wolton, Antonio Casilli et Pierre Lévy pour circonscrire une problématique complexe. Il sollicite aussi les grands classiques, Diderot, d’Alembert et Malraux tout en sachant que les « humanités numériques » d’aujourd’hui ont peu de rapports avec les « humanités » d’hier.
À vrai dire Pascal Lardellier imagine un monde où les adultes acceptent de mettre en oeuvre la « dialectique numérique ». Selon le lexique complétant le livre, ce concept revendiqué par l’auteur « consiste à utiliser les TIC de façon optimale à des fins pédagogiques et culturelles » en partant d’une réalité volontairement ignorée par les « technolâtres » : la dextérité des jeunes à utiliser les technologies ne leur permet pas de vérifier les sources, de trier et de hiérarchiser les informations. Elle ne les autorise pas, non plus, à avoir accès à la culture. Pascal Lardellier prône ce que prêchent les professeurs documentalistes en lui donnant un sens, une force nouvelle à travers la « dialectique numérique ». Pour faire comprendre le raisonnement engagé, l’auteur s’interroge sur le rôle de l’éducation affirmant que la mécanique ne peut remplacer l’apport des adultes, d’autant que les TIC renforcent les stéréotypes sexuels, les sports et la violence pour les garçons et les « potins », le maquillage et la vie des starlettes pour les filles.
Nouvelle remarque, les étudiants ne savent plus analyser et construire un exposé ou une dissertation autrement que par un bricolage peu pensé de « copier/coller/imprimer » pris sur Internet. Pascal Lardellier soutient que l’éducation aux médias est défaillante, car l’institution scolaire comme la famille se trouvent dépossédées de leur pouvoir de contrôle et de transmission en raison du temps passé devant les écrans par les jeunes. Car le numérique n’est pas l’eldorado prévu du creuset d’une nouvelle culture égalitaire. Internet, loin de supprimer les inégalités socioculturelles les aggrave contrairement aux affirmations d’un Michel Serres.
La démocratisation des outils numériques n’a pas amélioré l’accès à la culture et les médiations des adultes restent indispensables à la transmission des valeurs et de la culture. Supprimer les enseignants au profit de la seule médiation technique permettrait de recréer un élitisme entre ceux qui savent utiliser les techniques et ceux qui se contentent de jouer avec, entre ceux qui ont eu accès très jeunes à la culture leur permettant de dominer les machines communicantes et ceux qui n’ont pas eu cette chance.
Pascal Lardellier insiste sur l’importance des rites lors de la transmission des savoirs et de la culture et de leur disparition par une transmission robotisée. Alors, la tentation d’une réponse technique et désincarnée du savoir aux graves problèmes des banlieues ou des campagnes relève d’une dangereuse utopie. Au fond, Lardellier pose la question de la critique d’Internet dans des termes semblables à ceux utilisés, il y a 15 ans, par Philippe Breton12. Et comme chacun de ceux qui osent remettre en cause le dogme de la modernité « c’est nouveau, donc c’est un progrès », Pascal Lardellier est obligé de se justifier en affirmant qu’il n’est pas technophobe. Cette première partie pose tant un constat fondé sur l’observation d’une réalité mouvante qu’un cadre conceptuel.
Des souris et des jeunes
La deuxième partie tend à une analyse des défaillances d’experts qui n’entendent pas les alertes des enseignants et des parents et d’un système journalistique qui privilégie la vision d’un savoir-faire technologique des jeunes marginalisant les adultes.
Comme certains d’entre nous, Pascal Lardellier a sondé ses étudiants. Ils sont tous porteurs d’un ordiphone, possèdent un ordinateur, ont ouvert un compte Facebook et consultent systématiquement Wikipédia pour répondre aux demandes des enseignants ; les mêmes avouent également ne pas acheter de journaux des mois durant. L’auteur pense que la fracture numérique est une fracture générationnelle, les moins jeunes et les anciens étant plutôt « accros » à la télévision qu’à l’ordinateur connecté. Le rédacteur s’étend par la suite sur la cyber-addiction à propos de laquelle nous avons récemment écrit un livre commun13. Il revient d’ailleurs sur les violentes critiques que nous avons subies lors d’échanges « musclés » avec les tenants d’un « angélisme numérique » qui nient avec virulence une réalité bien établie par les psychiatres. Un exemple évoqué du temps passé, dès le tout jeune âge, devant les écrans est amusant : une petite fille de 4 ans récite l’alphabet « s, t, u, v, www, x, y, z » ; le triple « w » dévoile bien l’influence des claviers et des écrans sur les jeunes esprits.
Revenant sur le développement idéologique proposé par Marc Prensky et les siens qui prévoient un homme « bionique », « augmenté » etc. Pascal Lardellier leur demande comment faut-il interpréter la disparition dans leurs conférences et leurs écrits des adultes qui induisent, orientent et interdisent.
L’auteur constate aussi cette distorsion entre le rythme lent de l’école et du livre avec l’immédiateté de la trépidante vie connectée de nos adolescents devant réagir promptement à toute sollicitation des réseaux sociaux. Les jeunes subissent en continu cette injonction à céder à l’instantanéité qui s’accompagne de la méconnaissance des règles de droit, en dépit du B2i et du C2i. Car cette génération passe l’essentiel de son temps face à des écrans en dehors des adultes, parents ou enseignants qui ne peuvent les « recadrer ». L’hyperconnectivité reste ludique, solitaire et hors du contrôle parental.
Les adultes sont aussi désarmés idéologiquement par la diffusion à grande échelle de la « nouvelle religion de la communication » qui met en exergue le « jeunisme ». Évidemment, les limites d’âge sont facilement contournées en ce qui concerne les jeux vidéos d’une extrême violence et la pornographie, prenant ainsi la forme de nouveaux rites de passage. C’est une évidence pour notre auteur spécialiste des rituels liés à Internet14.
Les jeunes et la culture à l’ère d’Internet
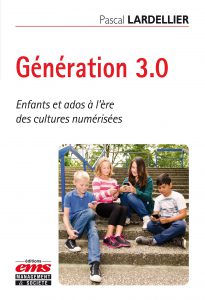 La troisième partie scrute les relations devenues très (trop) souples entre notre jeunesse et la culture. Les enquêtes PISA convergent avec les analyses les plus pessimistes. Faut-il avoir la foi dans une vision rousseauiste et cybernétique qui exclut l’enseignant de la transmission réservant cette dernière à une initiation entre pairs via la technologie ? Pascal Lardellier répond à cette problématique par la négative en dépit des « serious games » et autres MOOC. Car si Internet démocratise l’accès à la culture, cette dernière reste réservée à ceux qui peuvent décrypter Internet. Cette démocratisation technologique est un trompe-l’oeil, car elle incite à la paresse intellectuelle et empêche l’esprit de créer des rapprochements, de chercher des solutions autres que celles présentées toutes faites sur le Net. Dès lors, les enseignements, les enseignants et l’École perdent leur légitimité, leur autorité au profit d’une remise en cause permanente qui, bien souvent, ridiculise l’enseignant au profit d’un solutionnisme technologique15 souvent limité aux toutes premières occurrences offertes par Google lors de recherches effectuées à la demande des enseignants.
La troisième partie scrute les relations devenues très (trop) souples entre notre jeunesse et la culture. Les enquêtes PISA convergent avec les analyses les plus pessimistes. Faut-il avoir la foi dans une vision rousseauiste et cybernétique qui exclut l’enseignant de la transmission réservant cette dernière à une initiation entre pairs via la technologie ? Pascal Lardellier répond à cette problématique par la négative en dépit des « serious games » et autres MOOC. Car si Internet démocratise l’accès à la culture, cette dernière reste réservée à ceux qui peuvent décrypter Internet. Cette démocratisation technologique est un trompe-l’oeil, car elle incite à la paresse intellectuelle et empêche l’esprit de créer des rapprochements, de chercher des solutions autres que celles présentées toutes faites sur le Net. Dès lors, les enseignements, les enseignants et l’École perdent leur légitimité, leur autorité au profit d’une remise en cause permanente qui, bien souvent, ridiculise l’enseignant au profit d’un solutionnisme technologique15 souvent limité aux toutes premières occurrences offertes par Google lors de recherches effectuées à la demande des enseignants.
Pascal Lardellier accepte mal un enseignement dépendant de plus en plus du numérique, car les résultats ne sont pas probants. Il donne de nombreux exemples, les professeurs documentalistes pourraient en citer mille autres pour compléter le tableau proposé comme celui des élèves se précipitant sur Google, Wikipédia et imprimant deux ou trois pages directement sans aucune véritable recherche, sans même avoir lu le contenu édité.
En guise de remédiation, l’auteur propose le concept de « dialectique numérique » qui consiste à :
- trouver des informations légitimées ;
- les sélectionner ;
- les hiérarchiser ;
- les vérifier en les recoupant ;
- les exploiter ;
- rédiger à partir de cette compilation un document (rédaction, exposé, etc.);
- écrire en bon français et sans fautes d’orthographe.
Cette proposition dialectique, rappelle fortement les fondements mêmes des métiers liés à la documentation, au monde des bibliothèques et à l’enseignement. C’est certainement ce qui pousse le rédacteur à valoriser le corps des professeurs documentalistes. Par ailleurs, Pascal Lardellier revient sur l’importance des enseignants « humains » dans la transmission des savoirs et de la culture assumant pleinement cette position considérée comme passéiste, voire réactionnaire par beaucoup de partisans du tout numérique à l’école.
Éloge des médiateurs à l’ère des « désintermédiations » et éloge de la Génération 3.0
La dernière partie, très courte, est liée à la conclusion intitulée : « des conseils, vraiment ? ».
Pascal Lardellier s’oppose autant à un optimisme béat qu’à une critique systématique. Partant du constat que les écrans ont complètement colonisé la société, il constate que nous devons faire avec. Mais, les parents et leurs enfants n’ont plus la même façon de fonctionner et d’utiliser les technologies de la communication. Il faut donc que les adultes permettent aux jeunes de prendre un recul critique face aux outils magiques que le numérique met à leur disposition. Mais de leur côté, les jeunes de la Génération 3.0 doivent admettre que la dextérité sur un clavier n’est pas suffisante. Jeunes et moins jeunes doivent s’enrichir mutuellement. La parentalité médiatique doit préserver l’espace secret de chacun des jeunes tout en inculquant de notions de hiérarchie et d’ordre qui sont absentes du Net.
Entre espoir fou et appréhension, entre euphorie technologique et peur irraisonnée des TIC, Pascal Lardellier espère apporter une voie médiane conjuguant raisonnablement le numérique éducatif, l’enseignement et la transmission culturelle entre générations. Dans le cadre de la préparation au Capes de documentation, c’est assurément un livre à lire et à méditer.
