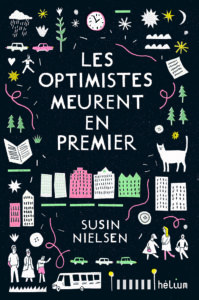«On choisit pas ses parents1»
Le dictionnaire Larousse définit la famille comme un « ensemble formé par le père, la mère (ou l’un des deux) et les enfants ». Les parents sont ainsi, culturellement, les premiers protagonistes de la famille puisqu’ils en sont à l’origine. Ils le sont également en littérature jeunesse, qui est un lieu de représentations de différentes structures familiales comme c’est le cas pour Violette, dans Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ? de Susin Nielsen. À douze ans, de parents divorcés, l’adolescente a vu son père refonder une famille et sa mère enchaîner les prétendants, chacun avec plus de défauts que le précédent… À l’arrivée de Dudley Wiener, elle décide de prendre les choses en main en contactant George Clooney et en filant le nouveau venu. Hors de question de laisser sa mère sortir encore avec un looser ! Violette s’inquiète pour sa mère et pour ce qu’il adviendra de leur relation à l’installation pérenne d’un nouvel homme dans sa vie. Le roman garde un ton léger où les situations comiques s’enchaînent, posant sur la table un sujet qui concerne nombre d’élèves : celui de la famille recomposée.
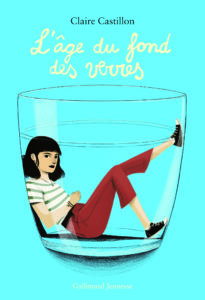 Les parents sont également source de nombreux questionnements, comme c’est le cas pour Guilène, dans L’âge du fond des verres de Claire Castillon. Avec ses parents, elle a de très bonnes relations, des petits rituels pleins d’amour et elle peut parler de tout (ou presque !). Mais en entrant en classe de sixième, elle va découvrir qu’ils sont un peu différents de ceux des autres élèves du collège, ils sont… plus âgés, bien plus âgés. Cette différence – qui va finalement se révéler ne pas être si embarrassante – va lui procurer un sentiment de honte et remettre en question les relations intra-familiales. C’est la même émotion qui agite Mo dans Y’a pas de héros dans ma famille de Jo Witek. Le roman aborde la honte et le sentiment d’infériorité lié à la classe sociale. Pour le petit garçon de fin d’école primaire, il y a deux mondes : celui de l’école – où l’on fait attention à son comportement et à son expression – et celui de la maison où le langage est familier, où la famille nombreuse s’agite et parfois s’affole. Un jour, en se rendant chez un camarade de classe, il découvre avec stupeur une immense maison où tout se passe comme à l’école et où les photos de chaque « héros » (prix Nobel de médecine, avocat…) sont accrochées au mur. Mo ressent alors de la honte à l’idée d’appartenir à une famille où il n’y a pas de héros. Son inconfort, ses doutes et ses questionnements sont perçus par ses parents qui réussiront à créer un magnifique moment de cohésion rattaché à l’histoire familiale.
Les parents sont également source de nombreux questionnements, comme c’est le cas pour Guilène, dans L’âge du fond des verres de Claire Castillon. Avec ses parents, elle a de très bonnes relations, des petits rituels pleins d’amour et elle peut parler de tout (ou presque !). Mais en entrant en classe de sixième, elle va découvrir qu’ils sont un peu différents de ceux des autres élèves du collège, ils sont… plus âgés, bien plus âgés. Cette différence – qui va finalement se révéler ne pas être si embarrassante – va lui procurer un sentiment de honte et remettre en question les relations intra-familiales. C’est la même émotion qui agite Mo dans Y’a pas de héros dans ma famille de Jo Witek. Le roman aborde la honte et le sentiment d’infériorité lié à la classe sociale. Pour le petit garçon de fin d’école primaire, il y a deux mondes : celui de l’école – où l’on fait attention à son comportement et à son expression – et celui de la maison où le langage est familier, où la famille nombreuse s’agite et parfois s’affole. Un jour, en se rendant chez un camarade de classe, il découvre avec stupeur une immense maison où tout se passe comme à l’école et où les photos de chaque « héros » (prix Nobel de médecine, avocat…) sont accrochées au mur. Mo ressent alors de la honte à l’idée d’appartenir à une famille où il n’y a pas de héros. Son inconfort, ses doutes et ses questionnements sont perçus par ses parents qui réussiront à créer un magnifique moment de cohésion rattaché à l’histoire familiale.
L’inconfort, c’est également ce que ressent Ware dans Le Château des Papayes de Sara Pennypacker. Celui-ci a du mal à trouver sa place dans la famille, dans le sens où il ne correspond pas aux attentes de ses parents. Mal à l’aise dans les interactions sociales, Ware préfère se réfugier dans les histoires qu’il invente grâce à son imagination débordante. Au fil du roman, à la suite de la rencontre avec une jeune fille à côté du centre aéré où il est censé passer ses vacances et la venue de son oncle qui se reconnaît enfant, Ware va affirmer sa personnalité et renouer le lien avec ses parents en leur montrant le poids de leurs attentes et la force de ses rêves. C’est à nouveau une thématique qui peut toucher les élèves : comment développer sa propre personnalité face aux attentes de ses parents ? Comment se détacher de l’image que leurs parents ont d’eux ? Dans ce texte, l’ouverture sur d’autres membres de la famille (son oncle, sa grand-mère) est un élément pivot de la construction de Ware.
Le lien fort avec les grands-parents
Les grands-parents sont souvent des personnages importants dans la construction de soi et la perception de sa famille. Comme substitut à des parents pour les élever en leur absence, comme des personnes pleines de ressources liées à leur expérience ou enfin comme une première confrontation avec la disparition d’un être cher.
C’est ce que vit Momo, dans la bande dessinée éponyme de Jonathan Garnier et Rony Hotin. L’ouvrage et les couleurs nous entraînent dans la douceur de l’enfance, sucrée et espiègle comme les bonbons qu’on suce en faisant l’école buissonnière. Nous accompagnons Momo dans ces jolis moments jusqu’à la dernière partie de l’histoire où sa grand-mère décède. Cette première perte, dépeinte avec justesse et douceur, fait écho à celle vécue par la plupart des élèves, leur appréhension et leur entrée dans le « monde des adultes ». Cette expérience est centrale dans la construction du rapport à l’autre, d’autant plus quand la relation avec les grands-parents a été forte.
Ainsi, dans Paloma, papi et moi, de Julie Rey, Marin passe souvent de bons moments avec son grand-père à voler avec Paloma, son petit avion. Mais un jour, son papi doit être opéré du cœur, il ne pourra pas voler le temps de sa convalescence. C’est d’abord la première expérience de l’inquiétude face à l’état de santé d’un proche, mais c’est aussi l’occasion pour Marin de renouer un lien avec son père. Car ce qu’il partage avec son grand-père, son papa ne le vit pas avec lui. La relation de Marin avec son grand-père joue ici le rôle de trait d’union entre un père et son fils pour les deux générations. Ce roman énonce aussi une autre réalité : celle de la famille d’un des parents (la maman) qui vit dans un autre pays (l’Algérie).
On retrouve cette thématique de l’apprentissage et de la transmission dans le manga Une sacrée mamie, adapté d’un roman autobiographique de Shimada Youshichi2 ; Akihiro quitte Hiroshima du jour au lendemain pour partir vivre chez sa grand-mère à la campagne. D’abord très attristé de se retrouver sans sa famille, il va s’adapter et tisser des liens extrêmement forts avec sa grand-mère, une femme prête à partager son expérience et à ouvrir Akihiro à une vie bien différente de celle qu’il a vécue jusqu’ici.
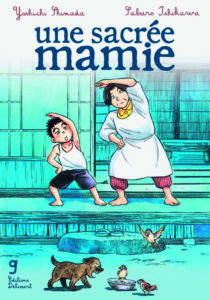
« Mes frères et mes sœurs3 »
Au même titre que les parents, les relations dans la fratrie sont un espace de socialisation et d’apprentissage. Entre pairs, frères et sœurs apprennent à gérer des conflits, à partage, à s’entraider… et sont confrontés à de nombreux sentiments dont il faut apprendre la gestion comme la rivalité ou la jalousie. Ces relations sont souvent représentées dans les fictions jeunesse.
Ainsi, dans Marie et Bronia : le pacte des sœurs de Natacha Henry on retrouve la force du lien fraternel. Le roman raconte l’histoire des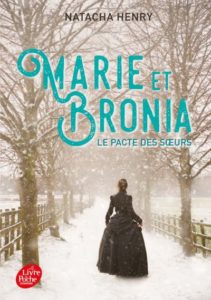 sœurs Slodowska et dépeint la grande entraide qui naît entre elles à la suite du décès de leur mère. Bronia part d’abord en France pendant que Marie subvient à ses besoins financiers en travaillant en Pologne, puis cette dernière rejoint sa sœur à Paris pour faire ses études, alors que Bronia exerce comme gynécologue. L’ouvrage est centré sur la relation entre les deux sœurs et le pacte qu’elles ont scellé qui leur permettra de devenir chacune une grande scientifique et de s’accomplir professionnellement.
sœurs Slodowska et dépeint la grande entraide qui naît entre elles à la suite du décès de leur mère. Bronia part d’abord en France pendant que Marie subvient à ses besoins financiers en travaillant en Pologne, puis cette dernière rejoint sa sœur à Paris pour faire ses études, alors que Bronia exerce comme gynécologue. L’ouvrage est centré sur la relation entre les deux sœurs et le pacte qu’elles ont scellé qui leur permettra de devenir chacune une grande scientifique et de s’accomplir professionnellement.
Jean-Philippe Arrou-Vignod raconte également les liens fraternels dans ses histoires de Jean-quelque-chose. Dans les années 1970, la famille nombreuse vit dans chaque tome des histoires rattachées au quotidien : vacances, école, arrivée d’un nouvel enfant… Les frères forment à eux six une petite communauté où ils apprennent les uns des autres, entourés de leurs parents. On retrouve dans ces romans l’idée de l’apprentissage par les pairs et les petites disputes liées aux tempéraments et aux différences d’âge.
Dans Un jour, je te mangerai de Géraldine Barbe, les relations entre Chloé et sa grande sœur Alexia sont complexes. La jeune narratrice a peur de sa sœur, elle se sent méprisée, voire détestée… En réalité, ce qu’Alexia hait, c’est son propre corps. Elle souffre d’anorexie, trouve chaque centimètre de son corps plein de graisse dérangeante et jalouse sa petite sœur au corps encore enfantin, aux hanches étroites et aux cuisses fines. La force de l’ouvrage tient dans la narration de cette relation conflictuelle en lien avec la maladie, mais racontée du point de vue de la plus jeune. Celle-ci ne comprend pas ce qui se passe dans l’esprit de sa sœur et se sent responsable de ses écarts d’humeur à son égard. Ce que montre le roman, c’est que lorsqu’un membre de la famille éprouve un mal-être les sentiments des autres peuvent être liés à l’incompréhension de ce qu’il se passe.
On retrouve cette thématique du mal-être dans Frangine, de Marion Brunet. Joachim, élève de terminale voit sa petite sœur Pauline intégrer le lycée. Celle-ci va vivre – et taire – une situation de harcèlement liée à leur famille homoparentale. Joachim va ressentir son mal-être… Ce roman très fort aborde de nombreux sujets en rapport avec les relations familiales : le lien fort qui unit Joachim et Pauline tout d’abord, les questions relatives à l’homoparentalité ensuite.
Quatre sœurs, de Malika Ferdjoukh, présente la force des liens fraternels. En réalité, elles sont cinq et viennent de perdre leurs parents. Ici la famille ne correspond plus à sa définition originale, mais à ce qu’il en reste. Les émotions des cinq sœurs sont multiples, propres à chacune d’entre elles et les quatre tomes de la saga donnent la parole aux quatre plus jeunes, tour à tour.
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé4 »
La gestion d’un événement douloureux et son impact sur les relations dans la famille sont au centre de la saga de Malika Ferdjoukh. La perte d’un membre de la famille peut amener chacun à rechercher sa place et son rôle. Dans Les optimistes meurent en premier, Susin Nielsen aborde la reconstruction d’une adolescente après la perte de sa petite sœur. Depuis cet événement, Pétula, seize ans, a développé de nombreuses phobies et fait preuve d’une extrême prudence, afin de se protéger d’un accident. Pétula se croit responsable de la mort de sa petite sœur, celle-ci ayant avalé le bouton d’un doudou qu’elle lui avait fabriqué. Auparavant membre d’une sororité, elle se retrouve seule et perd ses repères. C’est la rencontre avec un camarade ayant lui aussi un passé compliqué qui va lui permettre de se reconstruire.
C’est à nouveau la thématique de la famille recomposée, vue sous un angle différent, qui est abordée dans Nous sommes tous sa famille de Patricia MacLachlan. Après le départ des touristes de la période estivale, une famille d’insulaires retrouve, sur le pas de sa porte, un bébé dans son couffin, accompagné d’une note de la mère de l’enfant : « Voici Sophie, elle a presque un an. Par pitié gardez-la. Je reviendrai la chercher un jour. Je l’aime. » L’histoire est racontée du point de vue de Larkin, pré-adolescent qui accueille comme une petite sœur Sophie. On s’éloigne ici de la définition du dictionnaire Larousse, la famille pouvant s’agrandir, au-delà du lien du sang ; l’officialisation contractuelle comme l’adoption et l’accueil d’un nouveau membre peut permettre à chacun de retrouver sa place. D’autant que la famille de Larkin, on le comprend au fil de la lecture, a vécu la perte d’un enfant. L’arrivée de la petite Sophie, dont chacun sait qu’elle ne restera pas, est l’occasion pour tous – père, mère, enfant et grand-mère – de retrouver son rôle et sa place auprès de l’autre et de se reconstruire.