Pourquoi certaines œuvres littéraires classiques, dites « patrimoniales1 », traversent-elles les siècles ? Qu’ont-elles de si particulier, que d’autres textes, tombés dans l’oubli, ne possèdent pas ? Et comment amener des lycéens à se les approprier ? Peut-être en leur proposant de jouer un rôle actif dans l’étude de celles-ci, à savoir, notamment, en sollicitant leur avis et en les invitant à réfléchir sur des sujets toujours d’actualité.
C’est ce que propose Sarah Alami dans Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? (et autres questions piquantes pour profs de lettres)… uniquement pour les profs de lettres ? À y regarder de plus près, pas si sûr… d’où notre choix de nous arrêter sur cet ouvrage : destiné aux professeurs de lycée, il se révèle un outil précieux dans le cadre de la collaboration entre le professeur documentaliste et le professeur de français.
Ce livre se divise en cinq chapitres, lesquels correspondent aux séquences pédagogiques conçues par l’auteur à partir d’une œuvre ou d’un corpus de textes : « Comment étudier un classique sans s’ennuyer en classe ? (Jean Racine, Phèdre, 1677) » ; « Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? (Collectif de poètes, Blason anatomiques du corps féminin, 1543) ; « Comment lire de gros livres avec les élèves ? » (Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857) ; « Comment se mettre dans la peau d’un auteur ? (Montesquieu, Lettres persanes, 1721) et « Comment enseigner l’autonomie ? » (Regards sur l’école et corpus de texte). Chaque séquence est accompagnée d’une introduction et d’un plan détaillé ; logiquement divisée en plusieurs séances, elle comporte également des extraits des œuvres étudiées. Surtout, une rubrique intitulée « Penchons-nous sur… » aborde des points méthodologiques qui constituent autant de portes d’entrée pour le professeur documentaliste, tel « Susciter le désir de lire » (chapitre 3) ou encore « Mener un atelier d’écriture » (chapitre 4).
Voici quelques pistes pouvant mener, entre autres, à des séances de coanimation : la première séquence pose la question de la culpabilité du héros tragique et repose sur l’idée de faire le procès de Phèdre ; les objectifs des séances 3 et 5 (« Interroger la responsabilité du héros tragique » et « Réfléchir aux enjeux d’un procès et étudier les failles du personnage tragique ») conviennent à l’organisation d’un débat argumenté.
Par ailleurs, afin de permettre aux élèves d’entrer en littérature, on pourra leur proposer, parallèlement à la lecture de la pièce de Jean Racine, celle de la bande dessinée Phèdre (texte intégral de Jean Racine, éditions Petit à Petit ISBN 9791095670278) ; cette dernière offre, de plus, la possibilité de mettre en regard des planches de bande dessinée et des scènes théâtrales pour réfléchir sur les choix du dessinateur Armel et sur la question de l’adaptation.
La seconde séquence porte sur le blason : la séance 4 « Le concours de contreblasons, contraction de textes et écrits d’appropriation » peut conduire à la création de podcasts, lesquels permettent, en outre, de travailler la lecture à voix haute. Le procès dont le roman Madame Bovary a fait l’objet, abordé dans la troisième séquence, conviendrait particulièrement à la réalisation d’une émission de radio sur la question de la place de la femme.
L’étude des Lettres Persanes de Montesquieu dans la quatrième séquence et la séance 5 dont l’objectif est « Peut-on rire de sujets graves ? » nous invite à réfléchir sur le fanatisme religieux et à travailler sur la caricature. Outre les ressources de la Bnf, citées par l’auteure, la découverte de EENCRE, Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot, D’Alembert et Jaucourt (1751-1772) – http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/ –, dans le cadre d’une recherche sur les Lumières, pourra être très enrichissante. Quant à la séance 6 « Être en avance sur son temps, initiation à la recherche documentaire », le titre parle de lui-même !
Les possibilités de collaboration, vous l’aurez compris, sont donc multiples, et il nous semble que s’il est à conseiller à nos collègues de lettres, cet ouvrage permet également aux professeurs documentalistes d’être force de proposition.
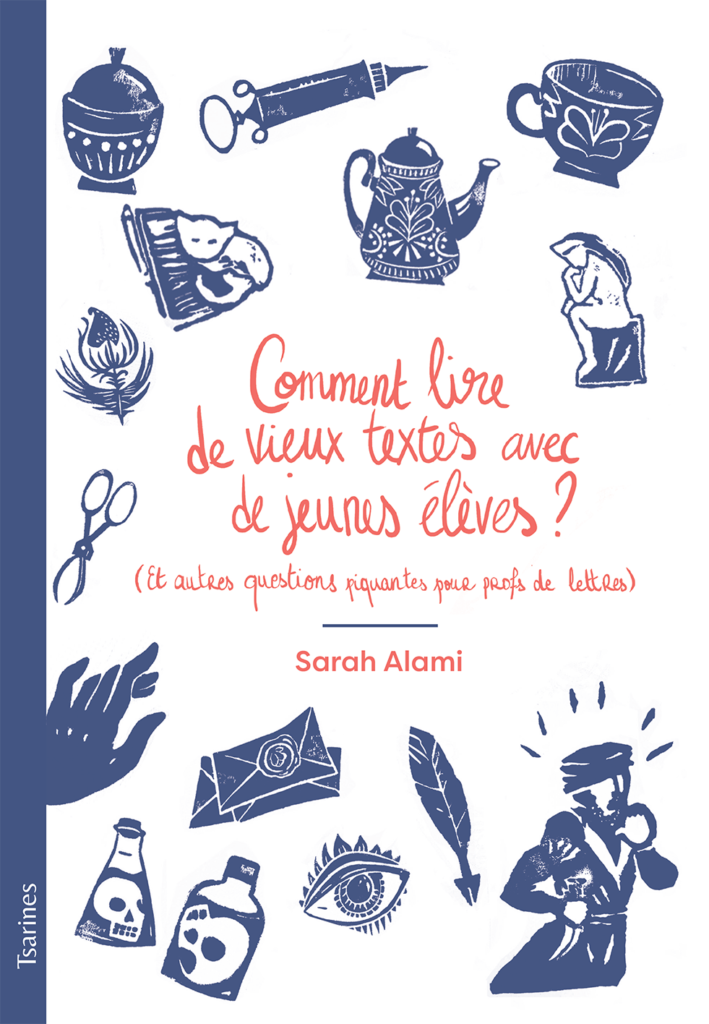
ALAMI, Sarah. Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? (Et autres questions piquantes pour profs de lettres). Paris : Tsarines, 2021, 233 p. (C’est comme ça qu’on s’en sort), 22 euros. ISBN : 9782957925605.
