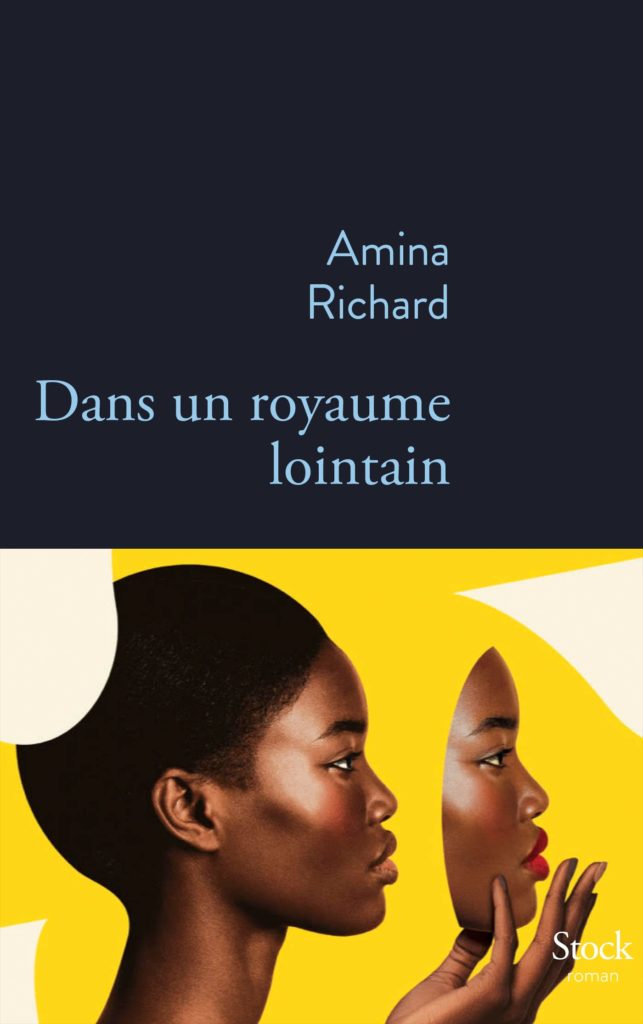Comment est né ce livre et comment s’est passée la recherche d’un éditeur ?
Ce livre est inspiré de ma propre histoire. J’avais déjà écrit plusieurs nouvelles mais jamais de roman vraiment abouti. J’en ai écrit des petits paragraphes, des morceaux de textes épars. Je suis repartie de ces petits bouts. L’envie d’écrire était là depuis longtemps, mais je suis arrivée à un moment de ma vie personnelle où j’ai eu davantage de temps à consacrer à l’écriture et je me suis lancée. J’ai mis, relectures comprises, environ deux ans : une première version écrite au bout d’un an, puis plusieurs mois d’ajustements et de corrections.
Pour la petite histoire, j’ai été mise en contact avec un agent, relativement reconnu dans le métier. C’est par lui que je suis passée pour être éditée. C’est une pratique courante dans le monde anglo-saxon, et qui se développe de plus en plus en France, depuis peu dans le milieu éditorial. Les grosses maisons d’édition se retrouvent à faire beaucoup d’administratif et de marketing et l’apport de manuscrits finalisés proposés par un agent commence à être accepté.
Y a-t-il eu des modifications demandées par les éditions Stock ?
Assez peu finalement, car le texte était déjà très abouti. L’éditeur m’a seulement suggéré de faire réapparaître une nouvelle fois le personnage de la mère, j’ai trouvé qu’il avait raison, j’ai donc ajouté une scène vers la fin de l’ouvrage.
Qu’est-ce que la sortie du livre a changé dans ton quotidien ? Comment est-il accueilli par les lecteurs ?
Je fais de nombreuses rencontres dans des librairies, un peu partout en France. J’ai commencé dès le mois de mai dernier, avant la sortie du livre, et j’enchaîne de façon intensive depuis septembre, quasiment chaque week-end, à la demande des libraires, qui soutiennent bien le roman. Le roman a été présenté dans un article de la revue Page des Libraires, ce qui l’a bien mis en valeur lors de sa sortie. Je vais également dans les différents salons du livre, à la rencontre des lecteurs, en dédicace. Mes lecteurs n’ont pas de profil type : de l’adolescente attirée par le style graphique de la couverture, aux personnes qui connaissent bien l’Afrique. C’est assez étonnant ! Certains sont décontenancés par le style d’écriture, l’emploi de la 2e personne du singulier au début, mais relèvent souvent que les personnages sont très fouillés et qu’ils se sont identifiés à eux.
Peut-on dire qu’il s’agit d’une autobiographie ?
Le roman est inspiré de mon histoire, c’est vrai, mais le but n’était pas de raconter ma propre vie. C’était surtout d’écrire une œuvre littéraire et c’est ce matériau-là qui était disponible. Mon objectif premier était de produire un écrit littéraire et non une autobiographie, le fait que ce soit inspiré de faits réels est secondaire à mes yeux.
Pourquoi ce choix de l’absence de points ? Les virgules, omniprésentes, créent une écriture ample et rythmée. Comment l’as-tu travaillée ?
Les points sont présents seulement dans les dialogues et les citations, sinon je les ai volontairement supprimés. Je souhaitais que l’on soit pleinement dans le ressenti du personnage, à hauteur de son regard et dans sa respiration, que l’on puisse appréhender toute la violence qu’elle exprime au début. Les questions d’identité et de quête du père ne sont jamais finies, d’où le fait de ne pas mettre de points finaux. C’est une contrainte que j’aime bien, puisque les phrases sont écrites de manière à enfler, enfler, puis terminer par une chute, telle une vague qui monte. La syntaxe fait que l’on sent la structure de la phrase, mais enlever les points permet d’être davantage immergé dans le flux de pensée, pleinement dans la respiration du personnage. J’ai essayé malgré tout que ce soit fluide, en évitant la lourdeur des trop longues phrases. J’ai adapté la syntaxe à cette forme d’écriture particulière pour ne pas perdre le lecteur. J’avais déjà écrit quelques nouvelles de cette manière, je n’étais pas sûre que cette forme passe sur toute la longueur d’un roman. Le fait d’entrecouper de dialogues, d’extraits de contes permet de casser un peu cet effet de roulement, de ménager des pauses.
As-tu beaucoup retravaillé le texte ?
La trame du roman a été fixée dès le début, car je voulais adopter la structure d’un conte, avec un ordre chronologique : la situation initiale, la rencontre avec le père, etc.
Je retravaille beaucoup chaque paragraphe : je relis, je coupe, je réécris par paragraphe. Il y a eu trois versions du texte, je n’ai jamais rien enlevé, en revanche j’ai ajouté des choses à chaque fois. À aucun moment je n’ai changé toute la structure.
Les scènes de racisme ordinaires pendant l’enfance sont glaçantes. Souhaitais-tu dénoncer le racisme ou est-ce simplement la situation initiale de ton récit ?
Les scènes de racisme de l’enfance sont exacerbées par le fait de ne raconter que celles-ci. J’ai eu une enfance heureuse sinon. Je ne voulais pas faire un acte militant, ni dénoncer spécialement le racisme de façon générale, mais surtout que l’on soit à l’intérieur de cette petite fille, de son ressenti, de la violence qu’elle ressent et de la colère qui l’agite. Je l’ai écrit de façon heurtante, avec un ton tranchant, c’est ce que je voulais : que l’on ressente de l’intérieur, à hauteur du regard de l’enfant, cette violence. Il y a une opposition entre le ton ironique utilisé et la candeur des attentes de la petite fille. C’est la friction entre les deux qui engendre de la violence. L’utilisation de la 2e personne du singulier permet au lecteur d’être très concerné mais elle permet aussi de créer une grande distance analytique. Je voulais être dans la sphère du ressenti et non de l’intellect, du jugement ou de la dénonciation.
Tous les « Blancs » sont plus ou moins renvoyés dos à dos, même les enseignants qui sont montrés comme dégoulinants de bonne volonté. Est-ce toujours le cas selon toi ? Es-tu encore confrontée à ce genre de situations ?
C’est un texte qui a été construit dès le début pour donner à vivre cette violence. La violence sociale et raciale est toujours présente dans notre société. Je suis très intéressée par les luttes sur ce thème, mais ce n’est pas là-dessus que j’ai voulu écrire. Beaucoup de lecteurs me disent qu’ils se sentent concernés, d’un côté comme de l’autre. Pour moi, le racisme est indissociable de la question sociale. Je l’ai très peu subi personnellement, évoluant dans des milieux sociaux relativement privilégiés.
« La vie de chacun est un conte, que l’on peut déchiffrer comme un rêve. On a tous nos différences à porter, nos deuils à faire, une quête d’identité à mener. »
Cette quête du père que tu décris, puis la création de liens dans une fratrie peut parler à beaucoup de lecteurs différents, même dans un autre contexte, tout comme la question plus générale de l’identité. En as-tu eu conscience lors de l’écriture ? As-tu essayé de renforcer l’universalité de tes personnages ?
J’ai essayé de tendre vers l’universel, d’où le recours au conte. La vie de chacun est un conte, que l’on peut déchiffrer comme un rêve. On a tous des parcours comme ça. On a tous nos différences à porter, nos deuils à faire, les violences que l’on reçoit. Là, il se trouve que c’est le père, mais on a tous une quête d’identité à mener. Je voulais également montrer à chaque fois l’opposition entre les images d’Épinal que le personnage peut avoir sur l’Afrique, car elle a été élevée en France, et la réalité. Il y a toute une série d’oppositions et de dualités qui émergent : enfant/adulte ; Noirs/Blancs ; réalité/fantasme. Le père est à l’opposé des représentations stéréotypées du bon Noir jovial qu’on peut avoir, il a une personnalité austère, un niveau social élevé, cela génère de l’étonnement face à la réalité qui ne correspond pas aux clichés des Français sur les Africains. L’inversion des classes sociales entre la narratrice française et sa famille africaine fait partie de ce décalage entre stéréotypes attendus et réalité rencontrée.
Comment t’est venue l’idée de personnifier ton identité africaine sous les traits de ce personnage de petite fille, Ndiolé ?
Elle est venue assez vite, dans une première version elle était présente, puis je l’ai développée par la suite. J’avais l’idée dès la première page de rendre hommage à toute la littérature enfantine, j’ai passé mon enfance à écouter des histoires et on m’en racontait beaucoup. J’avais les albums du Père Castor, j’écoutais Le Petit Prince en vinyle. C’est dans toute cette littérature, à travers ces contes et leur langue, que la petite fille trouve son identité et se construit. C’était très important d’avoir ce personnage d’enfant qui est dans ses lectures-là et c’est par là que se fait la construction de sa personnalité.
On a tous « un enfant intérieur », même si c’est une expression que je n’aime pas beaucoup, popularisée dans le domaine du développement personnel, sans qu’on sache très bien ce qu’elle recouvre. Certains lecteurs me disent : « Oh moi, mon enfant intérieur aurait été copain avec le tien ». D’autres le sentent au contraire très éloignés du leur. Ndiolé, la petite fille imaginaire, représente en tout cas cette enfance qui continue obstinément à vivre en nous, pour le meilleur et pour le pire !
Y a-t-il un passage auquel tu es particulièrement attachée dans ton livre ?
Redevenir le souverain de sa propre vie : c’est l’idée importante du roman. Par l’écriture ou la création artistique, on peut aller se situer dans un royaume où l’on redevient vivant et l’on peut réécrire sa propre histoire. Le royaume du titre, je l’ai choisi car il est vraiment polysémique : ça peut être l’Afrique, l’enfance, le royaume des cieux, il y a aussi une interrogation sur un au-delà de l’identité. Il y a, par exemple, pas mal de passages au bord de la mer : l’idée est que, quand on est devant la mer, on est dans une forme d’expérience humaine qui va bien au-delà de toute identité, que l’on soit un homme préhistorique ou une femme du XXIe siècle. Le royaume du titre peut être aussi celui de l’écriture. La quête de l’identité est ultimement une quête de soi, universelle, tous les êtres humains font comme ils le peuvent avec elle.
Quel a été ton parcours professionnel ?
J’ai fait plusieurs métiers, j’ai passé le Capes à 40 ans. Avant, j’étais directrice éditoriale dans la communication. À l’origine, j’ai une maîtrise de Lettres, puis un DESS à l’INTD, l’Institut National des Techniques Documentaires. Ma situation familiale a fait que j’avais besoin d’un emploi proche de chez moi et avec des horaires fixes. J’avais envie d’être dans un rapport différent d’enseignement avec les élèves, dans une relation différente.
Dans le livre, tu vas de bibliothèques en bibliothèques au Sénégal ; quel était ton métier à ce moment-là ?
En deuxième année d’IUFM quand j’ai passé le Capes, on a eu l’occasion de faire un séjour à l’étranger pour observer un autre système scolaire et d’autres centres de documentation. Je voulais aussi que le livre soit physiquement tangible dans le roman, à travers la présence des bibliothèques. Le livre raconte une réappropriation de soi par l’écriture et la lecture, celles de l’enfance, du goût de la langue développé par la lecture. La dimension de l’écriture et du livre est importante, notamment à travers des extraits de contes, c’est ce qui nourrit le personnage.

Quelle professeure documentaliste es-tu en trois mots ?
Très heureuse en lycée ! J’ai passé 10 ans en collège REP à Nîmes, c’était passionnant et avec une équipe géniale, mais j’en suis sortie épuisée. Je préfère la relation aux élèves lycéens, qui sont plus autonomes. J’aime la diversité de ce métier : les résidences d’artistes, les concours d’écriture ou d’éloquence, la Nuit de la Lecture, etc. Il n’y a pas deux CDI identiques, ça dépend de l’établissement mais aussi des désirs du professeur documentaliste, on a toute latitude pour proposer tout ce qui nous fait plaisir. J’aime beaucoup cette liberté et cette autonomie. Le rapport avec des élèves « grands » me plaît : toutes les semaines je travaille sur les ateliers de préparation à Sciences Po Paris, avec des élèves motivés et volontaires, sur le dessin de presse, sur la revue de presse, etc., c’est passionnant d’échanger avec eux. L’année dernière nous avions un projet avec les sections STMG, où ils faisaient une simulation du fonctionnement des institutions européennes avec plusieurs lycées différents, ils devaient notamment amender des textes de lois. C’est un âge charnière où ils sont en prise avec l’actualité et la réalité contemporaine, ils deviennent de futurs citoyens et de jeunes adultes qui s’intègrent dans la société. Cet âge-là me va bien, j’aime cette forme d’accompagnement. On fait aussi tout cela en collège mais de façon différente.
L’incipit du roman est une magnifique ode à la lecture à haute voix, au plaisir enfantin mais aussi universel d’écouter des histoires. Quelle lectrice étais-tu, enfant ? As-tu des conseils en littérature jeunesse ?
J’ai beaucoup écouté de contes et de classiques, Peau d’âne, Tom Sawyer aussi, puis j’ai lu toutes les séries jeunesse de l’époque, Le Club des Cinq, L’étalon noir, etc.
Au CDI, j’essaie d’avoir une palette très large de lectures pour tous les profils d’élèves. On a réfléchi par exemple à l’achat de la série de dark romance à la mode, Captive de Sarah Rivens. Finalement, on l’a achetée car c’est déjà un plaisir de lecture. C’est toujours des arbitrages entre ce que les élèves attendent et ce que l’on a envie de leur faire découvrir et cela fait l’objet de discussions riches avec ma collègue. Par ailleurs, une classe de 2de vient de participer cette année au Goncourt des Lycéens : plusieurs ont réussi à lire les 15 romans, chacun s’est investi à la hauteur de ses possibilités. Même ceux qui ont un peu moins lu ont participé à des débats assez riches . Les amener à de telles lectures de littérature contemporaine est un bel objectif ! Avant de commencer, je me disais que c’était énorme et presque impossible de leur faire lire autant de livres en si peu de temps, mais finalement c’était très stimulant. Ils ont rencontré 9 auteurs, sur une journée, lors d’un regroupement de plusieurs lycées, avec des lectures d’extraits par les élèves et des échanges entre auteurs et lycéens.
Pourrais-tu nous citer trois livres marquants dans ta vie de lectrice ?
Un de mes premiers chocs de lecture en 2de, c’était Le roi des Aulnes de Michel Tournier, j’avais été marquée par le foisonnement de l’imaginaire. Je pourrais citer Julien Gracq également, car j’ai fait porter ma maîtrise de Lettres sur ses romans, mais ses ouvrages critiques m’ont aussi beaucoup intéressée : Préférences, Lettrines, En lisant en écrivant, dont les réminiscences ont marqué mon écriture, encore actuellement. J’ai plein de titres en tête de littérature contemporaine surtout depuis que je suis en lycée où je me suis remise à en lire de façon plus conséquente : Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka ; Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin ; Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo ; Nom de Constance Debré.
As-tu d’autres projets à venir ?
Je reste sur l’écriture, c’est vraiment la forme d’expression artistique que j’ai choisie. Je me remettrai à ma table et à ma discipline d’écriture quotidienne dès que j’aurai terminé ma série de rencontres en librairie, en 2023.