À moins d’en venir au temps de précogs de Minority Reports de Philippe K. Dick, il nous reste encore quelques coups d’avance en tant qu’être humain et professionnel de l’information, à condition de passer à une tout autre étape désormais : la psychanalyse documentaire.
S’agit-il pour autant de devenir disciple de Freud et de laisser de côté les travaux en sciences de l’information et de la communication ? Écartons dans un premier temps le fait qu’il pourrait s’agir d’un travail d’introspection qui consisterait à consigner ses rêves et ses pensées pour mieux les extérioriser et les rendre propices à l’analyse. Ce n’est pas à ce genre de documents auxquels nous faisons allusion ici.
Disons ici que le terme de psychanalyse renvoie plutôt à l’idée d’une analyse qui prend en compte les aspects psychosociaux de ceux qui émettent des messages et des formes communicationnelles. Il convient de devenir désormais circonspect quant à la psychologie des auteurs de documents. Il faut prendre ici le document dans ses formes les plus succinctes parmi lesquelles les micro-messages des réseaux sociaux.
L’analyse ne repose pas uniquement sur les sources, mais sur leurs auteurs… et de plus en plus sur les circonstances de production des écrits. Parfois la spontanéité apparente révèle en fait une préparation dûment orchestrée, tandis que le message d’un acteur qui semble instruit peut finalement être la résultante d’une trop grande précipitation, ou d’une réaction qui ressemble plus à un geste d’humeur qu’à une décision réfléchie.
Le pedigree de l’auteur d’un message n’est donc pas suffisant pour en mesurer la qualité. C’est au sein de cette complexité informationnelle qu’il convient d’opérer cette psychanalyse documentaire. On ne peut que constater l’expansion de nouvelles « créatures médiatiques » qui marquent bien souvent le triomphe du nouvel idiot du village planétaire qu’Umberto Eco avait décrit avec l’évolution des programmes télévisés :
« L’idiot du village des programmes télé actuels n’est pas un sous-développé. Ce peut être un esprit bizarre (par exemple l’inventeur d’un nouveau système du mouvement perpétuel, ou le découvreur de l’Arche perdue, le genre de type qui pendant des années a frappé en vain aux portes de tous les journaux ou de tous les bureaux de brevets d’invention, et a enfin trouvé quelqu’un pour le prendre au sérieux) ; ce peut être aussi un intellectuel qui a compris que, au lieu de se fatiguer à écrire un chef-d’œuvre, il était possible d’avoir du succès en baissant son pantalon à la télé et en montrant son postérieur, en lançant des insanités lors d’un débat culturel, ou carrément en agressant à coups de gifles son interlocuteur». (Eco, 1995).
Cet idiot n’est pas nécessairement stupide. Umberto Eco nous a bien mis en garde sur ce point. C’est parfois le positionnement de celui qui cherche à gagner l’attention des autres. L’idiot du village des univers digitaux peut connaître une certaine forme de succès et il va en tout cas chercher à conserver ce minimum d’attention en répétant à l’envi son modus operandi pour parvenir sans cesse à mobiliser autour de lui. Les derniers mois d’observations des réseaux sociaux ainsi que les dernières années médiatiques montrent bien le succès de ce genre de personnages. Certains méritent une psychanalyse documentaire poussée. Certaines revendications ou stratégies communicationnelles dissimulent des problématiques psychologiques voire psychiatriques plus profondes.
C’est ici qu’il me semble que le rôle de l’enseignant est de démontrer qu’un succès médiatique momentané peut être la résultante de troubles psychologiques, et que la quête des retweets, des likes et toute autre forme de récompense réputationnelle n’est pas la garantie d’une vie sereine. Le corpus d’études peut également s’observer sur Instagram ou autre plateforme du même acabit. La popularité n’est pas synonyme d’autorité dans un domaine, et encore moins de réalité de l’existence tant la déformation fait partie des stratégies communicationnelles des réseaux où il faut s’exposer. Certes, les réseaux ont permis aussi la diffusion de forme de dérision et d’autodérision… mais là également, le succès des parodies est tel parfois que celui ou celle qui les réalise devient lui-même entraîné par la stratégie de la quête de popularité. Difficile de résister à ces mécanismes réputationnels. Il est déplorable que certains enseignants et chercheurs procèdent désormais de même. Umberto Eco l’avait déjà démontré en ce qui concerne la télévision. La quête de l’indignation permanente fait désormais partie des ressorts de la recherche tous azimuts de l’attention4.
Face aux logiques de l’instant, il faut revenir à la longue durée et à la construction des écritures de soi dont l’objectif n’est pas la mise en garde contre les dangers des réseaux sociaux, mais bel et bien la construction lente et choisie de dispositifs d’écriture et d’expression.
Le fait de vouloir introduire la question psychologique au sein des écrits n’est pas nouveau. Plusieurs travaux ont mêlé différentes approches communicationnelles et psychologiques. Mais c’est à un travail méconnu désormais que nous voulons faire référence.
Le précédent historique : la bibliologie psychologique
Impossible de ne pas présenter un bon ami de Paul Otlet : Nicolas A. Roubakine (1862-1946), qui a développé de nombreux travaux autour de la bibliologie psychologique ou bibliopsychologie. Exilé en Russie, il est parvenu à obtenir une reconnaissance hors de sa patrie avec le soutien de plusieurs personnes, dont Paul Otlet et Édouard Claparède. Incité par ces derniers à poursuivre ses travaux, il leur dédie son ouvrage écrit en français sur la bibliopsychologie (Roubakine, 1922).
L’ouvrage est fort riche, son contenu tient d’ailleurs en deux tomes. Roubakine s’y montre souvent pionnier sur un grand nombre de questions informationnelles et communicationnelles5 .
Pour le chercheur russe, il s’agit de ne pas séparer trop strictement les études sur la création éditoriale (la fabrication du livre) et celles sur la réception :
« Mais la psychologie bibliologique étudie le livre et son influence à un point de vue spécial qui est celui-ci : pour cette science le livre, aussi bien que le lecteur et l’auteur, ainsi que le processus même de la lecture, de l’assimilation et de l’influence du livre ne sont pas uniquement des phénomènes culturels, mais avant tout, des phénomènes naturels. Je veux dire par là que la psychologie bibliologique aborde l’étude du livre non pas du côté de l’importance culturelle de l’œuvre et de sa valeur dans le sens le plus étendu de ce mot, mais en l’envisageant uniquement comme une sorte d’appareil, d’engin, d’instrument psychologique servant à provoquer dans l’être psychique du lecteur des expériences déterminées et complexes » (Roubakine, 1922, p. 5).
Si le projet de Nicolas Roubakine est de parvenir à collecter des données quantitatives et pas seulement qualitatives, il s’agit clairement d’en faire une discipline scientifique qui mesure les interactions entre les cerveaux humains par l’entremise de la lecture.
Nicolas Roubakine précise que cette discipline scientifique se doit d’être assortie de limites éthiques, car sa connaissance permet de mieux gérer les aspects communicationnels et les stratégies d’influence. Par conséquent, la bibliopsychologie peut être détournée à des fins de propagande.
Mais l’enjeu n’est pas ici d’évoquer les stratégies de communication de masse, mais plutôt d’entrer dans le quotidien des réactions en chaîne des réseaux sociaux qui relève parfois de la stupidité collective plutôt que de l’intelligence collective.
Les concours d’indignation devenant le principal enjeu de ces dispositifs, il convient désormais d’étudier les comportements des lecteurs du web social qui sont tout autant des lecteurs que des producteurs, pour ne pas dire des « réacteurs ».
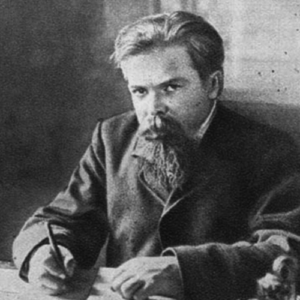
Examen de la pathologie informationnelle et communicationnelle
Le réseau social Twitter se révèle un bon lieu pour examiner les enjeux d’une psychanalyse documentaire. Il est vrai que les listes de diffusion sont également de bons exemples. Je laisse le soin aux lecteurs d’appliquer les conseils ici à la lecture de cdi-doc et d’e-doc.
Il s’agit donc désormais d’examiner et d’évaluer non seulement le message, mais l’ensemble des métadonnées qui figurent autour. Plus encore, on peut désormais mesurer l’ensemble des réactions au message publié, ce qui aurait constitué une aubaine pour Nicolas Roubakine. Il reste que l’étude de la psychologie des foules connectées se révèle à la fois riche en enseignements, mais aussi en déceptions. L’évolution de Twitter a montré un accroissement progressif de l’agressivité et une chute de l’autodérision.
L’étude des tweets, des réactions, des commentaires est devenue un marché aux données qu’il s’agit à la fois de capter ou de récupérer, mais aussi d’analyser. Entre détection d’influences, d’acteurs références et de quantification des tweets, il s’agit pour les marques de mieux organiser leur stratégie communicationnelle.
Mais ce qui nous intéresse ici est un travail davantage qualitatif qui peut venir accompagner une étude quantitative de plus grande ampleur.
Il s’agit d’identifier les personnes qui publient ou réagissent à la fois en parvenant à comprendre quels sont leurs pedigrees, mais aussi, et ça, c’est le point le plus nouveau, quel est leur état mental au moment de l’expression du message. Cela revient à essayer de comprendre en quoi une publication est rationnelle, partisane, hypocrite, de mauvaise foi, stratégique, ironique, etc.
Il existe désormais des outils qui tentent automatiquement de percevoir le négatif ou le positif et quelques éléments plus complexes. Les résultats s’avèrent assez décevants. Il faut donc en passer par un travail d’analyse personnelle.
Une pratique qui commence par une auto-analyse
La première difficulté est justement le cadre de l’analyse qui ne peut s’effectuer dans une neutralité totale… elle s’avère clairement impossible à ce stade. Il faut donc commencer par soi-même et avec ce qui nous semble pertinent au premier chef. Il faut donc se montrer en fait critique… avec les personnes qui présentent des positions politiques et idéologiques proches des nôtres…
C’est justement dans les moments où les autres pensent comme nous qu’il faut se montrer prudent, car c’est dans ces circonstances que s’exercent les manipulations aisées et le succès de la communication virale. Ce n’est pas parce que le message conforte notre opinion qu’il est véridique. Le vraisemblable est souvent l’ennemi de la véracité des faits.
Il me semble que c’est dans ce cadre que s’exerce le véritable esprit critique, en opérant une mise à distance vis-à-vis des pensées qui nous sont communes. C’est le seul moyen de pouvoir exercer une propre critique sur soi-même. C’est généralement le meilleur moyen d’affiner ses propres convictions, d’en percevoir les fondements, les influences et les limites.
La première leçon de la psychanalyse documentaire n’est finalement guère différente de la psychanalyse traditionnelle : pour pratiquer, il faut commencer par sa propre analyse. Elle commence donc par soi-même, par ce qui nous est proche, par l’étude critique de nos modes de pensée. Cela ne signifie pas qu’il faille sombrer dans un relativisme total, ou dans une analyse proche d’un freudisme de comptoir. Il s’agit de comprendre pourquoi on pense ainsi et pourquoi le message avec lequel nous sommes en accord paraît reposer sur des cadres similaires. Il faut comprendre ici que ce processus de psychanalyse documentaire s’avère également proche d’une forme de psychologie sociale… discipline qui a toujours pris en compte les questions documentaires notamment parce qu’un des acteurs français importants du domaine apparaît aussi comme un auteur clef pour les théories du document, avec notamment des textes sur la documentologie : Robert Pagès (Pagès, 1948)6.
Au niveau de la documentologie, les travaux de Suzanne Briet et de Robert Pagès ont permis de penser le document de manière étendue en prenant notamment en compte les êtres vivants. Ici, il s’agit certes de considérer les formes documentaires actuelles issues des dispositifs connectés comme des moyens d’étude des individus eux-mêmes, mais également de chercher à comprendre que derrière les messages des réseaux sociaux pris ici en tant que documents se trouvent vraisemblablement des dispositifs, des infrastructures qui opèrent et qui façonnent à la fois les formes documentaires et les modèles d’expression.
La deuxième leçon, c’est que les cadres d’analyse que nous allons porter sur les autres reposent sur notre propre infrastructure mentale. Si cette dernière est trop marquée idéologiquement, elle risque de voir les documents comme la manifestation d’idéologie contraire ou jugée néfaste. L’analyse cède la place à la détection de ce qui semble répréhensible. Tout devient l’expression alors d’une pensée néolibérale, paternaliste, masculiniste, marxiste, ce qui ne peut aboutir qu’à une volonté de rentrer en lutte, voire à dénoncer tout ce qui nous semble marqué trop nettement. L’analyse est alors remplacée par des formes inquisitoriales.
Ce n’est pas exclure le fait qu’il existe des idéologies dans le message des autres, bien au contraire, c’est admettre qu’il en existe chez nous également… et que ces cadres de pensée peuvent être parfois des lentilles déformantes. Ce n’est pas un rejet de l’idéologie, mais plutôt son acceptation tant chez soi que chez les autres. Mais le but est de faire redescendre parfois l’idéologie et ses cadres stricts au niveau des seules idées, ce qui suppose non seulement le débat (et son idéal quasi impossible), mais l’acceptation de partager des avis, des idées, des analyses avec des personnes qui initialement ne pensent pas du tout comme nous.
La troisième leçon requiert le droit à l’erreur. Un message trop rapide, absurde, une réaction épidermique doit être pardonnable. C’est même souhaitable. Rien de pire que de ne jamais rien dire. Ce droit suppose donc la capacité à pouvoir reconnaître que l’on s’est trompé, ou qu’on a exagéré certains aspects.
Une fois qu’on a procédé à sa propre introspection informationnelle et communicationnelle, il est plus aisé de comprendre les attitudes des autres et donc de les examiner avec plus ou moins de soin.
Nous n’allons pas ici rentrer dans l’idée qu’il faut absolument répondre à tous les messages qui circulent, mais plutôt considérer qu’il s’agit de procéder à une simple analyse des propos tenus. Libre à vous par la suite de réagir comme bon vous semble.
À ce titre, il faut prendre en compte que très souvent l’étude des messages repose surtout sur des logiques argumentatives qui sont celles de la monstration du Moi plutôt que sur une démarche rhétorique visant à démontrer la qualité du raisonnement. On sort néanmoins d’une approche dans la lignée de Marshall McLuhan et de sa célèbre phrase medium is message pour reconsidérer probablement que message is medium fonctionne également à condition de comprendre le mot medium dans un sens large, qui renvoie à l’ensemble des médiations potentielles. Plus encore il s’agit de considérer que les dispositifs communicationnels actuels sont des milieux de savoir qui peuvent être aisément détournés en milieux pour « se donner à voir ».
La querelle des ego apparaît dès lors comme une conséquence logique d’une période plus orientée vers l’indexation des existences que l’indexation des connaissances.
La logique de la psychanalyse documentaire oblige clairement à un certain détachement, à une différence difficile, voire impossible, entre l’exercice de l’analyse et le fait de cadre de pensée pour parvenir à la réaliser. Une impossible différance7 pour reprendre les mots de Jacques Derrida.
Pour conclure cette réflexion quelque peu aporétique, mais qui oblige à penser les limites de notre raison, finissons par cette réflexion du philosophe et théoricien des médias, Wilém Flusser :
« Si nous continuons à penser finalistiquement, si nous cherchons des ‘motifs’ derrière les programmes qui nous manipulent, nous serons fatalement les victimes d’une telle programmation. Chercher des motifs derrière les programmes, c’est vouloir les démythifier. Or, tout effort de démythification est précisément déjà programmé » (Flusser, 2019, p. 53).
Flusser revendique la nécessité d’accepter quelque part l’absurde et de faire confiance au hasard. Il ne vous reste plus qu’à appliquer les conseils de cet article sur… cet article lui-même.
