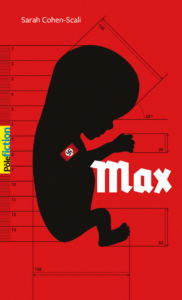Cachés ou sacrifiés, en fuite ou enfermés, les enfants ont vécu la guerre à leur manière, victimes de la folie des grands. Qu’ils soient Allemands ou Français, Lituaniens ou Anglais, ils ont tous quelque chose à nous raconter. Ils nous apportent un éclairage souvent différent sur le conflit, un autre point de vue. À travers leurs regards naïfs, étonnés, apeurés, ils évoquent une guerre quotidienne, qui les a touchés certes, différemment, mais souvent aussi fortement que les adultes. Leurs récits permettent à nos lecteurs de s’identifier plus facilement, et de rendre cette période historique plus accessible. Des histoires fortes, émouvantes, incontournables.
Se cacher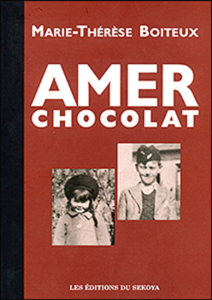
Les enfants adorent se cacher, dans d’interminables jeux et d’improbables cachettes. Mais durant la guerre, se cacher n’est plus un jeu, et devient une implacable nécessité. Dans son magnifique roman Amer chocolat1, Marie-Thérèse Boiteux nous plonge au cœur de l’enfance de jeunes belfortains, dont le paisible quotidien va être bouleversé à jamais. Alors que la Libération approche, et que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles dans l’Est de la France, la Croix Rouge helvétique réussit à envoyer près de 13000 enfants du nord de la Franche-Comté en Suisse. Beaucoup d’entre eux garderont le souvenir du chocolat qui les attendait à l’arrivée. Un roman puissant, émouvant, dont les faits furent vécus par l’autrice.
C’est également un déracinement qui attend beaucoup d’enfants anglais lorsque le gouvernement décide de les protéger en les envoyant à la campagne. Cet épisode est relaté dans le roman Dix battements de coeur2 de N. M. Zimmermann. Isabella White vit dans les beaux quartiers de Londres, et son quotidien va basculer lorsqu’elle est envoyée dans la campagne anglaise pour être protégée. Ce voyage lui permettra de découvrir la raison du lien étrange qui la lie à Andrew, le fils de l’assistant de son père. Un très beau roman, à mi-chemin entre fantastique et histoire.
Fuir pour se cacher, Roma Ligocka et Iris Von Finckenstein le racontent dans le récit La petite fille au manteau rouge3. Originaire d’une famille juive de Pologne, la jeune Roma se retrouve enfermée dans le ghetto de Varsovie. Elle parviendra s’en échapper en 1943. Son récit raconte l’histoire de ces nombreux mois passés à se cacher et à fuir. Un récit fort et captivant, nous permettant d’appréhender la guerre à travers les yeux innocents d’une jeune enfant.
Le thème de la cachette est bien entendu très largement évoqué dans le roman La vie d’Anne Frank4, de Janny van der Molen. L’auteur y retrace la vie d’Anne Frank et de sa famille, dans un récit illustré de dessins et de photographies d’époque. Un texte fluide, accessible même aux lecteurs les plus récalcitrants.
Fuir…
Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, la fuite fut le seul moyen de survie. Dans son autobiographie Après la rafle5, Joseph Wiesmann nous raconte sa fuite du camp de transit de Beaune-la-Rolande. Après avoir lutté pendant près de cinq heures contre les barbelés, Joseph arrive à sortir du camp ; il connaîtra ensuite une vie cachée en famille d’accueil. Entre dénonciation et maltraitance, l’auteur raconte ici son enfance brisée.
La fuite, c’est également ce que vont connaître quatre adolescents aux destins croisés, dans l’inoubliable roman Le sel de nos larmes6 de Ruta Sepetys. Ils ont dû fuir leur pays, fuir la guerre et ses atrocités, fuir leurs racines, leur vie. Leurs destins sont différents, et même opposés, mais leurs chemins vont les conduire au Wilhelm Gustloff, un navire qui aurait pu être la promesse d’une nouvelle vie. Le destin en a décidé autrement. Un récit captivant, sur un épisode assez peu connu de la guerre qui fut pourtant la plus grande catastrophe maritime de l’Histoire.
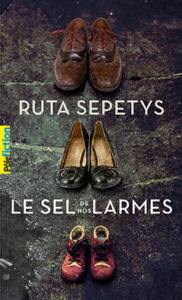
Résister
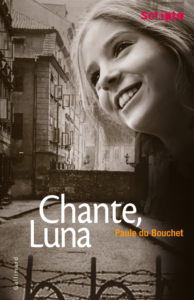 On ne peut commencer ce paragraphe sans songer à Luna, l’héroïne du roman Chante Luna7 de Paule du Bouchet. Cette jeune adolescente, passionnée de musique et de chant, a quatorze ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Enfermée dans le ghetto de Varsovie, elle va peu à peu prendre part à sa défense, entrer en résistance, et, grâce à la beauté de sa voix, jouera un rôle essentiel dans la vie du ghetto. Un roman magnifique.
On ne peut commencer ce paragraphe sans songer à Luna, l’héroïne du roman Chante Luna7 de Paule du Bouchet. Cette jeune adolescente, passionnée de musique et de chant, a quatorze ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Enfermée dans le ghetto de Varsovie, elle va peu à peu prendre part à sa défense, entrer en résistance, et, grâce à la beauté de sa voix, jouera un rôle essentiel dans la vie du ghetto. Un roman magnifique.
Même si elle est déjà une grande adolescente en 1939, comment ne pas parler de Sophie Scholl ? Dans son roman Mon amie Sophie Scholl8, Paule du Bouchet retrace la vie de cette jeune fille hors du commun. L’histoire est narrée par Elisa, une amie de Sophie qui raconte la vie de Sophie et la sienne à partir de 1943, date à laquelle Sophie Scholl est arrêtée avec deux autres résistants. Son récit évoque les profondes fractures de la société allemande de l’époque, la Nuit de cristal, et toutes les difficultés des relations humaines dans une période aussi dangereuse.
Être capturé
Les récits de captivité d’enfants et adolescents sont nombreux. Dans le roman Je m’appelle Marie9, Jacques Saglier retrace l’histoire véridique de la famille de Marie, une jeune avignonnaise. C’est un matin de l’été 1943 qu’elle et sa famille sont arrêtés et emprisonnés à Marseille. Après les camps et les gymnases, la famille sera finalement enfermée dans les entrepôts Levithan de Paris. L’une des forces de ce roman est de rendre particulièrement vivante la solidarité de la famille et leur union face à des forces qui les dépassent. Un très beau roman.
C’est également tout un monde d’enfermement, dans des conditions particulièrement précaires et difficiles, que relate le roman Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre10 de Ruta Sepetys. Lorsqu’elle est arrêtée par la police stalinienne, la jeune Lina quitte la Lituanie pour être déportée avec sa famille dans un camp de Sibérie. Les conditions de transport sont épouvantables, et à l’arrivée dans les camps, il va falloir lutter contre les éléments, l’adversité, la précarité. Un roman particulièrement fort, et dont le lecteur ne peut sortir indemne.
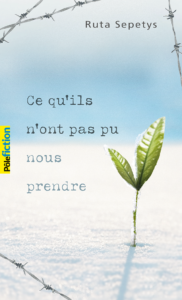
L’impensable
Imaginer un enfant dans un camp de concentration est juste inconcevable. Dans son témoignage incontournable, Une petite fille privilégiée11, Francine Christophe raconte son enfance au camp de Bergen-Belsen ; une enfance « privilégiée », en tant que fille de prisonnier. Un témoignage bouleversant, servi par une écriture magnifique. L’auteure nous y raconte le quotidien du camp, les mille petites choses qui ont fait que la survie se faisait tant bien que mal, au milieu des pires horreurs. Un témoignage essentiel. L’épisode du morceau de chocolat, donné à une femme qui venait de donner la vie dans le camp, reste gravé dans les mémoires.
Non moins essentiels sont les témoignages de Simone Veil. On retiendra particulièrement le livre L’aube à Birkenau12, nous offrant un témoignage recueilli par David Teboul. Il est le fruit d’une longue collaboration entre Simone Veil et l’auteur, fondée sur un travail alliant confiance et rigueur historique. L’ouvrage, abondamment illustré, nous livre un témoignage poignant et particulièrement vivant. De nombreuses notes historiques enrichissent l’ouvrage, en particulier les photographies de la venue de Simone Veil dans le camp d’Auschwitz.
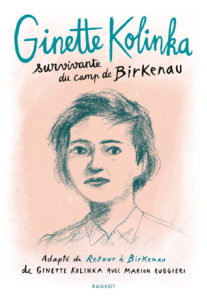 Ginette Kolinka a aussi laissé un témoignage essentiel. Le récit Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau13 a été adapté du texte Retour à Birkenau par Ginette Kolinka et Marion Ruggieri. Arrêtée en mars 1944 et déportée dans le sud de la Pologne, Ginette Kolinka va survivre pendant plusieurs mois dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle raconte dans cet ouvrage la vie quotidienne dans le camp, et son ressenti d’enfant face à des lieux et des évènements inconcevables.
Ginette Kolinka a aussi laissé un témoignage essentiel. Le récit Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau13 a été adapté du texte Retour à Birkenau par Ginette Kolinka et Marion Ruggieri. Arrêtée en mars 1944 et déportée dans le sud de la Pologne, Ginette Kolinka va survivre pendant plusieurs mois dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle raconte dans cet ouvrage la vie quotidienne dans le camp, et son ressenti d’enfant face à des lieux et des évènements inconcevables.
Du côté de la fiction, le roman de John Boyne, Le garçon en pyjama rayé14, donne aussi une grosse claque au lecteur. On y suit l’histoire de Bruno, un petit garçon dont les parents s’installent dans une maison au milieu de nulle part. Bruno s’éloigne peu à peu de la maison, mais se heurte très rapidement à des barbelés. Il fera alors la connaissance d’un autre garçon, étrangement vêtu d’un pyjama rayé de bleu et de blanc. La conversation s’engage, mais, bien vite, les adultes vont s’en mêler… Un camp de concentration vu par un regard d’enfant, innocent et tellement loin de son imaginaire. Glaçant et percutant.
Et du côté allemand ?
En se plaçant de l’autre côté de la barrière, la fiction permet parfois de décaler les repères. Dans le roman Il n’est si longue nuit15, Béatrice Nicodème rédige un roman choral dans lequel plusieurs jeunes Allemands apportent chacun un éclairage différent sur le conflit. Tous sont plein de rêves, dans la fougue de leur jeunesse. Certains croient à l’idéal hitlérien, d’autres l’abhorrent. Leurs destins vont se croiser, et aucun d’entre eux n’en sortira vraiment indemne. Un roman bouleversant, qui se lit d’une seule traite.
Roman choc également que Le garçon au sommet de la montagne16 de John Boyne. Au début de la guerre, Pierrot vit à Paris dans sa famille, et la guerre est très loin de ses préoccupations. Mais, après la mort de ses parents, le jeune garçon part vivre en Allemagne, dans une maison tout en haut d’une montagne. Et ce qui pourrait n’être qu’un simple chalet de montagne s’avère être un endroit beaucoup plus glaçant… Pierrot est au Berghof, la résidence d’Adolf Hitler. Il va dès lors devenir le témoin de l’évolution de la guerre et de la création des camps. Dérangeant et captivant tout à la fois.
Pour terminer cette sélection, un roman choc. Max17 de Sarah Cohen-Scali. Le jeune Max est né le 20 avril 1936 dans un Lebensborn. Un centre dans lequel des femmes sélectionnées mettent au monde de « purs » aryens. Dès sa naissance, Max devient le parfait petit soldat hitlérien, prêt à tout pour servir son Führer, jusqu’au bout… Le récit mené à la première personne rend la lecture d’autant plus dérangeante. C’est fort, très fort. Une claque de lecture, qui laisse le lecteur sur le carreau.