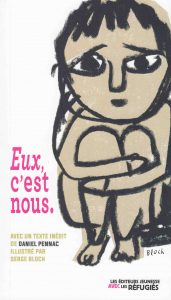Montreuil : une poche de résistance et de lumière
Le salon a rassemblé plus de 139 000 visiteurs et 420 exposants, défi relevé dans ce contexte post-attentats encore prégnant. Les promeneurs ont commencé à arpenter les allées puis à affluer samedi après-midi, dimanche et lundi. Il n’y a pratiquement pas eu de scolaires en semaine, si bien que les éditeurs parlent d’une impression de « vide » par rapport aux éditions précédentes. Il y a eu bien évidemment un manque à gagner pour eux, mais leur présence était forte de sens. L’interdiction des sorties scolaires a été levée jeudi et vendredi, mais le temps nécessaire aux enseignants pour mettre en place une sortie étant assez long, la mesure n’aura du coup pas suffit pour faire venir les élèves cette année. Certaines structures (centres sociaux…) ont cependant pu participer au salon et une vingtaine d’auteurs sont allés à la rencontre des scolaires directement dans les classes, les équipes du salon ont acheté des livres avec les 12 000 chèques-lire initialement destinés aux enfants ; livres qui ont été distribués aux 250 établissements du département.
Eux, c’est nous
Eux, c’est nous est le titre d’un recueil événement du salon, une co-édition de plus de 40 éditeurs jeunesse à laquelle se sont associés le salon et les libraires, qui se sont engagés pour réaffirmer les valeurs fortes d’accueil et de solidarité envers les réfugiés et les expliquer aux jeunes lecteurs et aux adultes. Sur beaucoup de stands, le projet est expliqué aux promeneurs et le livre est proposé à 3 €. Ce livre a mobilisé bénévolement l’ensemble de la chaîne du livre et l’intégralité des ventes est reversée à la Cimade, une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Les illustrations sont de Serge Bloch et le texte de Daniel Pennac décrivent la situation de ces hommes, ces femmes, ces enfants « qu’on bombarde, qu’on fusille, qu’on torture, qu’on terrorise, qu’on affame, dont on a détruit les villes, dont on a brûlé les maisons, qui ont déjà perdu un père, un frère, des parents, des amis… Ces gens dont nous pourrions faire partie, qui pourraient être moi, toi, vous./Nous./Mais qui sont eux ». Daniel Pennac termine par le bilan des vagues migratoires de tous les pays du monde vers la France. « Et ce sont eux, tous ces réfugiés du XXe siècle, jugés chaque fois trop nombreux, qui font, avec nous, la France d’aujourd’hui./Comme les réfugiés d’aujourd’hui feront, avec nous, la France de demain ».
Dans la seconde partie du livre, Jessie Magana et Carole Saturno font un acrostiche avec les 8 lettres du mot REFUGIES, chaque lettre développe une partie documentaire très pertinente avec les mots choisis : Réfugié, Étranger, Frontière, Urgence, Guerre, Immigration, Économie, Solidarité. Sont ainsi abordées les notions de demande d’asile, sans papiers, la peur et le rejet, le vivre ensemble quelle que soit sa religion et son origine, l’espace Schengen, les passeurs, les boat people (Serge Bloch réalise un bateau en papier avec les silhouettes au fusain des hommes), les dangers, les associations d’aide, les centres d’accueil, la fuite de la misère et de la violence, pour finir par la solidarité avec le dessin de deux mains enlacées.
Non à l’intolérance
Dans les lectures et les tables rondes, les thèmes se croisent, se métissent, se nourrissent les uns les autres de manière complexe et significative : le vrai et le faux, songe et mensonge, réel et imaginaire, tolérance et ouverture sur l’autre…
Non à l’intolérance est le titre d’un recueil composé de nouvelles de Bruno Doucey, Nimrod, Maria Poblete, Murielle Szac et Gérard Dhôtel paru chez Actes sud junior. Le salon fut l’occasion d’une lecture très émouvante qui permit de rendre hommage à Gérard Dhôtel, disparu tragiquement en mars 2015. Les nouvelles de ce recueil, par le biais de la fiction (fortement ancrée dans le réel) transmettent des messages forts au lecteur ; on découvrira ainsi un couple d’amoureux emblématique : elle arabe, lui juif, avec un racisme exacerbé des deux familles et la traque contre le jeune homme dans le train, les coups de couteau… (de Murielle Szac) ; puis une nouvelle de Bruno Doucey qui narre la traque contre un jeune homme, on croirait que ça se passe dans un pays lointain, mais c’est en France : « Arkemi n’aurait jamais cru qu’une chose pareille puisse lui arriver. Sa petite ville était si calme… ». Une fin positive : vive l’ocytocine, l’hormone de l’attachement « pour faire naître l’amour, l’empathie, la confiance envers autrui… C’est elle dont nous avons le plus besoin aujourd’hui » ; le lecteur suivra ensuite dans le texte de Maria Poblete une mère indienne et ses filles chassées de leurs terres par une déforestation sauvage. Le texte suivant relate l’histoire de Léo, un enfant différent qui, pour se protéger, veut rentrer dans le moule « comme le caméléon se fond dans la couleur de son environnement ». Puis, un dérapage et la descente aux enfers… une nouvelle percutante d’Elsa Solal sur tous les mécanismes et les conséquences du harcèlement avec une fin réjouissante cependant. Nimrod propose une nouvelle sur les maquisards de Ganagobie et le dernier texte de Gérard Dhôtel est associé à tous les auteurs précédents : « J’ai une de ces trouilles ! ».
Table ronde « Songes, mensonges et création »
Lors de cette table ronde, l’éditeur Alain Serres (Rue du monde) nous présente Raphaële Frier, enseignante en région PACA, pour son roman Do la honte (voir InterCDI no 258, p. 44). Un roman dur qui nous ouvre un peu les ailes. Tout est parti d’un petit garçon joyeux et plein d’enthousiasme dans sa classe de maternelle, malgré qu’il vive une situation difficile au sein de sa famille. Autour de lui tout va mal et du haut de ses 4 ans, il est en souffrance. Raphaële Frier est aussi l’auteure de Malala, un album pour le droit des filles à l’éducation, illustré de manière poétique et émouvante par Aurélia Fronty. Malala est le plus jeune Prix Nobel de la paix… à 17 ans, ce qui soulève des questions chez les élèves (« Existe t-elle vraiment ? »), elle a presque leur âge. En 2009, alors qu’elle n’a que 11 ans, et encouragée par son père, elle écrit un blog sur le site internet de la BBC où elle dénonce les violences des talibans. En 2011, elle commence à donner des interviews, à participer à des conférences et reçoit le Prix national de la jeunesse pour la Paix, créé pour elle, par le gouvernement pakistanais et devient une cible pour les talibans. En 2012, elle est victime de deux attentats, on tire sur elle dans un bus scolaire ; gravement atteinte, elle est opérée en Grande-Bretagne. Mais, elle reprend quand même son combat pour le droit à l’éducation. Le jour de ses 16 ans, elle témoigne à la 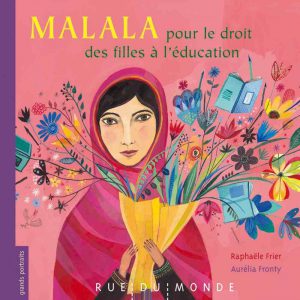 tribune de l’ONU à New York : « Chers frères et sœurs, c’est dans les ténèbres que nous nous rendons compte de l’importance de la lumière. Nous sommes conscients de l’importance de notre voix quand nous sommes réduits au silence ». Le 12 juillet, l’ONU décide du « Malala day » sur tous les continents.
tribune de l’ONU à New York : « Chers frères et sœurs, c’est dans les ténèbres que nous nous rendons compte de l’importance de la lumière. Nous sommes conscients de l’importance de notre voix quand nous sommes réduits au silence ». Le 12 juillet, l’ONU décide du « Malala day » sur tous les continents.
Puis Alain Serres présente le poète Abdellatif Laâbi comme un « gourmand de l’écriture » qui combat pour la liberté, comme « un rebelle absolu à tous les dogmatismes ». Il crée au Maroc la revue littéraire et sociale Souffle, pour « reconstruire une identité, une culture après la nuit coloniale » et opte pour une « démarche de l’universel ». Laâbi avec son J’atteste reprend le début de la profession de foi du Coran, un des cinq piliers de l’islam. J’atteste contre la barbarie est bien un livre-phare de ce salon 2 015.
Alain Serres présente ensuite « l’éternel Pef, à la sensibilité de papier photo », auteur et illustrateur du remarqué Zappe la guerre (collection Histoire d’Histoire) sur les Poilus de 14-18 qui, dans l’album, sortent d’un monument aux morts. Ils reprennent vie, 80 ans après leur mort, avec leur blessure mortelle symbolisée par une tache rouge, qui au front, qui dans la poitrine ou sur la main (arrachée)… Un grand moment aussi avec la très belle évocation de l’album Un violon dans la nuit de Didier Daeninckx/Pef. Dans cette collection, il y a une double lecture : la fiction est étayée, à chaque double page, d’une photo d’archive avec un commentaire historique ajoutant force au propos; cet album est formidable pour aborder la Shoah avec les élèves. Pef se rappelle de l’enfant de 6 ans qu’il était, les premières photos des cadavres d’Auschwitz qu’il a découvertes dans le journal, les femmes tondues… Il raconte aussi cette histoire forte : à Tulle, dans un salon du livre, on lui demande de venir dédicacer chez une personne qui ne peut se déplacer… Pef a donc quitté le salon du livre, laissant le papillon « je reviens dans un instant », pour rejoindre le mystérieux personnage qui souhaitait tant avoir sa dédicace… Il s’agissait d’un vieux monsieur de 101 ans, survivant d’Auschwitz, qui s’est tu pendant 40 ans avant de témoigner. Le vieil homme a été fasciné par le dessin de Pef représentant l’intérieur d’un wagon en route pour les camps, il n’avait jamais vu de photo ou de représentation telle. Pouvoir de la fiction où l’on s’aperçoit que le faux est plus vrai que le vrai ! Le vieil homme s’est confié à Pef : « Avec ton dessin, je suis revenu dans le wagon ! C’est pour cela que je veux ta signature ! ».
Tous les prescripteurs, parents, enseignants, bibliothécaires, libraires étaient présents lors de la journée professionnelle ; prescripteurs sans lesquels il n’y aurait pas de diffusion de la littérature jeunesse. Dans l’académie de Lille, la baisse de 50 % des crédits d’enseignement dans tous les collèges a été annoncée fin 2015, donc moins d’argent pour les CDI pour acheter les livres à destination des enfants… « Le livre jeunesse est la première porte par laquelle l’enfant accède au monde culturel. En tout cas, c’est la plus démocratique. C’est le premier objet par lequel l’enfant accède aux histoires. Dans un contexte comme celui-ci, la littérature permet de trouver sa place, de se comprendre, de comprendre ses émotions ; parce qu’elle raconte des histoires, parce qu’elle permet de prendre des distances avec la réalité. Il y a une vraie liberté du lecteur dans ce qu’il entend et finalement c’est la diversité de cette littérature qui est intéressante pour les enfants, pas forcément qu’elle colle à l’actualité » (Sylvie Vassalo, La Voix du Nord, jeudi 3 décembre 2015).
Le phénomène U4
Tout à coup, dans une allée, une queue d’ados et des affiches U4. Je m’approche, sur le stand Nathan, une brochette de quatre auteurs en dédicace ! Quelle ne fut pas ma surprise de les retrouver, plus tard, tous les quatre, sur le stand Syros ! Quelques mots sur le phénomène U4 (prononcer « youfor » mentionne Internet, mais pas obligé car le quatuor d’auteurs est francophone !). Donc, c’est une co-édition Nathan/Syros de 4 livres : Yannis de Florence Hinckel, Stephane (une fille) de Vincent Villeminot, Koridwen (une fille) d’Yves Grevet et Jules de Carole Trébor. C’est un concept créé par 4 auteurs en un jeu littéraire à la fois collectif et individuel. Quatre histoires différentes mais étroitement liées qui peuvent être lues dans n’importe quel ordre. Les personnages se croisent, nouent des liens, s’entraident, s’aiment ou se rejettent. Les sensibilités différentes des auteurs se développent sur un même sujet. Les points de vue se démultiplient et une même scène peut être comparée de roman en roman et les interprétations varier. L’histoire ? Dans un univers post-apocalyptique, quatre ados, héros de quatre romans distincts, comptent parmi les quelques milliers de survivants d’un filovirus méningé appelé U4, pour « Utrecht », la ville des Pays-Bas où il est apparu, et « 4e génération ». U4 a décimé la planète mais a épargné les ados de 15 à 18 ans, insensibles au virus. La nourriture et l’eau potable commencent à manquer, Internet est instable et l’électricité tout comme les réseaux de communication menacent de s’éteindre. Les quatre héros étaient tous des joueurs de Warrior of Times (WOT) et ils reçoivent le message du jeu de la part de Chronos qui les invite à retourner dans le passé pour empêcher la catastrophe. Le 24 décembre à minuit, un rendez-vous est fixé à Paris aux 4 héros qui ne se connaissent pas… Arriveront-ils à changer le cours des choses ? Des thèmes porteurs : la survie en milieu hostile; l’adolescence, ses amitiés, ses amours intenses. Une façon francophone de renouveler le thème de l’apocalypse en littérature pour ados (à partir de 13 ans). En arrière-plan, par rapport au thème de la maladie, nous pensons à La Peste et au Hussard sur le toit.
Wonderland, la logique du rêve
Pour les 150 ans d’Alice au Pays des Merveilles, au sous-sol du salon, entrez, comme Alice dans le terrier du lapin, dans l’exposition Wonderland, la logique du rêve, où 5 illustrateurs se sont frottés à ce mythique roman jeunesse. La scénographie de l’expo est adaptée : cinq illustrateurs, cinq îlots/pièce à vivre reliés par des galeries/couloirs comme si vous étiez dans le terrier d’un lapin ! Des oculi à différentes hauteurs, sur plusieurs côtés (démultiplication des points de vue) permettent de voir de véritables saynètes composées d’après Alice au Pays des Merveilles. « Alice nous entraîne dans son univers complètement décalé par rapport à la réalité, elle est dans le songe, mais les questions qu’elle se pose pour grandir, la manière dont le texte interroge la relation au monde des adultes et l’incompréhension que les enfants peuvent en avoir, face à sa cruauté notamment, sont des portes d’entrée dans le monde d’aujourd’hui » (Sylvie Vassalo, La Voix du Nord, jeudi 3 décembre 2015).
Gilles Bachelet, bien connu pour son humour dans Mon chat le plus bête du monde et Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées (deux albums à avoir absolument au CDI !), nous offre ici les planches originales de Madame le Lapin Blanc. Le succès fut tel que cet album fut en rupture de stock dans toutes les librairies du salon ! Peut-être que cet humour tordant a fait mouche en cette période d’inquiétude et de questionnement. Le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles est toujours en retard à son poste de travail, au palais de la Reine de Cœur ; Gilles Bachelet se demande le pourquoi de ces retards : quelle est sa vie de famille, ses occupations ? À travers le journal de Madame le Lapin Blanc, son épouse, l’auteur pénètre dans l’intimité de sa petite famille ! Un dessin original qui a beaucoup fait rire les promeneurs.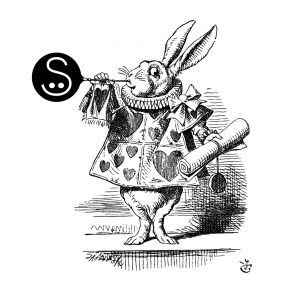
Les originaux de Benjamin Lacombe opèrent une séduction étrange à travers les rouges profonds des fleurs blanches peintes en rouge par les jardiniers, le rouge des amanites phalloïdes, le rouge des poils du Chat du Cheshire et des brins d’herbe ! Dans le chapitre « Un thé chez les fous », au milieu d’un décor de feuilles sombres, un fauteuil en velours cramoisi est occupé par une Alice au visage de poupée de porcelaine encadré de cheveux longs et blonds. Elle a une pose érotique à la manière de Balthus, une jambe relevée dénudée avec de fines bottes montantes à petits talons. D’une main elle caresse un lapin blanc aux yeux rouges sur son giron, de l’autre elle tient négligemment une tasse de porcelaine. Tous ces rouges sont inquiétants et soulignent le côté ambigu de l’œuvre. Dans les belles éditions « Soleil », les pages se déplient quand les pieds et les bras d’Alice sortent des fenêtres de la maison ou quand le cou d’Alice grandit !
Chez Anthony Browne, le caractère surréaliste, à la manière de Magritte, est bien développé. Nous avons aimé la planche originale où le Ver à soie fume un long houka (pipe orientale analogue au narguilé), les bouffées de fumée qui s’échappent de sa bouche ont la forme de papillons !
Il était possible aussi de voir les originaux de Chiara Carrer et Rébecca Dautremer avec le talent qu’on leur connaît, avec, pour cette dernière, Alice dans sa mare de larmes et la gueule énorme du Chat du Cheshire…
Chacun, chacune par leurs illustrations réinterprètent et servent à merveille ce très grand texte de Lewis Carroll.
Voilà toute l’ambiance du salon du livre 2015 : émotions, voix serrées, yeux humides, enthousiasmes et rires malgré tout. Le thème de cette année, « Pour de vrai, pour de faux », réaffirme le pouvoir de la création dans la construction de soi et la compréhension de l’Autre. Le livre, pour reprendre les termes de Sylvie Vassalo, « d’objet extérieur, devient un objet intérieur », ce qu’ont démontré poétiquement les illustrateurs d’Alice et, chacun d’entre nous, par nos lectures créatives.